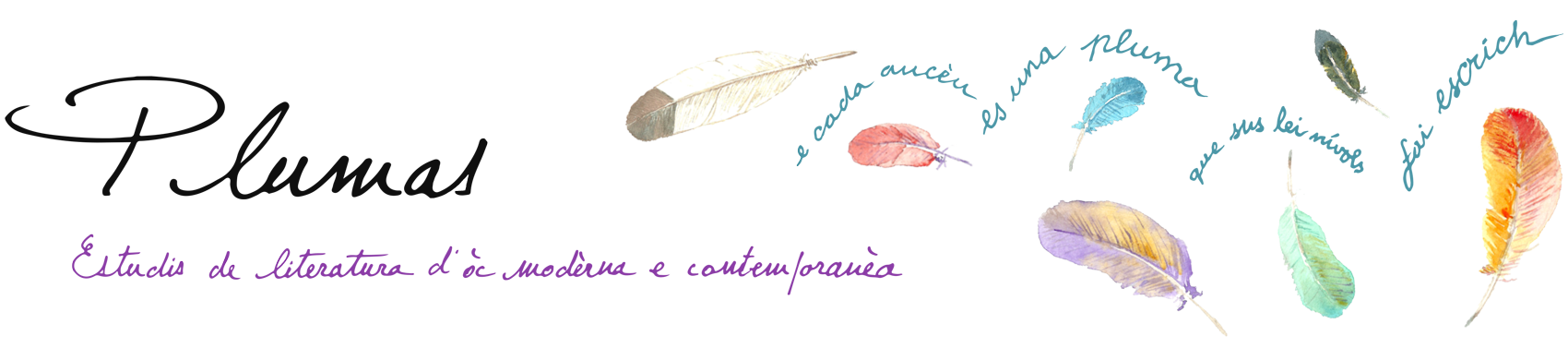C’est peu dire que les prisons de l’Inquisition ont mauvaise presse. Leur image répulsive est fondée à la fois sur un ensemble de témoignages vécus et sur une construction polémique héritée d’affrontements religieux séculaires. À côté de pamphlets vindicatifs, la littérature, la peinture, la gravure ou encore l’art lyrique ont contribué à fixer cette image d’abjection auprès de l’opinion publique. Le témoignage en tant que divulgation d’une réalité, placée d’emblée sous le signe du secret et de l’infamie par l’institution inquisitoriale elle-même, a précédé la fiction comme sa condition de possibilité. Les quelques échantillons qui suivent doivent suffire pour s’en convaincre.
Dès le seizième siècle les fameux Artes aliquot de Reginaldus Montanus, parus à Heidelberg, font de la prison de l’Inquisition un lieu d’épouvante que les martyrologes protestants de Jean Crespin (1520-1572), Simon Goulart (1543-1628) ou de John Foxe (1516-1587) ne cesseront d’exploiter à des fins prosélytes1. Certes l’importante distinction entre détention préventive et punitive (carcer ad custodiam v. Carcer ad poenam) y est bien signalée, mais, dans tous les cas, malgré des déclarations d’intention hypocritement affichées au cours de leurs visites d’inspection par ces « miséricordieux crocodiles » que sont les inquisiteurs, l’arbitraire ou l’horreur sont présents à tous les niveaux. Caractérisée par un processus de déshumanisation au quotidien la vie dans les geôles inquisitoriales serait ainsi faite d’insalubrité, d’encouragement à la délation, de torture physique et psychologique dans l’étroitesse d’un confinement délétère. Dès lors d’autres témoignages à charge vont venir se rajouter pour corroborer ce premier constat en soi déjà très sévère et qui tourne bientôt au réquisitoire. L’abolition de l’Inquisition au XIXe siècle ne mit pas un terme à cette polémique qui perdure jusqu’à nos jours, parfois recyclée sous des formes improbables. L’usage qu’en fit le romancier cubain Reinaldo Arenas (1943-1990) en s’appropriant la vie du religieux mexicain Servando Teresa de Mier (1765-1827) nous semble être un bon exemple de cette instrumentalisation mise au service d’un projet à la fois esthétique et politique. C’est ce que nous nous proposons d’établir ici dans le cadre plus général d’une réflexion sur la littérature carcérale.
Forteresse Castillo del Morro, Cuba
Wikipedia common
Le temps des témoins
Ce temps des témoins est un temps long même si la matière est relativement rare. Si l’on met de côté l’Inquisition médiévale et si l’on fait abstraction de la période initiale des inquisitions ibériques, ce temps est aussi long que la durée d’existence de l’institution elle-même. Ainsi, avec la prise de parole d’anciens prisonniers du Tribunal, le témoignage s’incarne principalement dans une écriture victimaire le plus souvent produite a posteriori : ce qui ne va pas sans quelque paradoxe. On est en fait en présence d’une rupture du sceau du secret imposé au détenu comme préalable à son élargissement. Cet interdit prenait la forme d’une sévère mise en garde : techniquement il s’agissait d’une monition accompagnée du serment solennel de ne rien révéler de ce qu’il avait vu ou entendu pendant sa captivité. On a ainsi pu dire que l’inviolabilité du secret était l’âme de l’Inquisition. Silence sur la procédure, silence sur les conditions de détention, silence sur la personne des juges et de leurs acolytes. En somme l’envers de cette cérémonie à grand spectacle qu’allait devenir l’autodafé baroque à l’âge classique. C’est pourquoi la violation de ce serment était imputée à charge en cas de récidive : une circonstance aggravante qui, du moins en théorie, pouvait entrainer une condamnation comme relaps. Aussi la plupart des ex-prisonniers, peu nombreux, qui témoignèrent contre les méthodes du Tribunal attendirent-ils d’être hors de sa portée pour ne pas s’exposer à d’éventuelles représailles.
Une exception à cette règle est celle des graffiti qui, compte tenu du support matériel inamovible, relève de la reconstitution in situ, une reconstitution complexe prenant parfois la forme de palimpsestes difficilement déchiffrables car, à l’évidence, les murs ne sont pas des pages. L’évasion du prisonnier en possession ou non de ses écrits est un cas de figure plus rare sans être exceptionnel. Très vite le récit des déboires et des mésaventures de ces ex-prisonniers montre que la frontière entre écriture testimoniale et fiction n’est guère étanche. Pour l’Inquisition romaine on a l’exemple de Giuseppe Pignata (1661-1714), et celui de Giacomo Casanova (1725-1798) pour les Plombs de l’Inquisition vénitienne, pour l’Inquisition espagnole, alors crépusculaire, celui de l’aventurier et général Juan Van Halen (1788-1864). Pour l’Inquisition portugaise, également finissante, on a le témoignage du journaliste et diplomate Hipólito José da Costa Pereira (1774-1823), considéré comme le « père de la presse brésilienne ». En dehors des scénarios d’évasion, on possède, toujours pour l’Inquisition romaine, le Carcer de Girolamo Cardano (1501-1576), Les pensées de Monsieur Dassoucy dans le Saint-Office de Rome, du poète musicien Charles Coypeau d’Assoucy (1605-1677), ou encore le récit des deux jeunes femmes quakers Sarah Cheevers (1608-1664) et Katharine Evans (1618-1692) qui, au cours d’une une escale, se livrèrent à un dangereux prosélytisme qui les conduisit dans les prisons de l’Inquisition maltaise2. Concernant les écrits intra-carcéraux, au sens strict de ce terme, en provenance de l’aire des Inquisitions ibériques et ibéro-américaines nous sont parvenus des fragments de textes judéo-convers souvent d’inspiration religieuse ou profane comme les sonnets d’António Serrão de Castro (1610-1684) qui passa dix ans dans les prisons du Saint-Office à Lisbonne et qui ne furent publiés qu’en 1883 par Camilo Castelo Branco (1825-1890) sous le titre : Os Ratos da Inquisição3. Dans ce dernier cas l’écriture apparait clairement comme un moyen de survie et une technique de résistance par la satire.
Parmi ces divers témoignages, il convient d’en distinguer un qui s’impose entre tous en raison de sa fortune éditoriale et de sa postérité littéraire qui sont à l’exact opposé du précédent, demeuré longtemps inédit. Il s’agit bien entendu du récit que le médecin agathois Charles Dellon (1650-1710), a consacré à sa captivité dans l’Inquisition de Goa. Ouvrage de commande selon toute vraisemblance, on ne saurait trop insister sur son rôle de machine de guerre au service de la polémique anti-inquisitoriale. Outre la description minutieuse qu’il offre de la procédure, l’intérêt du livre réside aussi dans son désir de transmettre au lecteur les émotions éprouvées par le prisonnier depuis l’intérieur de la cellule en lui proposant des anecdotes familières. Parmi celles-ci la présence de vermine : un lieu commun de la littérature carcérale et en particulier la cohabitation avec des rats, un fil conducteur pour notre propos comme on le verra. L’un des passages plébiscités par ses lecteurs est celui où Dellon expose comment, après avoir affamé ces animaux, il parvint à les domestiquer :
Je m’étais aperçu qu’il entrait des rats toutes les nuits dans ma cellule par-dessus les portes ; je pensais que si je pouvais parvenir à en prendre et à en apprivoiser, cela me servirait d’amusement et que par ce moyen je ne serais pas tout à fait si seul. Ceux qui liront ceci riront sans doute de ce que j’aie pu penser une chose si indigne d’un homme raisonnable et ils seront peut-être encore plus étonnés de ce que j’aie la faiblesse de la raconter. Cette idée m'a empêché effectivement d’en parler jusqu'à présent ; mais plusieurs de mes amis ayant souhaité que cet article de mes aventures fût inséré dans cette nouvelle édition, je n’ai pu me dispenser de déférer à leur avis. Pour revenir donc à mon sujet, je pensai sérieusement comment je pourrais parvenir à prendre des rats, à les nourrir et à les rendre ensuite familiers4
Alors que le livre parut pour la première fois en 1687 et qu’il connut tout de suite un grand succès, en 1719 les éditeurs hollandais de l’ouvrage du calviniste Constantin de Renneville (1650-1723) : L’inquisition française : ou, L’histoire de la Bastille, décidèrent de l’intégrer à une réédition du leur comme son prolongement naturel5. Ils prétendaient par là démontrer que si la France n’avait pas introduit d’Inquisition moderne sur son territoire les méthodes dont elle usait à l’égard des protestants ne valaient guère mieux. Un tel appariement mettait déjà en lumière la fonction archétypale du modèle inquisitorial au-delà de sa sphère propre. Quant au sieur Renneville, embastillé pendant onze ans pour espionnage, il ne manqua pas lui-même de relater les féroces batailles qu’il dut livrer aux rats qui lui disputaient sa maigre pitance (Renneville, Tome II, 2-4). L’ensemble de ces témoignages finit par constituer un réservoir de stéréotypes où la fiction ne cessera de puiser jusqu’à aujourd’hui pour y trouver la source de son inspiration6.
De la littérature utopique au locus terribilis du roman gothique
Avec Tommaso Campanella (1568-1639) qui a rédigé en prison sa célèbre utopie : La Cité du Soleil, on se trouve indiscutablement en présence d’une authentique écriture intra-carcérale. Si la porosité entre témoignage et fiction fut une réalité précoce rendant difficile leur distinction, en revanche l’absence totale de vécu carcéral attesté chez un auteur rend plus aisée l’identification de la part de son œuvre qui ressortit à l’imaginaire mimétique. Au XVIIIe siècle et dans la continuité de la polémique anti-inquisitoriale, émerge toute une littérature utopique ou dystopique qui trouve dans les prisons de l’Inquisition le cadre et la matière de sa démonstration. Les aventures de Jacques Massé (vers 1710) de Simon Tyssot de Patot (1655-1738), mettent ainsi en scène un chinois universaliste dont les réflexions dans le Saint-Office sont un modèle de tolérance7. La prison de l’Inquisition devient alors un lieu propice à l’incubation de certaines vérités véhiculées par de pseudo-écritures carcérales. Dans les Mémoires de Gaudence de Lucques de Simon Berington (1680-1755), selon une technique de vérédiction éprouvée, ce sont les inquisiteurs eux-mêmes et leur greffier qui paradoxalement deviennent les garants de la véracité du récit qui émane de leur prisonnier8. Dans Aline et Valcour, le marquis de Sade (1740-1814), par ailleurs un excellent connaisseur du régime pénitentiaire, vu de l’intérieur, a voulu introduire son lecteur par effraction dans les prisons de l’Inquisition en lui donnant accès à une sorte de contre-utopie, celle d’un monde régi par une sexualité à la fois débridée et normée9. Quant à Voltaire (1694-1778) pour les besoins de sa fable, il imagine dans les Lettres d’Amabed le héros de son conte en train de maintenir une correspondance depuis sa cellule inquisitoriale10, une formule épistolaire que l’on retrouve chez l’espagnol Luis Gutiérrez (1771-1809) l’auteur de Cornelia Bororquia (1801)11. Cette littérature utopique ou para-utopique annonce le locus terribilis de l’imaginaire gothique dont elle possède déjà tous les attributs horrifiques.
Entre le XVIIIe siècle finissant et le milieu du siècle suivant, le roman gothique anglais, dans ce qu’il a de meilleur comme de pire, va multiplier les scènes ayant pour décor les prisons secrètes de l’Inquisition12. On remarquera que le thème de l’enfermement dans les prisons du Saint-Office se conjugue avec celui de la claustration monastique. C’est le cas avec Ambrosio, le moine, héros éponyme du roman (1796) de Mathew Gregory Lewis (1775-1818) qui, après avoir passé une partie de sa vie dans un monastère, finit par aboutir dans les geôles de l’Inquisition avant d’en être extrait par une créature démoniaque. De la même façon Ellena, la jeune héroïne de l’Italien ou le Confessionnal des Pénitents noirs (1797) d’Ann Radcliffe (1764-1823), qui était déjà plus ou moins en situation d’enfermement dans sa propre demeure, sera victime des machinations d’une mère supérieure criminelle tandis que Vivaldi, son symétrique au masculin, atterrit dans les cachots de l’Inquisition romaine. Ces motifs récurrents de l’incarcération inquisitoriale s’inscrivent dans le contexte d’un protestantisme anglo-saxon militant, très hostile aux dogmes catholiques. Tous ces romans surtout lorsqu’ils évoquent les conditions de détention d’un prisonnier de l’Inquisition sont, à des degrés variables, plus ou moins tributaires de la lecture de la Relation de Goa de Dellon. Au XIXe siècle, qui est celui des abolitions des Inquisitions modernes, à l’exception notable du Saint-Office romain, future Congrégation pour la doctrine de la foi, l’imaginaire carcéral inquisitorial se déplace pour se tourner vers l’Inquisition médiévale jusque-là peu sollicitée mais que le Romantisme met au goût du jour.
De l’ouverture des prisons du Saint-Office à la poétique de leurs ruines
En dehors des récits de captivité, qui, même lorsqu’ils sont réputés fiables, ne peuvent éviter une partialité inhérente à leur point de vue, rares sont les témoignages extérieurs qui ont apporté un éclairage sur un lieu impénétrable à toute curiosité. Toutefois vers 1780 John Howard (1726-1790) entreprenait une étude pionnière sur les conditions de détention en Europe en cherchant à se rendre sur place pour se forger une opinion en vue d’une réforme de ces établissements. Au cours de ce tour d’horizon il passait en revue les différentes prisons et mentionnait avec horreur celles de l’Inquisition à Rome ou à Lisbonne, mais aussi en Espagne à Valladolid. Cette dernière fut la seule où il put se procurer quelques renseignements sur le secret de l’instruction, les jugements sans appel, les cellules sombres et la terreur qu’inspirait au peuple de la ville le seul nom du tribunal13.
Pour hermétiques qu’elles fussent les portes des prisons de l’Inquisition finirent donc par s’ouvrir, une fois venu le temps de la suppression des différentes succursales du Tribunal. Se multiplient alors des témoignages apocryphes mettant en scène cette ouverture en particulier à la suite de l’intervention des armées françaises. Ces récits de propagande vont s’échelonner au cours du premier XIXe siècle comme autant de manifestes anticléricaux. À côté d’une réalité carcérale, parfois sordide mais le plus souvent ordinaire, il y a donc bien un mythe de la prison inquisitoriale qui se met en place très tôt dans le cadre de la confessionnalisation des sociétés européennes au temps des Réformes. Ce mythe se cristallise ensuite avec la raison triomphante à l’apogée des Lumières, avant que l’idéologie libérale ne le reprenne à son compte au XIXe siècle. L’imaginaire romantique en fournira alors l’expression la plus achevée : on a à l’esprit Torquemada (1420-1498), héros éponyme de la pièce de Hugo (1802-1885), émergeant de son in pace14. Le phénomène culminera avec Michelet (1798-1874) et sa sorcière qui gémit dans sa froide prison15. Malheureusement le travail du professeur du Collège de France reposait en partie sur des sources douteuses comme L’Histoire de l'Inquisition en France d’Étienne-Léon de Lamothe-Langon (1786-1864). Le baron, prosateur assez médiocre par ailleurs, n’en était pas à une falsification près, allant jusqu’à inventer des archives qui n’existaient pas.
Après la suppression des différents tribunaux du Saint-Office, des voyageurs, curieux de s’informer par eux-mêmes ou poussés par une curiosité morbide, chercheront à pénétrer dans les locaux de la défunte institution. Cependant un scepticisme de bon aloi était aussi parfois de rigueur. Ainsi, William Bullock (1773-1849), un antiquaire, naturaliste, archéologue et explorateur britannique qui se trouvait au Mexique en 1822 faisait-il ce constat dans son récit d’expédition :
Le palais de l'Inquisition est en face, de l’autre côté de la rue et près de la place des exécutions. Les personnes accusées de crime contre l’Église y étaient enfermées ; et j’avais beaucoup entendu parler avant mon arrivée au Mexique des horribles cachots souterrains dans lesquels ces malheureux étaient emprisonnés ; mais j’eus alors la preuve de l’exagération de ces récits, puisqu’il n’existe pas un souterrain dans Mexico : et il ne peut y en avoir ; car si l’on creuse la terre seulement de quelques pieds, l’eau surgit à l'instant16.
Ce témoignage est surprenant précisément parce qu’il va à rebours du lieu commun habituel et qu’il le démystifie au bénéfice de l’enquête de terrain. Il est d’autant plus intéressant que le dernier hôte des geôles inquisitoriales mexicaines, juste avant que n’intervienne l’abolition définitive du Tribunal, fut précisément le personnage à la fois historique et romanesque qui est au cœur de notre sujet. C’est en effet ici qu’entre en scène Teresa de Mier y Noriega y Guerra, religieux par sa robe, aventurier par tempérament, idéologue politique et surtout pour notre propos véritable homme de plume. Un personnage plutôt inclassable, mieux connu sous le nom de Fray Servando17.
Le tour du monde d’un moine en quatre-vingts prisons et mille et une évasions
(Nous empruntons en partie le titre à la quatrième de couverture de la réédition du roman d’Arenas aux éditions du Seuil en 1982).
La trajectoire publique de Fray Servando a pour point de départ un sermon controversé, prononcé à l’occasion de la célébration des fêtes de la Vierge de Guadalupe dans la ville de Mexico, le 12 décembre 1794. Ce sermon allait changer le cours que sa vie. A la fin du XVIIIe la tradition selon laquelle la Vierge de Guadalupe était apparue à l’indien Juan Diego sur la colline de Tepeyac aux débuts de la conquête espagnole, était l’objet de critiques voilées de la part du haut clergé espagnol de Mexico, bien que cette épiphanie eut été confirmée par l’Église comme preuve que l’action espagnole au Mexique s’inscrivait dans les plans divins. Le fait que la Vierge soit apparue à un simple indien affaiblissait son crédit aux yeux des hautes autorités ecclésiastiques de la vice-royauté mais elle était aussi à l’origine d’une religiosité populaire qui voyait là une preuve de la reconnaissance divine envers le peuple indien. Parallèlement dans les milieux créoles circulait une tout autre version qui voulait qu’il y ait eu une prédication chrétienne en Amérique antérieure à la conquête espagnole. Selon ce schéma explicatif, Quetzalcóatl, le dieu aztèque, n’était en fait que l’apôtre Thomas qui, peu de temps après la mort du Christ, serait arrivé en Amérique pour y prêcher l’Évangile. Naturellement cette théorie alternative n’avait pas été acceptée par l’Église, par ce qu’elle revenait à déposséder les Espagnols du fondement providentiel d’où la Conquête tirait sa légitimité18.
Dans son sermon, Fray Servando avait en quelque sorte fusionné les deux traditions en affirmant que la Vierge de Guadalupe était déjà adorée sous le nom de Tonantzin au début de l’ère chrétienne par les Indiens au sommet de la Sierra de Tenanyuca, lieu où Saint Thomas aurait placé son image. Il est possible que, plus qu’une initiative personnelle, ce sermon ait été l’expression d’une stratégie créole visant à renforcer la tradition face aux tendances hostiles au mythe guadalupéen dans la sphère du haut clergé espagnol de Mexico. Quoi qu’il en soit, face à une interprétation jugée subversive, l’Église n’eut d’autre choix que de confirmer la version originale et de condamner les théories du religieux comme étant déstabilisatrices de la tradition19.
Dès le lendemain, Fray Servando se vit retirer sa licence de prédicateur et on commença l’instruction de son procès qui, malgré des tentatives dans ce sens, ne fut pas transmis au Saint-Office20. Pour la première fois de sa vie, le 28 décembre 1794, il est emprisonné dans le couvent de son Ordre. Trois mois plus tard, l’archevêque de Mexico Alonso Nuñez Haro de Peralta (1729-1800) en châtiment de ce qu’il considère avoir été une provocation scandaleuse, le condamne à dix ans de réclusion dans le couvent dominicain de Las Caldas près de Santander en Espagne, à la privation perpétuelle de tout enseignement public en chaire, et à la suspension du confessionnal21. C’est pour le prédicateur déchu le début d’un long exil et le coup d’envoi d’une impressionnante série d’évasions et de réincarcérations qui ont contribué à lui conférer une aura légendaire.
On peut dresser une sorte de promptuaire de ces étapes carcérales qui rythment une odyssée qui part du cachot monacal pour aboutir dans l’antichambre du pouvoir. Au mois de mars 1795 il est extrait de sa cellule du couvent de Saint Dominique et transféré dans la forteresse de San Juan de Ulúa dans l’attente de son embarquement pour le Vieux Continent. Après son arrivée à Cadix où il est détenu un temps, il est dirigé vers le monastère de Las Caldas, supposé être sa destination finale, mais il s’enfuit. Repris, il est adressé au couvent de San Pablo de Burgos d’où il s’enfuit à nouveau avant d’être rattrapé. Reclus dans le « quartier des Indes » du couvent de Saint François de Madrid il y prépare une dissertation pour la défense de son sermon (1797). En 1800, bien que lavé de la suspicion d’hérésie par l’Académie Royale d’Histoire, il n’en est pas moins condamné par le Conseil Royal des Indes à finir de purger sa peine à Salamanque. Prenant à nouveau la fuite, il est intercepté à Burgos alors qu’il se dirigeait vers la frontière. Une nouvelle évasion le conduit à Madrid puis à Valladolid et finalement il parvient à gagner la France en utilisant des faux papiers au nom du Docteur Maniau y Torquemada. À Bayonne il fréquente une synagogue et soutient des controverses théologiques avec des rabbins. À Bordeaux il fait la connaissance de Simon Rodriguez, alias Samuel Robinson (1769-1854), apôtre d’une pédagogie rousseauiste et maître à penser de Simon Bolivar (1783-1830) avec qui il part pour Paris. Donnant des cours d’espagnol dans la capitale française, il prétend, sans doute abusivement, avoir traduit Atala de Chateaubriand (1766-1848) qu’il aurait rencontré en personne.
Convaincu d’être l’objet d’une injustice, il décide de passer à Rome pour obtenir sa sécularisation et avoir ainsi les mains libres pour s’occuper de son procès. Une fois cet objectif atteint, il revient en Espagne où il est à nouveau arrêté en novembre 1803. Fin janvier 1804 il est envoyé comme prisonnier à Séville à Los Toribios, une maison de correction pour mineurs délinquants, reconvertie en prison politique. Le 24 juin de la même année il s’en évade une première fois mais, dénoncé par le Provincial des Dominicains à Cadix, il est enfermé dans la Cárcel de Corte. En septembre il est rapatrié à Los Toribios de Séville où ses conditions de détention s’aggravent. En octobre 1805 il s’enfuit définitivement et alors qu’il se dirige vers le Portugal, il est témoin de la bataille de Trafalgar, le 21 octobre. À Lisbonne il écrit un prologue à l’Apologie de Barthélémy de Las Casas de l’Abbé Henri Grégoire (1750-1831). Il ne fait guère de doute que depuis un certain temps les sympathies de Mier sont acquises à la cause indépendantiste mexicaine.
Néanmoins en 1808, opposé à l’intervention napoléonienne en Espagne et devant le changement de dynastie qui s’annonce, il prend part aux hostilités en devenant chapelain du Bataillon de Volontaires de Valence. Le 18 juin 1809 il est fait prisonnier par les Français à Belchite, à la suite de la défaite du général Blake (1759-1827). Détenu à Saragosse il s’évade dès le mois de juillet. En 1811 il est initié à Cadix dans une loge paramaçonnique. Le 7 octobre on le retrouve à Londres où il prend contact avec les cercles indépendantistes latino-américains et finit de rédiger son Histoire de la Révolution de la Nouvelle Espagne, considérée de nos jours comme la première grande synthèse sur le sujet22. Ses fréquentations londoniennes, ses débats avec José Maria Blanco White (1776-1841), fameux écrivain « hétérodoxe » espagnol, converti au protestantisme, ou encore avec le poète et philosophe chilien Andrés Bello (1781-1865), attestent de son évolution idéologique.
Après avoir connu l’Espagne de Charles IV (1748-1819) et de Manuel Godoy (1767-1851), Servando est désormais convaincu de l’inéluctabilité de l’Indépendance de l’Amérique Hispanique. Avec le révolutionnaire Francisco Javier Mina (1789-1817) il s’embarque pour les États-Unis en 1816 et participe à l’invasion de Soto de la Marina en 1817. Après quelques succès initiaux l’expédition se termine sur un échec complet et Servando Mier est de nouveau prisonnier au Mexique, soit 22 ans après le sermon qui avait bouleversé son existence. Après un bref passage par la forteresse de San Carlos de Perote, cette fois-ci c’est bien dans les prisons secrètes de l’Inquisition qu’il échoue ce 14 aout 1817. Il y demeura trois ans : accusé d’être hérétique, franc-maçon et traitre à son Roi. Après l’abolition du tribunal sans qu’aucun verdict formel n’ait été rendu sur sa cause il est transféré à la Cárcel de Corte puis, une nouvelle fois, dirigé sur la forteresse de San Juan de Ulúa. Perçu comme un propagandiste actif et un ferment de la sédition, le 3 février 1821 il est réembarqué vers l’Espagne. Au cours d’une escale à la Havane, il est reclus dans la prison du Morro, la forteresse coloniale qui garde l’entrée du port. Se plaignant alors de graves problèmes de santé il obtient de séjourner à l’hôpital d’où il s’échappe. Commence alors un court intermède aux États-Unis à Philadelphie et New-York. Mier est élu député en 1822 mais arrêté à la Vera Cruz il se retrouve une fois de plus prisonnier à San Juan de Ulúa d’où il est relâché quelques mois plus tard à la faveur de la proclamation du Plan de Iguala par Agustín Iturbide (1783-1824), devenu empereur constitutionnel. Cependant il ne tarde pas à s’opposer au nouveau pouvoir. Accusé de conspiration, il est reclus dans le couvent de Saint Dominique, d’où il finira naturellement par s’enfuir. Rapidement rattrapé, il est conduit pour la énième fois à la Cárcel de Corte puis à l’ancien palais de l’Inquisition. Il s’en échappera encore peut-être avec la complicité de sociétés secrètes. C’est là que se termine cette invraisemblable mais authentique série d’incarcérations alternées d’évasions qui s’étend sur quelque vingt-cinq ans. Après la chute d’Iturbide, survenue en 1823, Mier mène avec enthousiasme une carrière de parlementaire et d’idéologue, désormais rallié au républicanisme et à un fédéralisme tempéré. Au soir de sa vie, sur invitation du président Guadalupe Victoria (1786-1843) il séjourne dans une aile du Palais Fédéral de Mexico où il décède le 3 décembre 1827, entouré d’honneurs et bénéficiant d’une forme de reconnaissance en tant que père de la Nation. Une fin de parcours bien différente de celle que connaitra son émule cubain, Reinaldo Arenas à un siècle et demi de distance.
Les Mémoires d’un moine apostat
À ce stade le label d’écriture carcérale que nous décernons à l’œuvre de Mier doit être interrogé avec tous les paradoxes que cette dénomination implique. En premier lieu écrire pendant que l’on était prisonnier de l’Inquisition, était-ce vraiment une impossible gageure ? Comme pour presque tout ce qui touche à l’histoire de ce tribunal il n’y a pas de réponse univoque à ce genre de question trop dépendante des circonstances pour autoriser une généralisation. Certes, les précédents illustres ne manquent pas. Luis de Leon (1527-1591) composa dans les geôles de l’Inquisition de Valladolid certains de ses vers parmi les plus remarquables et il y écrivit « Les Noms du Christ » son chef d’œuvre alors qu’il attendait l’issue de son procès. Selon les règles du Saint-Office l’obtention de moyens d’écriture pouvait être accordée par les juges en particulier lorsqu’il s’agissait d’une controverse théologique pour que le prévenu puisse mettre au clair ses arguments. Ce fut le cas pour le martyr juif Francisco Maldonado da Silva (1598-1639) qui, lorsqu’il fut privé de cette ressource, confectionna deux cahiers d’une centaine de pages chacun en collant des morceaux de papier les uns aux autres. Il se mit également à fabriquer de l’encre avec de la cendre et tailla un os de poulet au moyen d’un clou pour s’en faire une plume avec laquelle il écrivit des pamphlets antichrétiens qui devaient l’accompagner jusque sur le bûcher. Rien de tel bien sûr avec Servando Mier qui ne passa pas par de telles affres. Certes il s’agissait alors d’une Inquisition à bout de souffle mais encore redoutable et dont le frère prêcheur connaissait suffisamment les rouages pour s’en méfier. Une partie des minutes et des actes de l’instruction de son procès nous ont été conservés23. L’opinion peu flatteuse que les inquisiteurs avaient de lui nous est ainsi parvenue mais, loin de s’en formaliser, Mier devait au contraire en faire état lui-même au cours de la session du congrès constituant du 15 juillet 1822 comme gage de sa constance :
C’est l’homme le plus nuisible et le plus redoutable que ce royaume n’ait jamais connu : il est d’un naturel hautain, superbe et présomptueux : il possède une très vaste culture en mauvaise littérature [...] Son cœur est tellement corrompu que loin d’avoir manifesté à l’époque de sa détention la moindre variation dans ses idées, nous n’avons reçu de lui que des preuves d’un regrettable entêtement (Mier 2013, 426, N.T.24).
Pourtant c’est dans la mesure où l’Inquisition avait évoqué son cas, le 31 juillet 1817, comme relevant de sa juridiction que Mier avait pu échapper aux balles du peloton d’exécution, à la différence des autres membres du corps expéditionnaire, moins chanceux dans la défaite. Si nous pouvons lire l’œuvre du dominicain c’est d’abord parce qu’il lui a été permis de préparer sa défense par écrit. Mier, malgré son appartenance à l’ordre des prêcheurs, se montra souvent hostile à l’endroit du Tribunal auquel il dédia quelques vers de mirliton pour marquer son rejet de l’institution25 et il ira même jusqu’à la diatribe en 1820. Revenant à distance sur ce temps de captivité il admet ne pas avoir subi de vexations particulières de la part des inquisiteurs :
Lorsque je me vis enfermé dans la cellule numéro dix-sept qui est une pièce spacieuse et bien peinte, quoiqu’assez peu claire jusqu’à ce qu’on mît des vitres à une fenêtre après que je le suggérai et qu’on me servit à table vin et desserts aussitôt que je les demandai, chose que l’on ne faisait pour aucun autre prisonnier, voyant aussi que les inquisiteurs m’encourageaient à satisfaire quelque caprice puisqu’on ne refuse rien à celui qui doit être pendu, j’augurai de tout cela que j’étais destiné à incarner dans la prison inquisitoriale le nom de Perpétuelle que l’on a attribué à sa rue. Comme je ne m’étais rendu coupable d’aucun délit non seulement les inquisiteurs me traitaient avec égard mais avec affection et amitié. Je me distrayais par la lecture quoique les livres fussent rares parmi des gens qui ne s’occupaient que d’intrigues et je cultivais un jardinet qui avait été arrangé tout exprès à mon intention. Là, sous de la menthe je parvins à mettre au point une estafette à l’intérieur d’une grosse cheville pour la correspondance que j’entretenais avec d’autres prisonniers auxquels je procurais de l’encre de noix [...] Aussi puis-je dire que les inquisiteurs étaient de bonnes personnes, et que leur office était mauvais, bien qu’il s’appelât Saint Office (Mier 1944, 85-86, N. T.).
S’il est sans doute exagéré de parler de prison « cinq étoiles » comme on a pu le faire26 il n’en demeure pas moins exact que la seule prison pour laquelle nous n’avons pas connaissance d’un projet d’évasion de la part du dominicain est bien celle de l’Inquisition. Sa prochaine tentative réussie aura lieu à La Havane, mais il s’agira alors d’une prison civile. Mier avait eu le bras droit cassé au cours d’un transfert et ce n’est qu’au bout d’un an qu’il en recouvra le plein usage. Pour faire l’épreuve de sa capacité à écrire il sollicita pour la première fois auprès de ses geôliers encre et papier. En récompense de cette faveur il adressa aux inquisiteurs un sonnet satirique où il se plaignait de la lenteur de la procédure et les invitait à se réformer en modelant leur attitude sur les préceptes divins pour justifier de la sainteté de leur Office, sous peine, s’ils ne s’exécutaient pas, d’avoir à en répondre dans l’Au-delà27. Tel fut son premier essai d’écriture carcérale. Loin de châtier cette insolence les dits inquisiteurs eurent assez d’humour pour en rire, tout en haussant les épaules, manifestant ainsi leur impuissance à le satisfaire. Deux ans plus tard après l’extinction du tribunal et son déferrement dans la prison civile il improvisa un nouveau sonnet symétrique du premier adressé à ses nouveaux juges28 : en substance il y affirmait que l’abolition de l’Inquisition n’était qu’un trompe-l’œil car seuls les mots avaient changé mais les locaux et les méthodes restaient les mêmes. Une idée que reprendra à son compte Arenas en l’adaptant pour signifier le passage d’une dictature à une autre comme étant le retour de l’identique sous un ravalement de façade. De fait, à quelque temps de là, et après quelques nouvelles péripéties Mier retournerait une dernière fois entre les murs qu’il connaissait si bien de l’ancien Tribunal, désormais sous un autre vocable, pour en sortir définitivement le 23 février 1822.
On doit considérer le temps et le lieu de l’énonciation de Fray Servando, à savoir la prison inquisitoriale entre 1817 et 1820, comme étant la condition de possibilité du matériau discursif qu’il produisit alors. Cette production de circonstance n’était en rien spontanée, elle répondait à une demande de l’institution répressive qui exigeait du dominicain en tant que prévenu les éclaircissements nécessaires à l’instruction de sa cause. L’incitation au « récit de vie » faisait partie des méthodes traditionnellement employées par le Tribunal depuis ses origines. En cas d’hérésie les explications fournies pouvaient déboucher sur un aveu suivi d’une abjuration formelle pour se réconcilier avec l’Église. Mais Mier donne une tout autre justification à sa démarche autobiographique : tout simplement, s’il faut l’en croire, il aurait écrit son Apologie pour se distraire parce qu’il n’avait rien de mieux à faire dans l’Inquisition et c’est sur sa lancée qu’il aurait prolongé son Apologie par le récit de ses premières années d’exil29. Dans le texte tel qu’il nous est parvenu, à qui Mier prétend-il adresser son discours ? Il mentionne comme destinataire non pas ses seuls juges mais la postérité en général. Sa stratégie d’écriture consiste dès lors à s’efforcer de gagner la sympathie du lecteur en jouant souvent d’un registre pathétique, pour se présenter comme victime d’une injustice mais sachant aussi manier l’ironie et le mode facétieux pour ne pas lasser par ses récriminations. L’innocence persécutée et le rétablissement de l’honneur perdu s’imposent comme horizon de la narration d’un auteur en quête de réhabilitation. Mais l’écriture carcérale stricto sensu de Mier ne se limite pas au temps passé dans l’Inquisition, elle se prolonge au cours de son séjour dans la forteresse de San Juan de Ulúa avec des conditions d’emprisonnement qui, selon lui, se dégradent dans un premier temps.
On doit préciser que L’Apologie, qui comportait soixante plis, avait été prêtée aux inquisiteurs José Antonio Tirado y Priego et José María Bucheli y Velázquez (1754-1837) qui ne voulurent jamais la lui rendre. De même, sept cahiers de sa correspondance, d’ailleurs apocryphe, avec le cosmographe royal Juan Bautista Muñoz (1745-1799) disparurent-ils au moment de son changement de résidence. C’est bien là le principal grief que fray Servando adresse aux inquisiteurs : la confiscation puis la non restitution de ses précieux documents. C’est en vain qu’il les réclamera30. Les manuscrits demeurèrent invisibles pendant quarante-cinq ans, jusqu’à ce qu’un romancier populaire d’idéologie libérale, Manuel Payno (1810-1894), les exhume partiellement pour en publier des extraits en donnant à sa sélection une coloration romantique31. Si Mier reprend la plume c’est donc d’abord parce qu’il n’est pas du tout assuré de retrouver un jour sa propriété intellectuelle.32 Faute d’avoir cette garantie il rédige le texte connu comme Manifeste apologétique (Mier, 1944, 26-168) qui s’apparente davantage à un brouillon d’une centaine de pages qu’à une œuvre littéraire proprement dite. Ce que le texte perd en qualité de polissage il le gagne par une plus grande liberté de ton, Mier étant désormais dégagé du difficile compromis qui le liait aux inquisiteurs qui, rappelons-le, étaient aussi ses premiers lecteurs. Pas plus que les Mémoires cet écrit ne sera jamais publié du vivant de Fray Servando et il restera inédit jusqu’en 1944. Ses premiers éditeurs J. M. Miquel i Vergès (1903-1964) et Hugo Diaz-Thomé font observer dans leur introduction qu’à la différence de l’Apologie, le Manifeste atteint à une plus grande précision mais se caractérise aussi par un ego démesuré (Mier 1944, 14-21). Il répond en effet à une double fonction : d’une part la reconstitution des étapes de sa carrière d’exilé qui obéit toujours à une volonté de réhabilitation de soi et d’autre part à une projection dans l’avenir comme protagoniste du processus indépendantiste de la Nouvelle Espagne. Au mois de septembre 1820, Mier présume que son incarcération ne durera que quelques mois. Alors c’est la plume du pamphlétaire qui prend le dessus et même si le dominicain n’est pas encore clairement rallié au républicanisme, la monarchie espagnole et naturellement l’Inquisition en font tous les frais. Sa situation carcérale se prolongeant plus qu’il ne l’escomptait, il rédige des Réponses et Représentations (Mier, 1944, 169-206) qui sont autant de lettres justificatives ou de protestation adressées aux autorités parmi lesquelles le vice-roi Juan José Ruiz de Apodaca (1754-1835).
À la différence du Manifeste et des Représentations, les autres écrits politiques produits à la forteresse de Ulúa ou à la Havane, en particulier Une idée de la Constitution (Mier, 1944, 229) et sa Lettre d’Adieu aux Mexicains, avaient vocation à être divulgués auprès d’un large public. Il faut bien admettre que Fray Servando sut exploiter habilement son emprisonnement par l’Inquisition, non pas tant à des fins publicitaires et d’autopromotion qu’au service de la cause indépendantiste qu’il avait épousée. Dans le discours qu’il prononça le 15 juillet 1822 au moment d’être investi comme député du Nouveau Leon par le premier congrès de l’Assemblée Constituante, il rappelait une fois de plus la persécution dont il avait été l’objet : « Dans l’Inquisition où j’ai été enterré pendant trois ans, j’ai écrit ma vie, en cent plis je crois, en commençant par mon sermon de 1794, jusqu’à mon entrée au Portugal en 1805… » (Mier, 2013, 425-426). Cependant dans ses Mémoires, il reconnait que sa détention avait des motifs strictement politiques et que le mobile religieux n’était qu’un prétexte, c’est pourquoi il contestera toujours la compétence des juridictions vice-royale et inquisitoriale auxquelles il sera successivement confronté. Si ses écrits historiques et politiques sont demeurés sous son contrôle et en font incontestablement un précurseur du mouvement indépendantiste, c’est à ses Mémoires, écrits dans le Saint-Office mexicain et qui, en revanche, lui ont entièrement échappé sans qu’il ne puisse jamais en réviser le texte, qu’il doit sa réputation d’écrivain. Une réputation littéraire réévaluée à la hausse au XXe siècle. Si on laisse de côté l’Apologie qui est d’abord un plaidoyer visant à le rétablir dans son honneur, la deuxième partie, qui relate ses errances à travers l’Europe avec toutes leurs péripéties, s’apparente à la fois à un roman d’aventures, mêlant la fiction et d’authentiques rencontres avec des personnages historiques, et à un récit de voyage « sentimental » au temps des guerres napoléoniennes.
Mais Mier, homme de lettres longtemps méconnu, c’est aussi une écriture et un style subversif. Avec une verve picaresque qui ménage toute sa place à l’oralité, à la création verbale et aux formes colloquiales, le code linguistique est détourné comme un défi à l’idéologie dominante, celle des aréopages de la vice-royauté et de la couronne espagnole. Les inquisiteurs ne sont plus des serviteurs de l’Église mais des agents d’un pouvoir oppressif qui voient leurs pratiques tournées en dérision par le recours à des expressions populaires. Ainsi parle-t-il de «la fritanga » autrement dit la friture pour se référer au bûcher de l’Inquisition (Mier, 2006, 252) qu’il déplore par ailleurs car il considère qu’il faut « plaindre et non point frire » le malheureux qui n’a pas la foi. (Mier, 1944, 89). Pratiquant le néologisme macaronique il invente le « totilimundi-inquisitorio » (ibidem, 92) pour désigner le grand théâtre de marionnettes de l’Inquisition. On relève en permanence une démystification de la terminologie officielle. La tentative de renvoyer à l’Inquisition la cause du sermon de Guadalupe est qualifiée « d’énorme bourde » (Mier 1946, I, 109). L’inquisiteur devient « el mentecatísimo inquisidor » (Mier 1944, 66) soit ce « triple idiot d’inquisiteur » encore désigné comme « théologien-péripatéticien-scholastico-hypothético-conséquentiaire-hérétificateur-calomniateur-du-prochain-et-abuseur-du-peuple » (Mier 1944, 92). L’autodérision est aussi bien présente pour évoquer le châtiment subi dans sa propre chair, ce qui passe par la réification de sa propre personne : « je fus de nouveau archivé à la prison de Las Caldas comme un vieux codex égaré ». En adoptant les analyses de Bakhtine, Andrea Pagni résume bien ces techniques : « Les trois mécanismes de subversion du langage autoritaire : l’inclusion de formes orales, la caricature, le démasquage de l’hypocrisie du langage officiel sont autant de manifestations de la carnavalisation du langage. » (Pagni 150, N.T.). Autant de traits qui seront répliqués et amplifiés par Arenas en particulier l’anecdote concernant les rats dans la prison du couvent de Las Caldas, restée assez sommaire chez Mier comme on peut en juger ici :
Au bout de trois jours, bien que la sentence de l’archevêque n’ordonnât rien de plus que ma réclusion au couvent on me retint prisonnier dans une cellule, d’où on ne me tirait que pour me conduire au chœur ou au réfectoire. Et les rats auraient aussi bien pu m’y suivre en procession tant ils étaient nombreux et gros. Au point qu’ils dévorèrent mon chapeau et j’étais obligé de m’armer d’un bâton pour dormir afin qu’ils ne me mangent pas (Mier 2013, 72, N.T.).
Les errances d’une momie vagabonde
En 1861 après l’entrée de Benito Juárez (1806-1872) dans la ville de México et la fin des guerres dites de la Réforme, des lois de sécularisation des biens du Clergé sont mises en œuvre. C’est ainsi que lors des travaux de démolition et de terrassement du couvent des Dominicains, treize corps en parfait état de conservation sont mis au jour. Aussitôt la presse libérale, en particulier El Monitor Republicano, s’empare du sujet et lui donne une tournure sensationnaliste. Deux articles en dates des 20 et 21 février expliquent qu’au vu des attitudes des dépouilles exhumées, dont les traits convulsés portent la marque des souffrances endurées dans les spasmes de l’agonie, il y a tout lieu de penser qu’on est en présence de victimes de l’Inquisition, probablement emmurées vivantes.
La réplique ne se fait pas attendre : le journal conservateur el Pájaro verde, offre une tribune à un vieux dominicain le Révérend Père Tomás Sámano qui dénonce le vandalisme des révolutionnaires violeurs de sépulture. Par la même occasion il révèle que parmi les restes funèbres, figure la momie de Fray Servando Teresa de Mier dont le souvenir dans la mémoire nationale s’est largement estompé pour ne pas dire entièrement dissipé. S’ensuit une expertise scientifique commise à un médecin légiste, le docteur Orellana, qui fait rapidement justice de la fable inquisitoriale. Procédant avec méthode, il livre au public les résultats de l’autopsie sous la forme d’une plaquette anonyme très accrocheuse parce qu’assortie des treize lithographies des cadavres. Identifiée, fichée et dûment étiquetée, chaque momie trouve sa place dans un sinistre album de famille.
Cette notice va attirer l’attention d’un écrivain libéral, romancier et historien à ses heures : Manuel Payno dont on peut dire qu’il est le révélateur de Mier écrivain. En effet il devient en 1865 le premier éditeur d’un choix de textes qui ne portent pas encore le titre de Mémoires et qu’il complète avec d’autres écrits autobiographiques pimentés d’anecdotes et de commentaires piquants. Peu de temps auparavant, Manuel Payno venait de faire lui-même l’expérience de la prison pour des motifs politiques, tout comme Mier à San Juan de Ulúa. Anticipant assez curieusement sur l’empathie dont ferait preuve un siècle plus tard Arenas à l’égard du religieux il avertit : « Ces lignes tracées naïvement et dont le Dr. Mier n’aurait jamais imaginé qu’elles pussent être imprimées, n’ont de la valeur, et ne peuvent être comprises que par ceux qui ont passé des heures éternelles au milieu du silence d’une prison » (N.T.)33.
Fray Servando aurait-il été en définitive la victime du cannibalisme nécrophage de ses frères en religion ? Plus sérieusement le doute demeure sur les déambulations et autres pérégrinations post mortem du dominicain. Payno, au moins par le choix de ses formules, est le principal artisan et propagateur de la légende de la momie itinérante. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : un nouveau rebondissement, digne du Grand-Guignol, se prépare. Une décennie plus tard, en 1882, El monitor Republicano publie un reportage d’un de ses correspondants à Bruxelles, rédigé à l’occasion des fêtes commémoratives en l’honneur du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la Belgique. Celui-ci rapporte avoir pénétré dans un baraquement du Boulevard du Midi, dont l’enseigne affichait le nom pompeux de « Grand Panoptique de l’Inquisition ». Le propriétaire des lieux, paré du titre de docteur mais authentique charlatan, avait organisé un cabinet des horreurs autour de quatre momies réputées provenir du couvent des Dominicains de México. Chacune des enveloppes funéraires ainsi exhibées était munie d’un écriteau censé caractériser le genre de supplice que l’Inquisition lui avait infligé : l’eau, le feu, la roue et la poire d’angoisse. Rien ne permet d’affirmer avec certitude que parmi celles-ci se trouvait la dépouille de Fray Servando et s’en persuader relève de l’acte de foi. Néanmoins, près d’un siècle et demi plus tard, cet épisode de vagabondage posthume devait suffisamment impressionner un jeune écrivain cubain déjà très prometteur pour qu’il en tire l’épilogue du roman qu’il consacrait alors à celui avec qui il devait finir par s’identifier.
La lune et le caudillo
(Ce titre est emprunté à l’ouvrage de Jeannine Verdès-Leroux La lune et le Caudillo : le rêve des intellectuels et le régime cubain, (1959-1971), Paris, Gallimard,1989. Dans sa correspondance avec les Camacho Arenas fait part de la satisfaction que lui a procurée la lecture de ce livre peu de temps avant sa mort. (Arenas 2009, 262))
Reinaldo Arenas, lorsqu’il entreprend d’écrire Le Monde hallucinant en 1965, n’est que le dernier maillon d’une chaîne de transmission, inaugurée un siècle auparavant par Manuel Payno, poursuivie en 1876 par José Eleuterio Gonzalez (1813-1888) et surtout parachevée en 1917 par Alfonso Reyes (1889-1959) qui est à proprement parler l’inventeur des Mémoires de Mier dans la mesure où en réunissant deux textes somme toute hétérogènes : l’Apologie et la Relation sous cette appellation unique il a donné l’illusion d’en faire un tout organique. Arenas s’inscrit donc dans cette chaîne qui participe à la fois de l’histoire authentique et de l’affabulation littéraire. Il est aussi celui qui va donner un nouveau lustre à la figure du dominicain qui s’était quelque peu estompée dans la mémoire nationale mexicaine et qui, grâce à sa plume, va bénéficier d’un regain d’intérêt.
Il convient de retracer ici les principales étapes de la trajectoire personnelle d’Arenas qui, à l’instar du moine apostat, laissa une autobiographie romanesque, de publication également posthume : Avant la nuit. Tout commence par une première fuite ou fugue (la famille comme prison ?) d’un jeune guajiro de quinze ans qui, au milieu de la nuit, part rejoindre dans la Sierra Maestra les maquisards soulevés contre la dictature de Fulgencio Batista (1901-1973). Après la victoire, le révolutionnaire en herbe bénéficie d’une bourse de l’État, il s’oriente vers des études d’agronomie mais se distingue surtout dans des concours littéraires. Une fois son talent précoce reconnu, l’enfant chéri des lettres cubaines est promu à un poste de bibliothécaire où il peut assouvir sa passion pour la lecture et l’écriture. Mais c’est une autre passion, celle des garçons, qui, une fois assumée au grand jour, va le mettre en porte-à-faux par rapport à l’idéologie homophobe du nouveau régime qui exalte « l’homme nouveau » et exclut le déviant qu’il faut « paramétrer », dans le jargon du pouvoir, autrement dit rééduquer en l’expédiant dans une UMAP34. Certes, comme l’affirme l’une des biographes les plus autorisées d’Arenas, il est malaisé de déterminer « à quel moment il devient critique vis-à-vis du nouveau pouvoir, à quel moment il en devient victime » (Hasson 2007, 91). Une chose est certaine, refusant de pratiquer l’autocensure et pressentant que sa carrière d’écrivain allait être entravée, il franchit un pas décisif en se faisant publier en France puis au Mexique sans autorisation35. Si la réception de son œuvre à l’étranger est un succès, il fait dès lors l’objet d’une surveillance constante par les services de la Sûreté de l’État et finira par être marginalisé dans son propre pays.
Avant cela, en 1970, il est mobilisé comme l’ensemble de la société cubaine pour aller couper de la canne à sucre à la Centrale Manuel Sanguily à Pinar del Río dans le cadre de la grande récolte (Zafra) des dix millions de tonnes. Le désastre économique qui s’ensuit lui permet de prendre la mesure du tropisme totalitaire de l’État cubain et est à l’origine de sa prise de conscience des souffrances des esclaves aux temps de la traite négrière. Il en tirera un chant de révolte contre les exigences du Grand Cacique et ce sera l’hymne qui ouvre le recueil La Plantation, publié dix ans plus tard, mais dont l’écriture clandestine a commencé sur place et sans délai. Et Arenas tient à le faire savoir. C’est pourquoi il date son texte du mois de mai, fournit un luxe de précisions pour localiser la plantation sucrière et surtout dans sa dédicace : « Pour mon cher R. qui m’offrit 87 feuilles blanches », il remercie Reinaldo Garcia Ramos qui lui a fourni l’indispensable matériel pour écrire (Arenas 2005, 120-121).
Après cet échec dans les années soixante-dix commence ce que d’aucuns ont appelé le « quinquennat gris » du régime qui se caractérise par des lois répressives et une recrudescence de la censure avec comme point d’orgue le procès intenté à Heberto Padilla (1932-2000), ancien soutien de la Révolution, tombé en disgrâce depuis la parution d’un recueil de poésies critiques : « Fuera del juego ». Emprisonné en mars 1971, il est contraint à une rétractation publique devant des caméras. Cette autocritique entrainera l’amorce d’une prise de distance de l’intelligentsia progressiste vis-à-vis du castrisme. Le poète est détenu une quarantaine de jours dans la Villa Marista, une ancienne école transformée en prison pour y regrouper les « asociaux ». L’établissement dépendant de l’agence de la sûreté intérieure cubaine est aussi un lieu d’interrogatoire musclé. Des années plus tard, Arenas qui a succédé à Padilla derrière ces murs, évoquera le cas dans une chronique vengeresse dénonçant les méthodes inquisitoriales du système et faisant de Padilla un nouveau Galilée soumis à une abjuration dont la grossièreté aurait répugné à Torquemada lui-même36. Pour l’heure, Arenas, continue vainement une activité semi-clandestine d’écrivain impubliable dans l’île et c’est au cours de cette période qu’a lieu son arrestation au mois de juin 197437 sous le chef d’accusation de corruption de mineurs. Un délit de droit commun qui allait le conduire à l’incarcération dans la prison de Guanabacoa dont l’expérience serait, selon lui, mais cela a été discuté, à l’origine du recueil de poésie intitulé Leprosorio38. De toute évidence on est en présence d’une machination policière qui a pour but de donner une leçon au dissident tout en évitant le procès politique qui pourrait avoir un retentissement international contreproductif comme l’avait été l’affaire Padilla. Mais, en bon émule de Fray Servando, le cubain n’entend pas se soumettre et prend la fuite du commissariat où il était interrogé. C’est le début d’une cavale qui va durer quarante-cinq jours et dont les péripéties rocambolesques sont narrées dans le chapitre de ses Mémoires intitulé : « l’évasion ». Toutes ses tentatives pour s’enfuir de Cuba sont vouées à l’échec : que ce soit comme balsero avec une chambre à air en guise d’embarcation de fortune, que ce soit en essayant de rallier la base américaine de Guantanamo qui n’incluait pas encore le camp de détention qui lui vaudrait sa sinistre réputation à partir de 2002, que ce soit avec l’aide de complicités extérieures, rien n’y fait et il doit se résigner à trouver refuge dans les égouts du Parc Lénine. C’est là qu’il aurait commencé à écrire ses Mémoires si l’on en croit ceux-ci, en prévision de sa capture imminente et dans la crainte d’être expédié à la prison de La Cabaña où avaient eu lieu des exécutions sommaires au début de la Révolution :
C’est là que j’ai commencé à écrire mes Mémoires, sur les carnets que Juan m’apportait. Sous le titre évocateur de : Avant la nuit, j’écrivais jusqu'au coucher du soleil dans l'attente de la nuit qui me guettait quand la police me trouverait. Je devais me dépêcher d’en finir avant qu’il ne fasse sombre, définitivement, pour moi ; avant que je ne sois enfermé dans une cellule. Bien entendu, ce manuscrit fut perdu comme la plupart de ceux que j’avais écrits à Cuba jusque-là et que je n’avais pas réussi à faire passer à l'étranger, mais à l’époque c'était un réconfort de tout raconter ; c’était une façon de rester parmi mes amis quand je ne serais plus parmi eux […] moi je savais, qu’une fois là-bas [la prison de La Cabaña] je ne pourrai plus écrire (Arenas 2000, 254-255).
Une écriture carcérale paradoxalement à ciel ouvert et produite dans l’urgence, on est apparemment bien loin de l’écriture confinée, telle que l’avait connue Fray Servando avec peut-être toute une bibliothèque à sa disposition39. A noter que si les inquisiteurs confisquèrent les manuscrits autographes de Fray Servando, les agents de la Sûreté d’État en firent autant pour les Mémoires d’Arenas encore à un stade embryonnaire et qui s’ils n’ont été détruits doivent dormir dans un placard du régime. Il est à remarquer aussi que tout comme le dominicain en son temps avait aménagé une boîte à lettres dans son jardinet pour correspondre avec d’autres détenus de l’Inquisition, Reinaldo aura recours à un subterfuge analogue pour obtenir de ses amis qu’ils lui apportent de la littérature, et en particulier un exemplaire de l’Iliade d’Homère qu’il pourra continuer à lire jusque dans la prison du Morro. Car c’est en définitive dans cette forteresse coloniale où avant lui avait séjourné Servando Mier qu’il sera transféré dans l’attente d’être jugé après son inévitable capture, survenue le 9 décembre 1974.
Le chapitre intitulé : « la prison »40 relate la violence de cette épreuve dans un environnement de délinquants. Dans cet univers il apprend que la fonction des livres est ramenée à une pure matérialité scatologique indépendante du texte. Mais contrairement à ses prévisions il parvient à se procurer quelques feuilles de papier et des crayons pour écrire, mais pour un usage non littéraire puisqu’il s’agira dans un premier temps de donner des cours de français et par la suite de servir de scribe à ses codétenus :
Mais avec le temps, comme tout finit par se savoir, on a su que j’étais écrivain. J’ignore quelle signification ces prisonniers de droit commun ont donnée au mot écrivain, mais désormais ils sont venus nombreux pour me demander d’écrire des lettres d’amour pour leurs petites amies, ou le courrier pour leur famille. J’ai donc organisé une espèce de bureau dans mon dortoir, où tout le monde affluait pour se faire rédiger des lettres ; [...] je suis devenu le fiancé ou le mari littéraire de tous les bagnards du Morro (275).
On l’aura compris Arenas, placé sous écrou, revendique sa condition d’écrivain mais il s’abstient d’écrire quoi que ce soit qui puisse être assimilable à une œuvre d’art, soit que les conditions ne le lui permettent pas, soit que cette abstention textuelle relève du même principe que son abstinence sexuelle : « Je n’ai pas eu de relations sexuelles en prison; non seulement par précaution, mais parce que cela n’avait pas de sens; l’amour est libre et la prison est une chose monstrueuse où l’amour prend une tournure bestiale » (274). On verra néanmoins une pièce littéraire faire exception à cette règle. C’est dans ce temps de captivité que s’inscrit la douloureuse parenthèse que constitue le passage obligé par la Villa Marista. Une étape à laquelle il consacre un nouveau chapitre de ses Mémoires, chapitre placé aussitôt sous le signe de l’Inquisition41 :
Nous sommes arrivés à la Villa Marista, siège central de la Sûreté de l’État […] je voyais en passant de petites cellules avec une ampoule au plafond ; allumée jour et nuit au-dessus de la tête du prisonnier ; j’ai compris que c’était une geôle encore plus atroce que celle de l’Inquisition […] Je compris à ce moment-là à quoi servait le tuyau placé dans ma cellule près du water et dont j’ignorais l’usage ; c’était le conduit par lequel on diffusait de la vapeur dans les cellules qui, fermées hermétiquement, se transformaient en bains de vapeur. Diffuser cette vapeur c’était comme infliger la question, une pratique inquisitoriale, pareille à celle du feu (292-295).
L’enjeu de ces pratiques inquisitoriales de torture ou d’intimidation était l’aveu pour obtenir cette rétractation à laquelle avait dû se plier Fray Servando après son sermon et à laquelle Reinaldo ne pourra non plus échapper. Si l’on en croit son témoignage il ne s’agissait pas d’apposer une signature au bas d’un document prérempli mais d’une véritable rédaction mêlant confession et engagement, en somme une écriture carcérale contrainte. Comme l’observe une critique (Manzoni,160), cette confession est une mise en abyme de l’acte autobiographique à l’intérieur de l’autobiographie :
Quand j’ai déclaré à l’officier que j’étais disposé à rédiger l’aveu, c’est lui-même qui m’a tendu papier et crayon. Mon aveu fut long ; j’y évoquais ma vie et ma condition homosexuelle, que je reniais, le fait de m’être transformé en contre-révolutionnaire, mes faiblesses idéologiques et ces maudits livres que je ne récrirais plus jamais (296-297).
En reconnaissant son diversionisme idéologique et en s’engageant à renoncer à sa conduite inappropriée42, Arenas se donnait le droit d’accéder à un programme de réhabilitation. De fait, à l’issue de son procès, où il ne fut condamné que pour scandale public, il réintégra la forteresse du Morro puis fut envoyé à la prison « ouverte » du District Flores où il était supposé se réformer par le travail.
Lorsqu’intervient sa remise en liberté au mois de janvier 1976, commence le temps de l’invisibilité sociale et de l’ostracisme qui, malgré un prestige acquis dans des milieux dissidents, le conforte dans sa volonté de s’expatrier. Cuba tout entière est désormais devenue l’île-prison dont il cherche à s’évader. L’occasion lui en sera donnée au moment de l’exode de Mariel lorsque le régime, suite à un incident survenu à l’ambassade du Pérou, finit par accorder leur départ vers La Floride à quelque 125 000 indésirables entre avril et octobre 1980. Reinaldo arrive sur le sol étasunien le 6 mai. S’ouvre alors pour lui une dernière décennie où, dans l’exil new-yorkais, à l’euphorie initiale due à la liberté de mouvement retrouvée et à la reconnaissance des mérites de son œuvre enfin publiée, succède une forme de désenchantement. Le conservatisme et le catholicisme puritain de la diaspora cubaine à Miami ne lui conviennent guère, pas plus qu’il ne se reconnait dans la tendance à la ghettoïsation du milieu gay de Manhattan, une tendance qui ne fera que s’accentuer avec l’épidémie de Sida qui s’annonce. Malgré cette désillusion, la polémique menée contre le régime castriste et ses thuriféraires ne cesse pas pour autant et la figure de Fray Servando, jamais entièrement oubliée, continue à être mise à contribution.
Hallucinations et polémiques cubaines
Arenas était donc un des écrivains parmi les plus novateurs de sa génération, lorsqu’il procura une pseudo-biographie ébouriffante du turbulent ecclésiastique qu’il présente d’abord comme un impénitent globetrotteur avant d’en faire une « infatigable victime ». Loin de méconnaitre sa dette envers les Mémoires de Fray Servando comme source de sa propre narration il en revendique expressément la filiation. Bien mieux, dès la lettre préface qu’il adresse à son personnage et qui fonctionne comme un protocole de lecture, il expose comment il a fait sa connaissance, les bibliothèques qu’il a fréquentées et les recherches érudites auxquelles il s’est livré, pour aboutir à ce constat qui fait du moine son véritable alter-ego :
Mais, même si j’ai réussi en fin de compte à réunir un volumineux matériel de documentation sur ta vie, ce qui m’a été le plus utile pour parvenir à te connaître, ce ne furent pas les encyclopédies, harassantes et toujours trop précises, ni les terribles livres d’essayistes, toujours trop inexacts ; non ce qui m’a été le plus utile, ce fut de découvrir que toi et moi nous sommes la même personne. D’où il résulte que toute référence antérieure à cette découverte horrible et formidable m’est apparue superflue, et, ces références, je les ai éliminées presque entièrement. Seuls tes Mémoires, écrits entre la menace du bûcher et celle des [rats43] affairés et voraces, entre les coups de canon de la flotte royale anglaise et les tintements de sonnailles des mulets des paysages espagnols, à jamais intolérables, entre la désolation et l’exaltation, entre une fureur justifiée et un optimisme injustifié, entre la tristesse et l’ironie consolatrice, entre la rébellion et l’exil, seuls tes Mémoires sont entrés dans ce livre […]. Et cela suffit à quelques-uns pour considérer que ce livre est digne de censure (Arenas 2002, 9-10).
Une problématique de l’identité se trouve ainsi de prime abord au cœur du dispositif narratif, dans la construction du personnage de Fray Servando et ce, avant même que le processus d’identification ne se fasse jour avec l’appropriation de la trajectoire vitale de Mier. L’enfance du personnage référentiel étant peu documentée44, celle de Servando se présente comme étant un écho de celle de Celestino, un personnage à forte indexation autobiographique, héros du premier roman d’Arenas45. Dès le début on note avec Gabriela Febles (2015, 166) une inflexion des données biographiques qui tend à la victimisation précoce et souligne une prédisposition du sujet à la rébellion. Une des particularités du Monde hallucinant consiste en une fragmentation de l’instance narrative, aisément identifiable avec le principal protagoniste, mais assumée par trois personnes grammaticales distinctes. Celles-ci échangent leurs points de vue souvent contradictoires sur les épisodes relatés, ce perspectivisme et cette polyphonie aboutissant à un effet de brouillage et de ventriloquie qui n’est pas sans dérouter le lecteur. Cette déstabilisation voulue qui, à première vue, peut sembler une originalité, ne l’est en fait que partiellement. Dans ses Mémoires, le dominicain se livrait déjà à un petit jeu de manipulation assez semblable quoique moins systématique, ce que le lecteur non informé peut difficilement percevoir de prime abord. Au cours de ces dernières décennies, la recréation parodique à l’œuvre dans le Monde hallucinant et les intertextualités qu’elle implique (Jara 219-235), faisant des Mémoires de Mier une sorte de palimpseste excentrique, mêlant remplois et citations directes et ne reculant devant aucune hyperbole caricaturale, ont fait l’objet de bien des études auxquelles on ne peut que renvoyer. De même la dimension dialogique et carnavalesque du texte d’Arenas au sens bakhtinien du terme, avec ses masques rhétoriques, ses accents de Satire Ménippée transposables de la Révolution française à la Révolution cubaine puis extensibles à toute utopie révolutionnaire ont été suffisamment mis en lumière pour qu’il soit besoin d’y revenir. Ce travail de réécriture comportait à l’évidence une dimension polémique anticastriste, certes encore feutrée et en filigrane, mais reposant sur des clés de lecture suffisamment transparentes pour en rendre douteuse l’acceptabilité par le pouvoir.
De son propre aveu, Arenas n’avait lu dans un premier temps que le premier tome des Mémoires de Mier sans doute dans l’édition Porrúa avec une introduction d’Antonio Castro Leal (1896-1981) et il avait complété son information avec les notes de Vito Alessio Robles46 (1879-1957) et surtout la biographie romancée (1933) de Valle-Arizpe (1884-1961). Ce dernier paraphrasant l’épisode des rats en exagérait déjà l’importance :
On le jeta dans un cachot sombre et humide, où il y avait tant de rats faméliques qu’ils mangèrent son chapeau. Et ils guettaient constamment avec l’immobilité féroce de leurs yeux noirs la moindre distraction de sa part pour se jeter sur lui en troupeaux affamés. Il devait être armé d’un bâton, les effrayer sans cesse afin qu’ils ne se rassemblent pas pour se rassasier de ses chairs et c’est ainsi, en permanence sous la menace de ces animaux qu’il écrivait des lettres et toujours plus de lettres qu’il adressait à Madrid […] (Valle-Arizpe 66, N.T.)
Mais cela était sans commune mesure avec l’amplification à laquelle devait se livrer Arenas au chapitre intitulé : « De ton emprisonnement à Cadix avec les chaldéens de Las Caldas ». Non seulement les rats y sont omniprésents mais ils parlent ou plutôt vocifèrent en insultant le prisonnier. Le seul avantage de leur présence c’est que pour écrire ses suppliques le moine peut compter sur leurs yeux qui, la nuit, jettent des étincelles, suppléant ainsi à l’absence de chandelle. C’est alors que Francisco Antonio de Leon, son persécuteur inquisiteur, qui est aussi le maître des rats, sinon un rat lui-même, lui annonce sa condamnation à une réclusion de dix ans. S’ensuit un déchaînement de violence dans un espace saturé par les rongeurs et où le dominicain, sur le point d’être dévoré, ne doit son salut qu’à l’intervention d’un autre religieux. Celui-ci, qui est aussi quelque part son double, lui montre comment il doit s’y prendre pour tenir à distance les animaux voraces en croquant tout vif un beau spécimen et lui explique :
Ne croyez pas me, dit-il, après avoir englouti l’animal que ma faim soit telle que j’en sois réduit à cette extrémité. Je le fais pour montrer à ces bêtes quels sont les animaux qui mangent les autres. Faites-en autant et vous verrez qu’elles ne vous ennuieront plus. Vous échangerez ainsi votre condition de victime contre celle d’agresseur (Arenas 2002, 68-69).
Les transformations délirantes se succèdent en cascade tandis que les rats prennent leur revanche sur le visiteur en l’assimilant à leur tour :
Les rats font une sortie triomphante et s’emparent des morceaux. Chaque morceau du moine avait ses cris à lui ; de sorte qu’on put entendre pendant quelques instants une harmonie de cris ; rauques, stridents, désaccordés et hallucinants. Mais la faim fit engloutir aux animaux cette viande criarde, et leur estomac s’emplit de résonances (74).
Alors que Servando cherche vainement une issue par où s’enfuir, le frère visiteur ne tarde pas à ressusciter, passant du simple statut de double au stade de la plus complète fusion avec son interlocuteur. Puis, ultime métamorphose, un rat-moine met en garde Servando contre le sort funeste qui l’attend s’il ne s’échappe au plus vite : « Va-t’en me dit le rat changé en moine en me tutoyant, j’ai eu vent que Leon veut t’expédier au bûcher […] maintenant c’est le moment ou jamais de te jeter par la fenêtre » (77). Ce sera bientôt chose faite mais avec l’aide d’un parapluie qui se transforme en une sorte de fantastique aéronef.
Une des séquences les plus représentatives de la technique hyperbolique d’Arenas se trouve au chapitre vingt-quatre : « Qui traite de la prison de los Toribios et de l’enchaînement du frère » (177). Les geôliers y redoutent à ce point une nouvelle évasion de leur hôte qu’ils multiplient les liens de toutes dimensions, entourent de minichaines chacun de ses cils, attachent le plus petit de ses poils, les follicules de ses cheveux et jusqu’à ses testicules. Tout cela en vain car ils ne parviennent pas à emprisonner l’esprit rebelle du religieux qui ne cesse de s’enfuir en imagination. Le poids des chaînes atteint une telle proportion que la cellule elle-même finit par s’effondrer, rendant sa liberté à l’indomptable. On observe par ailleurs une surenchère dans la place dévolue à l’Inquisition dont le rôle dans le roman d’Arenas parait surdimensionné y compris par rapport à l’hypotexte que constituent les Mémoires du padre Mier. Ainsi au chapitre trois, à peine arrivé à Mexico, le frère assiste-t-il à un gigantesque autodafé dans une ville où « les bûchers flambaient nuit et jour à l’extrémité de chaque rue, de sorte que la chaleur et la suie ne cessaient jamais dans cette ville et devenaient insoutenables les jours d’été » (23). L’une des victimes qui tient la vedette de ce qui est aussi un spectacle populaire, est condamnée à périr pour l’absurde et futile motif de s’être refusée à l’extraction d’une de ses dents pour complaire à un caprice de la vice-reine. Exagération et démesure, outrance baroque et satire sont bien au rendez-vous, ce qui n’est nullement incompatible avec une intention sérieuse. À la fin du périple du moine, Arenas ne s’épargne pas lui-même, usant de l’artifice d’une vision censée être prémonitoire : « Il y avait les flammes et au milieu des flammes quelqu’un qui racontait la vie du frère » (262). Une forme de métafiction qui lui permet de s’inclure subrepticement au cœur d’un bûcher inquisitorial. La crémation allégorique restera une de ses figures de style favorites qui accompagnera jusqu’au bout la rhétorique victimaire d’Arenas : « Pauvre de moi il y a tant de gens sur cette Terre qui seraient prêts à m’envoyer brûler sur le bûcher. Heureusement j’ai prévu de mourir à la fin de l’année. » écrivait-il encore aux Camacho, le 4 juin 1990, (Arenas 2009, 285). En conclusion du roman, ne pouvait manquer l’exhibition finale de la dépouille momifiée du dominicain dans des cirques argentin et belge où elle avait reçu l’estampille de victime de l’Inquisition, ce qui en faisait le principal l’attrait (Arenas 2002, 273).
D’une certaine manière on pourrait dire que, dans leur trajectoire respective, le roman d’Arenas, parce que transgressif à l’égard de l’idéologie officielle, a joué le même rôle que celui tenu par le fameux sermon hétérodoxe de Guadalupe, prononcé en chaire par Fray Servando. Dans les deux cas il s’agissait du début d’une persécution à venir qui devait les conduire de l’ostracisme à la prison puis à l’exil. Au cours d’un entretien à Paris le 14 mai 1987 Arenas, considérait lui-même que tous ses malheurs jusqu’à son emprisonnement découlèrent de ce péché originel que fut la publication en France de son roman exfiltré clandestinement de l’île sans l’aval des autorités cubaines47. De fait, dès 1980 au début de son exil aux Etats-Unis, au cours d’un de ses tous premiers entretiens, publié dans une revue littéraire, il n’hésitait pas à faire un rapprochement entre ses propres souffrances et celles éprouvées en son temps par le moine sulfureux. D’un autre point de vue, c’est ce qu’il interprétait comme étant les pratiques transgressives d’un rebelle à contre-courant de la doxa dominante qui suscitait son intérêt voire sa fascination comme il s’en expliquait au cours d’une autre entrevue publiée au mois de mars 1982 :
Mon attention a été très attirée par ce religieux qui traversait à pied toute l’Europe poursuivi par l’Inquisition. J’ai découvert que c’était un personnage touché par la grandeur et la rébellion, qu’il avait le don d’être persécuté, précisément parce qu’il était cet incessant rebelle. Finalement, Fray Servando s’est emparé de moi et m’a un peu obligé à écrire ce roman (Molinero 20, N.T.).
L’image du « rebelle romantique », probablement héritée de la lecture de Lezama Lima, a pu être renforcée par le concours du poète Virgilio Piñera (1912-1977) qui avait participé à la révision du manuscrit Du monde hallucinant. Par-delà ces analogies, la communauté de dissidence n’a sans doute pas été étrangère à l’intérêt manifesté par l’écrivain cubain à l’égard de cet autre réprouvé dont l’anticonformisme le séduisait comme un double narcissique. Au cours de la même interview, précisant ses intentions, il déclarait : « Je voulais d’une façon presque allégorique donner une certaine vision de l’époque actuelle » (Ibid. N.T.). Dans un autre entretien, accordé le 8 septembre 1981 et demeuré longtemps inédit, il comparait les pratiques inquisitoriales du passé à celles qui prévalaient désormais à Cuba : « je me souviens toujours d’avoir travaillé comme assistant littéraire de José Gamejo pour une adaptation théâtrale de la Célestine et comment ce qui en son temps, en 1499, n’avait été ni supprimé ni expurgé par l’Inquisition, fut bel et bien mutilé à Cuba, où l’œuvre fut finalement interdite. » (Torres Fierro 1993, 50, N.T.).
Le 15 avril 1982, participant à un séminaire enregistré sur le roman latino-américain, il y était interrogé sur la genèse de son roman qu’il faisait remonter à 1964 époque où il se documentait sur la carrière du dominicain dont il ignorait tout. D’entrée de jeu il soulignait auprès du public la coïncidence entre cette époque et le temps où évoluait le religieux mais le parallèle esquissé valait autant sur le plan personnel que sur le plan politique :
C’était comme un reflet de ma propre situation à Cuba. Il était le personnage qui essayait de combattre une idéologie elle-même. Tout système qui est dominé par une seule idéologie est un système théologique. Dans le cas de Fray Servando c’est l’Église avec ses dogmes imposés d’en haut et que tout le monde doit assumer. Dans le cas de Cuba, il s’agit de Karl Marx avec sa Bible et tout le monde doit respecter ces idées sans pouvoir les contester. Mais ce qui est intéressant, c’est que Fray Servando contestait tout cela précisément de l’intérieur, depuis la conception philosophique elle-même et réduisait en poussière ce qui justifiait tout cela. C’était comme contester le système marxiste à partir de l’idéologie même de Karl Marx. Et cela frère Servando l’avait fait avec intelligence et astuce depuis l’intérieur des couvents, précisément parmi les personnes qui étaient censées être celles qui d’un point de vue philosophique défendaient cette idéologie. Ce qui me fascinait le plus, c’est que ce personnage ait eu le courage de faire tout cela (Santí 1983, 115, N. T.)
D’autres similitudes paraissaient frappantes à ses interlocuteurs qui l’interrogeaient :
Ce que vous dites est réellement hallucinant parce que de la même façon que Fray Servando a été contraint à déclarer publiquement son erreur, le gouvernement cubain a forcé plusieurs écrivains à confesser des supposées erreurs politiques. Réponse : exactement c’est le système inquisitorial qui s’impose à nouveau. Comme l’histoire se répète ! (115-116).
À la grille de lecture politique rétrospective d’Arenas se superposait alors une lecture téléologique de son cas personnel qui sous-entendait que la réalité avait dépassé la fiction :
Lorsque j’ai écrit Le Monde hallucinant en 1965 je n’avais pas encore vécu toutes les péripéties que je raconte dans le livre. Quand j’ai été arrêté on m’a conduit à la prison de La Cabaña à La Havane où un peu plus de cent ans en arrière Fray Servando avait été lui-même retenu prisonnier. Ce que je ne suis jamais parvenu à faire c’est ce qu’avait réussi le frère : s’enfuir de La Cabaña. Ce qu’il y a aussi d’hallucinant c’est que lorsque le frère s’enfuit de La Cabaña il le fait en bateau ou en barque, on ne sait trop comment, rien moins que pour rejoindre la péninsule de La Floride. C’est un fait historique. Le hasard veut que quelques années plus tard moi aussi je devrai partir en bateau jusqu’à la péninsule de La Floride. J’en suis arrivé à la conclusion que je suis condamné à écrire ce que j’ai vécu comme c’est le cas avec Celestino avant l’aube, ou à vivre ce que j’ai déjà écrit comme c’est le cas avec Le Monde hallucinant. Cela m’amène à faire très attention à ce que j’écrirai dorénavant, car par la suite cela se réalise (117).
Si l’on en croit l’autobiographie posthume d’Arenas publiée en français sous le titre Avant la nuit, cette prise de conscience du caractère prophétique de sa prose daterait de son entrée à la prison du Morro : « Dans Le Monde hallucinant j’évoquais un moine qui était passé par plusieurs prisons sordides (dont le Morro). Alors en y allant moi-même, j’ai pris la décision de faire plus attention dorénavant aux choses que j’écrirais car j’étais condamné semblait-t-il à les vivre dans ma chair » (Arenas 2000,288). Il semble bien cependant que le premier rapprochement effectif entre sa situation carcérale et celle de son héros romanesque soit antérieur. Selon le témoignage de Juan Abreu, l’un de ses amis les plus proches, cela remonterait plutôt au temps où il était fugitif et se cachait dans le parc Lénine pour se soustraire à la justice de son pays dans laquelle il n’avait plus confiance. Se sentant souffrant, il se livrait alors à des confidences et faisant part de ses états d’âme à celui qui le ravitaillait en nourritures spirituelles et terrestres. D’où cette réflexion :
Puisse l’esprit de Fray Servando s’être réincarné en moi poursuit-il, car ainsi ils ne pourront pas m’attraper. On se pose et on écrit, le frère s’est enfui en courant, il a traversé tant de lieux, il s’est échappé, il s’est échappé encore et il a continué de s’échapper ; mais maintenant alors que nous sommes assis là, je me dis, c’est bien beau, et mon admiration n’en est que plus intense, mais où dormait-il ce pauvre homme, que mangeait-il, que faisait-il à chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant d’une telle fuite, où est-ce que cela lui faisait mal, souffrait-il de méningite comme c’est peut-être mon cas ? (Abreu 58, N. T.).
Cette tentative d’empathie à travers les âges ne fut pas vaine si l’on en croit le même Juan Abreu puisque les mânes invoqués du frère globetrotteur se montrèrent assez cléments pour permettre à son ami de s’échapper et ce à au moins deux reprises (115 et 175). En 1982, à l’occasion d’une réédition de son roman au Venezuela, Arenas fera figurer une nouvelle préface ou plus exactement un prologue complémentaire. Cet ajout ne revêt plus une forme épistolaire, mais il se présente comme une mise au point sur les circonstances de production du texte et, à certains égards, comme un manifeste littéraire. Le titre en est « Fray Servando, victime infatigable » et il s’achève sur la mention : « Caracas le 13 juillet 1980 »48 . Entre-temps le cubain a fait par lui-même l’expérience de la prison et désormais celle de l’exil, autant de traits qu’il possède en commun avec celui qu’il considère comme son homologue mexicain. Dans cette édition de Monte Ávila l’identification avec son personnage s’accentue.
Fray Servando fuyait déjà l’Inquisition espagnole depuis de longues années, parcourant toute l’Europe avec le cortège d’humiliations et de vicissitudes qu’impose l’exil lorsqu’il rencontra un soir, dans un jardin botanique italien, l’objet de son absolue nostalgie ; un agave mexicain (ou plante à maguey), en cage dans une petite cellule, avec une sorte de petit panneau d’identité49 (Arenas 2002, 279).
Arenas tire vraisemblablement cette information du livre de Valle-Arizpe, en lui imprimant le style qui lui est propre. L’exil s’est ajouté à l’étape carcérale et on comprend sans peine que la petite plante exotique, étiquetée dans sa serre et empreinte de nostalgie, correspond à l’état d’âme du moment de Reinaldo, un état qui ne variera jamais. Dans un deuxième temps il retrace le parcours du moine : « cette infatigable victime, qui a été plus d’une fois sur le point de périr dans les flammes du bûcher, l’hôte habituel des prisons les plus redoutées d’Amérique et d’Europe (San Juan de Ulúa, La Cabaña, Los Toribios, etc.) » (280). Quelques années plus tard, révisant ce texte en vue d’une publication qui devait réunir l’ensemble de ses essais politiques et littéraires, cette énumération est rectifiée par ses soins. On peut y voir une correction suite à une vérification ou la volonté de faire coïncider, coûte que coûte et en un même lieu deux destins séparés dans le temps. Quoi qu’il en soit, dans cette énumération la prison de La Cabaña est éliminée au profit de celle du Morro (Arenas 2001, 96). Tout se passe comme si à un certain moment Arenas s’était persuadé ou avait voulu laisser croire qu’il s’était retrouvé très exactement dans la cellule occupée autrefois par Fray Servando. C’est en tout cas ce que laisse entendre Roberto Valero (1955-1994) pour qui c’est bien la réalité qui copie la littérature et non l’inverse.50 Revenant sur la trajectoire de son ami, le même Valero dans un article lui rendant hommage affirme : « Étrangement l’œuvre et la vie en sont venues à se rejoindre jusqu’à se confondre. Les atrocités subies par Fray Servando dans Le monde hallucinant de manière insolite, elles arrivent à Reinaldo » (Ette 1992, 29).
Cette expérience partagée de l’enfermement conduit à une assimilation de destins qui n’est pas gratuite ni simple affaire personnelle mais qui va déboucher sur un remploi polémique recyclant en particulier la charge anti-inquisitoriale en prenant pour cible les dérives néostaliniennes du régime castriste. Arenas est catégorique sur le point de sa légitimité à témoigner et il l’écrit en note du paratexte de son recueil El leprosorio : « le témoignage sur les prisons cubaines est fondé sur mon expérience personnelle (prisons du Morro, La Cabaña, District Flores et prison ou P. N. R. [Police nationale révolutionnaire] de Guanabacoa, de 1974 à 1976). » (Arenas 2018,163). Bien évidemment le grand retour des rats ne pouvait s’effectuer que dans le cadre de la prison du Morro comme un dernier clin d’œil d’Arenas à Fray Servando. Cette fois-ci les nuisibles allaient parasiter les séances de lecture que lui infligeait un compagnon d’infortune, poète improvisé, avec qui il avait sympathisé, mais qui était doté d’un piètre talent :
On s’amusait avec les rats, qui la nuit, s’entassaient près du grillage où il avait son bureau de fortune ; je n’avais jamais vu nulle part un tel nombre de rats réunis, ni d’aussi énormes ; certains étaient plus gros qu’un agouti. Par centaines ces rats se battaient, se mordaient et faisaient un tel vacarme que le poète interrompait sa lecture pour observer le jeu de ces animaux (Arenas 2000, 309).
Apparemment rien de tel chez Reinaldo qui, selon ses dires, se refusait à la poésie contrainte. On l’aura compris le poids de l’écriture d’Arenas in carcere et vinculis fut très faible du point de vue artistique. De fait un seul poème semble correspondre à ce critère et non sans quelque réserve. Cette pièce est unique, Arenas n’ayant jamais fait état d’un autre écrit littéraire pendant cette période de captivité. Au vu des manuscrits conservés on a pu émettre l’hypothèse d’une conception en prison et d’une mise au net postérieure (Casado Fernández 273). Le titre en est : « Volonté de vivre en se manifestant » (Arenas 2018, 181, N. T.)
Maintenant ils me mangent
Maintenant je les sens monter et tirer mes ongles
J’entends leurs rongements atteindre mes testicules.
De la terre ils me jettent de la terre,
Ils dansent, ils dansent sur ce tas de terre
Et de pierre
Qui me recouvre.
Ils m’écrasent et vitupèrent
En répétant je ne sais quelle aberrante résolution qui me concerne
Ils m’ont enseveli,
Ils ont dansé sur moi,
Ils ont bien tassé le sol.
Ils sont partis, ils sont partis en me laissant pour mort et enterré
Mon heure est venue (Prison du Morro, La Havane, 1975)51
Malgré sa datation et sa localisation Il n’est donc pas établi que ce poème ait été réellement écrit en prison52 mais en revanche il est certain qu’il y a été conçu. Si ce n’était pas le cas on ne voit pas quel sens on pourrait donner à ce rattachement qui se veut authentification. Le titre d’abord : c’est celui d’un recueil de poèmes publié de son vivant53. Qui sont ces êtres à la fois énigmatiques et maléfiques qui tourmentent ce « moi », sujet entièrement passif et douloureux ? Les perceptions et le vocabulaire suggèrent l’activité d’animaux rongeurs probablement encore des rats. Les ongles et les testicules sont les cibles privilégiées des bourreaux anonymes qui pratiquent la torture sèche. Pour rappel, l’intimité de Servando avait eu droit à un traitement analogue. Les rats tortionnaires se muent en assassins fossoyeurs. Le rythme de leur danse macabre, scandé sur une tombe en devenir, est aussi le piétinement blasphématoire qui bafoue la dignité de la victime. L’invective en guise de prière et l’acharnement mis à condamner résonnent comme un exorcisme imprécatoire. C’est l’arbitraire d’une décision incompréhensible pour celui qui en subit les foudres. Puis le changement de temps traduit l’éloignement des bourreaux qui cherchent à effacer les traces de leur forfait en égalisant le sol de la sépulture. Le dernier vers, typographiquement détaché, appartient au mort-vivant qui conserve la maitrise du temps par une aperception de la conscience dont on ne peut le déposséder et qui prépare peut-être son insurrection au sens étymologique de « se redresser pour combattre ».
La prison du Morro, ce lieu commun de captivité qui, par-delà le temps, réunit Servando et Reinaldo n’occupe pas uniquement une place centrale dans ses Mémoires ou roman-Mémoire. Dans l’avant-dernier ouvrage de sa « pentagonia »54 qui a pour titre La couleur de l’été et qui est une sorte de patchwork, mêlant roman à teneur carnavalesque et fragments autobiographiques, Arenas revient sur cet emprisonnement dans un chapitre qu’il intitule précisément « Au château du Morro ». Là un de ses doubles ou alias : La Lugubre Moufette55 devient l’écrivain public de ses codétenus dont il assume la correspondance privée. Exactement comme dans Avant la nuit, il se refuse à tout rapport sexuel mais, et c’est là toute la différence, il réécrit pour la cinquième fois un roman fleuve dont le titre est précisément La couleur de l’été. Arenas, on l’a vu est coutumier de ces jeux de mise en abyme. Une fois l’ouvrage achevé, la difficile question qui se pose alors à son avatar n’est plus tant celle de la mise à l’abri du manuscrit, maintes fois confisqué, que celle de sa sortie hors des murs en vue de sa publication. La littérature carcérale n’est pas une fin en soi, encore faut-il qu’elle atteigne le lecteur en franchissant les barrières successives qui, emboitées comme des poupées russes, s’interposent entre l’objet et son destinataire. Ici encore la prison est une figure métonymique de l’île tout entière et un décloisonnement libérateur, une nécessité absolue :
Maintenant son roman achevé, il ne restait plus à la lugubre Moufette qu’à mener à bien une entreprise extrêmement délicate, le semi-couronnement de son œuvre : faire sortir son manuscrit de prison. Nous disons semi-couronnement car le couronnement, c’était de le faire sortir de l’île ; et le couronnement total de le publier… Mais en ce moment, pour Gabriel, le plus important était le semi-couronnement. Il devait faire passer le manuscrit de l’autre côté des murailles du Château du Morro (Arenas 2007, 395-396).
La solution lui est fournie par le recours aux services d’une mule homosexuelle dont l’orifice naturel très distendu doit permettre d’effectuer l’évacuation désirée au cours d’un parloir. La joie de l’auteur est cependant de courte durée car le manuscrit souillé mais intact est à nouveau intercepté et séquestré par la Sûreté d’État. Il ne sera restitué qu’au prix d’un reniement devant un jeune lieutenant dont le physique avantageux, plus que tout autre argument, convainc l’auteur de se livrer à une autocritique radicale et de faire un panégyrique du régime de Fifo / Castro.
Sans traîner, la Lugubre rédigea à une vitesse admirable une très longue rétractation dans laquelle il s’accusait d’être vil, traître, contre-révolutionnaire et dépravé, tout en exaltant la courtoisie, la dignité et la grandeur du lieutenant qui s’occupait de son cas (À propos de la grandeur du lieutenant, Reinaldo n’avait pas menti, du moins quant à son aspect physique) ; ensuite il se lança dans un exposé minutieux sur les bontés et le génie de Fifo. Tout ce que j’ai écrit jusqu’ici – disait en conclusion sa rétractation – c’est de l’ordure et ça doit finir aux ordures. Dorénavant je serai un homme et deviendrai un fils digne de cette merveilleuse révolution (Arenas, 2007, 399)
Écrit contre écrit, sa propriété lui est alors rendue et en gage de sa bonne foi il brûle l’unique exemplaire du manuscrit en présence du bel officier qui n’en demandait pas tant, et qui lui donne en retour une chaleureuse accolade. Aussitôt ramené(e) en cellule la Moufette s’empresse d’échanger ses derniers cigares contre des feuilles de papier vierge et s’attelle à la réécriture de l’histoire sans fin du même roman. Le chapitre se referme en boucle sur cette nouvelle palinodie.
La dernière porte
Très exactement en 1964, alors que Reinaldo Arenas se mettait en quête de la vie de Fray Servando dans les bibliothèques de La Havane, Jean Cassou (1897-1986), ancien président de l’Institut d’Études Occitanes (1945-1952) faisait paraitre un ouvrage où il réunissait sous le titre de Parti pris un certain nombre d’essais critiques. Cassou, qui avait fait lui-même l’expérience de la captivité pendant la guerre, y abordait le thème de l’emprisonnement et de ses rapports avec la création artistique. Se référant au totalitarisme stalinien il écrivait :
Le pouvoir soviétique s’est confectionné une théologie, une apologétique, une scolastique, une casuistique, il a ses livres saints et leur exégèse, ses conciles et leurs décrets ; tous les procédés de l’Index et du Saint-Office, il les a repris : excommunications, anathèmes, amendes honorables, etc. Il a même, comme nous l’avons observé, ajouté de savantes améliorations à l’art d’arracher des aveux aux pécheurs et aux hérétiques56.
L’Inquisition, symbole d’intolérance et de fanatisme, est devenue au fil du temps la pierre de touche d’une herméneutique de la terreur que l’on croyait d’un autre âge. Cependant on ne doit jamais perdre de vue qu’à côté de l’institution bien réelle, vilipendée à juste titre pour ses buts et ses méthodes, s’est développée très tôt une mythologie qui en a accusé les traits jusqu’à la caricature pour les mettre au service de la polémique. Ce dédoublement est perceptible jusque dans l’écriture carcérale, thème du colloque, où il apparait que c’est davantage l’ensemble de l’appareil inquisitorial comme système que ses prisons à proprement parler qui est mis en cause. Reste que les souffrances endurées qu’elles génèrent une écriture immédiate ou différée, en légitiment l’expression quand bien même l’historien en devrait contester la stricte exactitude. Ainsi Christopher Domínguez observe-t-il à ce propos que :
Presque tous [les biographes de Mier] ont tenu pour vrai ce que Servando disait de lui-même, dans ses écrits rédigés en 1819 dans sa cellule du Palais de l’Inquisition. Je me suis quant à moi proposé de mettre ses dires en doute et ma recherche a consisté à découvrir la richesse de ce que dissimulaient les mensonges (ou les hyperboles) du religieux. Il ne m’est jamais venu à l’esprit d’écrire un roman sur Mier, non seulement parce qu’il en existe déjà un très célèbre - Le monde hallucinant de Reinaldo Arenas - mais parce que le moine lui-même avait génialement romancé sa vie (Domínguez 2011, 89-90).
Si l’on se tourne vers les biographes d’Arenas un constat analogue s’impose, Liliane Hasson déclare : « Il existe un certain flou sur la durée totale de la privation de liberté ».57 Son ami Juan Abreu le reconnait au cours d’un entretien : « il inventait beaucoup sur sa vie, un jour il disait une chose, le lendemain une autre » (Hasson 2007, 116). Quand bien même il y aurait une part d’affabulation, voire une attitude qui confinerait à la mythomanie, cela ne disqualifie pas pour autant la valeur d’authenticité de ces témoignages. Il est clair que les informations concernant la vie de ces deux hommes, dans le huis clos de leur prison, émanent presque exclusivement de leurs écrits sans possibilité de confrontation avec d’autres sources, mais n’est-ce pas là la conséquence de cet environnement carcéral qui les opprime ? Quand elles ont été conservées les archives de l’Inquisition sont désormais disponibles pour les chercheurs, peut-être en sera-t-il de même un jour pour celles de la Sûreté d’État cubaine.
Les deux trajectoires ne sont certes pas réductibles l’une à l’autre mais elles sont désormais liées à jamais pour la postérité. Si, d’un côté, Servando Mier finit sa vie à Mexico entouré des siens et honoré par ses pairs, en revanche Arenas demeura l’éternel exilé qui ne revint pas à Cuba. Mais si aujourd’hui le nom de Servando figure en lettres d’or dans l’enceinte parlementaire de Monterrey (État du Nouveau Leon)58 il le doit quelque part au paria proscrit qui, en tant que traitre à la Révolution, reste pour l’heure ignoré de la plupart de ses concitoyens. Mais il faut reconnaitre que l’Oscar Wilde tropical (Eliseo 247), mythifié sous d’autres cieux comme une icône gay, l’a bien cherché. Lorsque vint le temps de l’ultime prison, celle du corps malade du Sida, l’évasion s’effectuera par la porte de la mort choisie, histoire de ne pas laisser le dernier mot à la maladie, ni à Fidel Castro qu’il désignera comme unique responsable de sa tragédie personnelle. Il le fit en écrivant ces derniers mots de défi : « Cuba sera libre. Moi je le suis déjà ». Sans doute y a-t-il eu, en effet, appropriation d’une vie et d’une œuvre mais ni détournement ni plagiat. En ce qui concerne la vie, Vicente Echerri, chroniqueur cubain du Nuevo Herald de Miami, avec qui il n’était pourtant pas dans les meilleurs termes, ne s’y trompa pas en intitulant sa nécrologie après l’annonce du décès de Reinaldo : « L’autre mort de Fray Servando » (Echerri 1990). Pour ce qui est de l’œuvre, si l’on accorde à Roger Chartier que : « toujours, également, l’appropriation est créatrice, production d’une différence, proposition d’un sens possible mais inattendu »59, il nous semble que celle d’Arenas a pleinement satisfait à cette exigence.