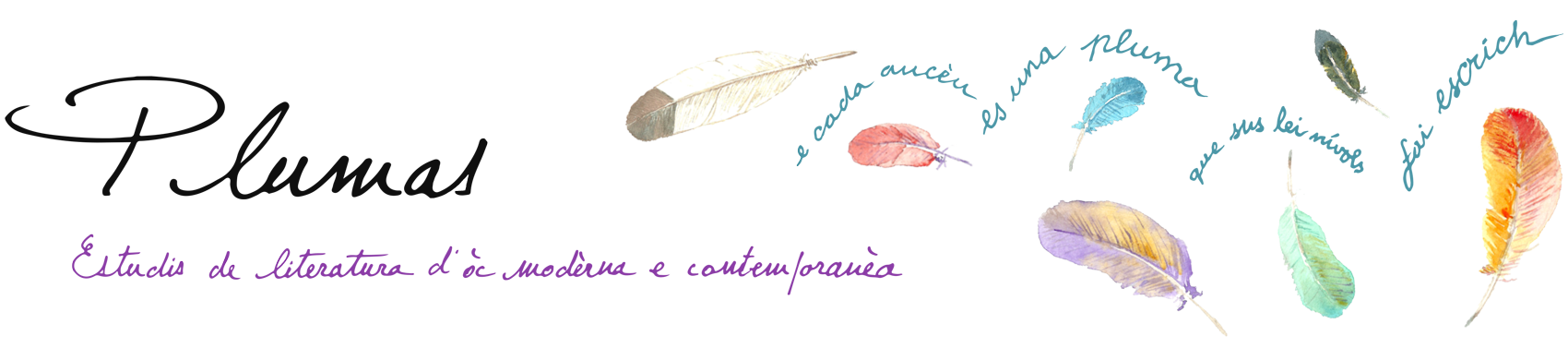La poésie de Bernard Lesfargues prend sa source dans un recueil au nom mystérieux : Cap de l’aiga, traduit par le non moins énigmatique : Mère des eaux. Ce « Cap » renvoie donc, si l’on s’appuie sur la traduction française de « Mère », à une origine, une matrice. Les eaux sont au début, il y a une « font » première. Le poète lui-même explique très bien ce titre de recueil dans une note qui accompagne son anthologie intitulée Bergerac et autres lieux (1993) :
Cap de l’aiga, titre du recueil auquel est emprunté ce poème, est la forme languedocienne du limousin « Chap de l’aiga ». Francisé de longue date en Chadelaygue, c’est un lieu-dit de la commune de Saint-Jean-d’Eyraud ; comme le nom l’indique (“tête de l’eau”), l’Eyraud y prend sa source.1
La « tête » de l’eau, le bout, le commencement donc des eaux : une source qui ne va jamais cesser d’irriguer toute la poétique de Bernard Lesfargues, de recueils en recueil. La thématique de l’eau sera une constante, telle une image entêtante. L’eau et la poésie ne faisant qu’un, mêlant leur substance insaisissable au gré des langues puisque Lesfargues est poète en occitan, en français et, plus rarement, en castillan. Bien sûr, les lieux de vie y sont pour quelque-chose : la Dordogne de l’enfance mais aussi les rives lyonnaises du Rhône où il s’installa ; mais d’autres rivages, d’autres rivières, d’autres lacs ou retenues, des puits, des ports, des fleuves et des lavoirs… une myriade de lieux liés à l’eau inspirent son écriture. Nous nous proposons ici de suivre le cours de cette eau dans le sillage des publications poétiques, depuis 1953 jusqu’au dernier recueil La plus close nuit en 2010. Nous nous appuierons principalement sur les textes en langue d’oc mais nous citerons aussi quelques pièces en français. Pour reprendre une image lesfarguienne, quels sont, justement, les divers « visages » de l’eau ? Cherchons tout d’abord le chemin de la source, engageons-nous vers cette « tête de l’eau ».
Le ruisseau de l’Eyraud dont la source est au lieu-dit Chadelaygue.
Père Igor, CC BY-SA 4.0
Une ou des sources ?
Le premier poème du recueil Cap de l’aiga2 pose un point de repère essentiel avec l’évocation de la ville de Bergerac, lieu de naissance du poète, port fluvial sur la Dordogne (p. 13) : « Brageirac sus la Dordonha, / Brageirac del mes de mai » (Bergerac sur la Dordogne / Bergerac du mois de mai). Philippe Gardy dans son ouvrage Paysages du poème insiste sur le sentiment de détachement, de nostalgie qui nait de ces quelques vers (Gardy 2014, p. 103-104). Dans ce même numéro de la revue Plumas nous renvoyons à l’article de Jean-Claude Forêt qui décrit plus en détail ce premier texte. Il est clair que l’eau, avec le fleuve limousin, est omniprésente dans ce texte qui coule et déroule ses vers réguliers « vèrs Bordèu qu’a de batèus / e Blaia pus de gabarras » (vers Bordeaux qui a des bateaux, / et Blaye plus de gabares). Au-delà de la seule nostalgie et du sentiment d’exil, d’éloignement du lieu de l’enfance, Lesfargues cherche un rythme poétique qu’il trouve là, simplement :
E quela aiga que carreja
entre doas ribas de vits,
cada nuèch los escandilhs
e lo jorn las canaveras (p. 13)
Et cette eau qui emporte
Entre deux rives de vignes,
La nuit des feux-follets,
Et des roseaux le jour
Il ne quittera plus ce rythme de l’eau, profitant des variations possibles et jouant au gré des mouvements d’une substance qui semble correspondre parfaitement à son projet poétique. Ce premier essai trouve son écho dans un autre texte du recueil : la « Cançon ». La Dordogne y apparaît bien plus sombre, le cours du fleuve est la métaphore d’un passage inexorable du temps, tout semble s’enfuir vers l’horizon océanique. La forme même de la « Cançon » est pourtant bien une tentative de retrouver un chant perdu, de se raccrocher à une mélodie ancienne, de garder un contact avec une mémoire populaire. Le vers régulier nous paraît aller dans le sens d’une volonté de conserver, de préserver, malgré la fuite des éléments. La quête de la source, le retour vers l’enfance renvoient à une traversée impossible, certes, et le poème ne peut remonter le cours de l’eau, il doit s’éloigner de la « tête » pour se laisser porter vers Blaia (Blaye), mais cette ville de Blaia ne renvoie-t-elle pas à une origine médiévale ? N’y a-t-il pas un écho lointain à l’amor de luenh de Jaufre Rudel, troubadour de l’exil et de la traversée des eaux ? Une autre source donc. D’un « cap » à l’autre du fleuve, Lesfargues trouve l’inspiration et réalise la boucle. Il s’éloignera ensuite de la forme régulière pour choisir une écriture en vers libres tout en restant fidèle à cet écoulement de la phrase au long cours. Il clôture d’ailleurs son premier recueil sur l’évocation d’un autre lieu, le roc d’Anglars, également associé à un chant populaire (nous renvoyons ici à l’explication qu’en fait Jean-Claude Forêt dans ce même numéro de Plumas) et à une source qui contient toutes les sources du monde :
Ta cara la vesi tremblar
dins l’aiga de totas las fonts
vesi tremblar dedins ta man
la doça lutz del lendeman (p. 43)
Ton visage je le vois qui tremble
dans l’eau de toutes les sources
et dans ta main je vois trembler
la douce lumière de demain
L’eau ouvre ensuite son second recueil avec la première sous-partie intitulée « L’aiga vièlha » [La vieille eau], elle est encore au cœur du poème « Lo lavador » (p. 73) évoquant le lavoir de Siurana en Catalogne, dans la province de Tarragone. Lesfargues pense à toutes les femmes qui ont lavé leur linge en ce lieu :
Pensi a totas las mans
qu’an lavat lençòls e toalhas
dins aquela aiga a flor de cèl.
A totas las qu’an eissurit
mocadors e camisas
puèi espandit la bugada
sus las pèiras dau camin.
Je pense aux innombrables mains
qui ont lavé draps et serviettes
dans cette eau, à fleur de ciel.
À toutes celles qui ont essoré
les mouchoirs et les chemises
puis étendu la lessive
sur les pierres du chemin.
Lavoir de Siurana
L’eau est sur leurs mains mais l’eau est aussi dans leur corps, elle jaillit de leur poitrine telle une source secrète : « una dotz d’aiga blavenca / lor sorgentava din’l pitre » (une source d’eau bleuâtre / surgissait dans leur poitrine). L’eau est au cœur même du poème qui, à partir d’une rêverie sur un lieu, fait revivre les vies passées, sans cesse en quête d’un temps englouti. Plus tard, dans Les mots te sont des pièges, mais cette fois-ci en français, un autre poème d’eau nait d’un voyage au-delà des Pyrénées, sur les rives de l’Eresma (« L’Eresma, la nuit » p. 216) en Castille Ce cours d’eau espagnol qui « s’en vient de la sierra » est une « eau de nuit, qui chante la nuit », ses reflets se mêlent aux étoiles et sa substance liquide semble faire naître le monde. La Catalogne, l’Espagne : un monde ibérique qui constitue une autre source importante pour Lesfargues, professeur d’espagnol et traducteur des plus grands écrivains catalans ou espagnols. Enfin, dans le recueil Ni cort ni costièr (Droit au but, 1970), le fleuve mythique du Rhône joue un rôle central, avec le poème court en vers libres « Diga-li, Ròse » (Toi, le Rhône, dis-lui, p. 111-113). Il s’agit d’un texte engagé, écrit dans le contexte des événements de mai 1968, mais il s’agit aussi d’un poème d’exilé ; Lesfargues y demande au fleuve de porter son message vers le sud, vers sa « terre occitane » :
Tu Ròse, diga-l
a la tèrra occitana
que lèu vas rencontrar,
diga-li qu’aquí soi
per l’amor d’ela.
Toi, le Rhône, dis-lui,
à la terre occitane
que tu vas rencontrer
dis-lui que je suis là
par amour pour elle.
Le Rhône est donc le lien avec la terre des origines, avec la source. Il est, comme chez les troubadours, le messager que l’on envoie vers la Dame aimée. Il est le poème. Suivre le cours du fleuve c’est retrouver le lieu du commencement, peut-être est-ce revenir sur les pas de l’enfance ? Se rapprocher aussi des terres d’oc et de la Dordogne qui charriait des légendes et des chansons perdues ? Mais le fleuve mythique fait écho aux luttes du moment dans un texte de révolte et de rage qui se tourne aussi vers l’avenir. C’est une autre source d’inspiration, c’est l’un des visages de la poétique lesfarguienne : celui d’une plume aiguisée, fustigeant les injustices et les oppressions.
Reflets et jeux de lumière
Dans son ouvrage L’eau et les rêves, Gaston Bachelard3 ouvre sa réflexion sur les eaux de surface, les eaux claires et brillantes propices aux reflets et aux illusions de formes. Nous retrouvons cette dimension dans la poésie de Lesfargues, attentive aux ondoiements du liquide et aux jeux de lumière. Nous l’avons déjà remarqué à propos de l’évocation de l’Eresma où c’est une eau nocturne, véritable miroir des constellations, qui est mise à l’honneur dans une écriture onirique aux accents presque rouquettiens. D’autres cours d’eau charrient le ciel et les étoiles, notamment le poème « L’aur del cèl » (L’or du ciel, p. 51) du dernier recueil La plus close nuit :
De ser, lo cel es daurat
coma un pergamin del sègle quinze.
ensaji de legir çò que las brancas
escrivon amb una tinta negra menimosa
sus l’esplendor d’un oèst illuminat.
Aquò n’es pas de bon legir,
son de letras d’un alfabet desconegut.
pauc a cha pauc lo cel s’emblaima.
Un àngel garrèl bufa la candèla
e baissa lo ridèu. Laidonc
la loira de la nuèit sedosa me careça las cambas,
la loira que dança dins la nuèit dels rius
fins a las laganhas de l’alba.
Ce soir, le ciel est doré
comme un parchemin du seizième siècle.
J’essaie de lire ce que les branches
écrivent minutieusement à l’encre noire
sur la splendeur d’un ouest illuminé.
Ce n’est pas facile à lire,
ce sont lettres d’un alphabet inconnu.
Le ciel pâlit peu à peu.
un ange claudiquant souffle la chandelle
et baisse le rideau. Alors
la loutre de la nuit soyeuse caresse mes jambes,
la loutre qui danse dans la nuit des ruisseaux
jusqu’aux impuretés de l’aube.
Le ciel doré fait écho aux ruisseaux nocturnes où danse la loutre, animal symbolisant ici le mouvement de l’eau, ses courbes sinueuses. Nous notons également l’image du « parchemin du seizième siècle », le ciel tout comme la surface des eaux accueillent les dessins, les signes d’un « alphabet inconnu » ; serait-ce une image de l’écriture du poème lui-même qui s’en fait le réceptacle sonore ? Cette lumière dorée et crépusculaire était déjà au cœur du texte « Orbalutz de Sant-Martin » (Crépuscule de saint-Martin, p. 22-23) où la nuit est pleine de poissons frémissants :
Èrem pres dins l’oblit del temps
per l’esparvièr de la nuèch clara,
comol de peisses fernissents
e qu’avián de fuòc las escalhas.
Nous étions pris dans l’oubli du temps
par l’épervier de la nuit claire,
rempli de poissons frémissants
aux écailles de feu.
Cette poésie de l’eau et du ciel est très souvent associée à la nuit. Les galaxies et les lueurs du liquide se confondent. Mais ces reflets lumineux ne sont possibles qu’en jouant sur le contraste avec la couleur sombre. C’est bien cette noirceur de l’eau qui sert de « parchemin » aux images miroitantes de Lesfargues. Une noirceur que souligne le texte « Recòrd de Segovia » (Souvenir de Ségovie, p. 24-25) évoquant le refrain d’une chanson de nuit glacée : « Negra, negra, la nuèch mai l’aiga, / ieu sei negra, mas ieu sei brava… » (Noire, noire, la nuit et l’eau / je suis noire mais je suis belle…) ; la ville de Castille est traversée par l’Eresma. Au « Crépuscule de saint-Martin » que nous évoquions plus haut vient répondre la lumière tamisée d’une matinée, dans le court poème « Lo flume del matin » (Le fleuve du matin, p. 30-31) où les « sources résonnantes » naissent de la nuit elle-même. Parfois l’obscurité vient en pleine journée avec la couverture nuageuse propice aux illusions de surface parce que le « soleil s’est entravé / dans la broussaille des nuages » (Lo solelh s’es entraupat / dins la brodacha nivolosa). Le poète Lesfargues recherche ces moments de lumière incertaine où l’eau déploie la palette infinie de ses métamorphoses. Ainsi, la deuxième partie du recueil La plus close nuit est intitulée Lum dins l’escur (Lumière dans l’obscurité, p. 31) reprenant ce motif central du contraste entre ambiance nocturne et reflets lumineux.
Nuit étoilée sur le Rhône, Van Gogh, 1888
Dans les profondeurs de l’eau
Lesfargues et la poétique de l’eau, c’est aussi une plongée dans les profondeurs. L’eau « noire » du poème « Recòrd de Segovia » (p. 25) évoque la couleur sombre des abysses. Son refrain « Negra, negra, la nuèch mai l’aiga, / ieu sei negra, mas sei brava » remonte d’ailleurs des profondeurs de la mémoire. Dans La plus close nuit si la loutre évoquait, nous l’avons vu plus haut, le mouvement des eaux de surface, le poème consacré au fleuve parisien de La Seine (p. 41) met en avant l’anguille et nous conduit dans les couloirs secrets de l’âme humaine :
Anguille, anguille sous la roche,
mon cœur serait-il ta maison ?
Tu ondules et tu t’accroches
à des herbes sans fenaison
dans mon cœur que le sang sillonne
pourquoi plonger ton couteau si froid ?
Je me débats, je crie, je crois
que le courage m’abandonne,
ne trouvant plus de goût à rien
qu’à voir couler l’eau de la Seine
comme la vie ardente en vain
coule sans cesse dans mes veines.
Ce texte en français est daté de « 1946-2006 » : soixante ans se seraient donc écoulés entre la première écriture et la version finale. Si tel est le cas, l’eau fluviale et l’image de l’anguille sont aussi une évocation du temps écoulé et des profondeurs d’un parcours de vie. Des eaux parisiennes au fleuve de sang qui irrigue les veines, les trois quatrains constitués d’octosyllabes aux rimes embrassées et croisées posent un rythme régulier qui scande la descente en soi. Une plongée qui nous rappelle la « Cançon de la cara negada » (Chanson du visage noyé, p. 40-41) dans laquelle Lesfargues descend « Dins lo fons del fons de l’aiga » (Au fond tout au fond de l’eau) à la recherche d’une « cara » (un visage), reflet de l’âme, visage de l’être aimé, quête du passé révolu, quête de soi… Ce visage englouti lui échappe tel le reflet de Narcisse devant la source où il finit par se noyer. Le poème s’ouvre et se ferme sur ce « fons de l’aiga » (fond de l’eau) après avoir joué sur la proximité sonore entre le mot « aiga » (eau) et le verbe « gaitar ». Le regard porté sur cette eau est une plongée vers le « recòrd » (souvenir) qui hante toute l’œuvre de Lesfargues.
Le texte le plus éloquent est certainement le « Potz » (p. 164-165) du recueil Vos escrivi de Brageirac dans lequel Lesfargues remonte aux origines de sa naissance. L’eau, dans ce poème, est celle de la matrice, celle du liquide originel et maternel. La plongée est une descente vertigineuse vers la lumière du jour et la vie à venir. Le poème mêle donc deux mouvements contradictoires et pourtant, ici, complémentaires : un enfouissement et une émergence.
Vertiginosament me sona lo resson
d’una votz que n’es pas la miá
e davali e m’enfonsi
e me nègui
al mai prigond d’aquela que m’enfanta
la que le derraba lo jorn
per me tornar la lutz.
Vertigineusement l’écho me hèle
l’écho d’une voix qui n’est pas la mienne
et je descends et je m’enfonce
je me noie
au plus profond de celle qui m’enfante
celle qui m’arrache au jour
pour me rendre la lumière.
Bernard Lesfargues nous livre un autre poème évoquant l’eau des puits, quelques décennies plus tard, dans La plus close nuit avec « La ròda del potz » (La roue du puits, p. 46-47) où l’eau des profondeurs souterraines rejaillit, tirée à la force des bras sur la poulie, pour régénérer la terre mais aussi abreuver les étoiles. Là aussi deux mouvements se croisent : la descente du seau dans le puits et la remontée des eaux jusqu’au ciel… Des profondeurs de la terre jusqu’aux constellations, toute une élévation est illustrée par la forme du poème, en vers libres, relativement courts, et portés par le rythme entêtant de l’anaphore :
per la set de l’assedat
per las selhas asolhar
per banhar las faissas de l’òrt
per lo temps qu’a la pepida
e per lo beure de las ensenhas.
pour la soif de l’assoiffé
pour remplir les eaux à ras bords
pour baigner les plates-bandes du jardin
pour guérir le temps de la pépie
et donner à boire aux constellations.
Et lorsque, à l’opposé, Lesfargues évoque la fatigue du corps et cette vie qui passe trop vite et l’empêche de réaliser tout ce qu’il souhaiterait, nous retrouvons l’eau. L’eau dans laquelle il jette la clé de « l’ostal » (la maison ; dans E de glèisa nueva tanben, « Lo còs, lo còr e l’ostal », Le corps, le cœur et la maison, p. 153-157), la clé du lieu de vie mais aussi celle du corps et du cœur :
Paraulas que venon
e mots que se’n van.
Ai barrat la pòrta :
geti la clau dins
lo fons de la gana.
Paroles qui viennent
et mots qui s’en vont.
J’ai fermé la porte :
je jette la clé
au fond de la mare.
Au fond, sous l’eau, le poème est certainement cette clé de paroles qu’il faudra ensuite retrouver pour combattre l’oubli.
La musique de l’eau
Sources, surfaces ou profondeurs, l’eau chez Lesfargues est, sous toutes ses formes, une métaphore de la langue, de la musique des mots qui constitue toute parole. Gaston Bachelard avait étudié ce « murmure de l’eau » dans L’eau et les rêves en montrant le lien étroit qui rapproche le liquide du langage. Le poème « Lo flume del matin » (p. 30) du premier recueil illustre cet aspect, il associe le fleuve au chant des oiseaux du matin, dans une veine troubadouresque :
Quau bèu flume, ò mandinada,
rivariá dedins ta clarda,
quau flume beluguejant !
se totas las fonts tindantas
que sorgentan quand fai brun,
tots los chants de l’auselum
flairejant luna e galatges
se colenavan en junh
dins l’amanir daus vilatges.
Quel beau fleuve, matinée,
coulerait dans la clarté,
quel fleuve étincelant !
si toutes les sources résonnantes
qui sourdent à la nuit,
tous les chants des oiseaux,
odorants de lune et d’ajonc,
se glissaient au mois de juin
entre les villages qui s’éveillent.
Les sources et les sons s’y mêlent, l’eau et la mélodie du monde qui s’éveille ne font plus qu’un. Un peu plus loin dans le recueil, le poème « Çò que l’aiga jonjoneja » (Ce que fredonne l’eau, p. 32-33) insiste sur la parole de l’eau, son fredonnement, son « murmure » pour reprendre Bachelard. L’eau fredonne le poème lui-même, elle incarne le texte poétique qui échappe à la page blanche et redevient flot de mots libérés, souffle de l’oralité. Le poète connait ce langage de l’eau qui coule et résonne au plus profond de lui-même :
Quela aiga riva onte ben sap
e sabi plan çò que marmusa.
Sos mots lusents, quicòm los ditz
dempuèi d’annadas dins mon arma.
Cette eau sait vers quoi elle coule
et moi je sais ce qu’elle murmure.
Ses mots luisants, quelque-chose les dit
depuis des années dans mon âme.
L’eau est musique. Dans le recueil Còr prendre (Prendre cœur) le texte « Cant de la viena » (Chant de la vielle, p. 56) évoque tout autant le « cant fachilhièr » (le chant sorcier) de l’instrument traditionnel que les mélodies du merle et celles de l’« eau frisquette, eau verdelette, eau de ruisselet, / eau dans un puits profond et d’un été luisant » (aiga fresqueta, aiga verdeta, aiga de riu, / aiga d’un potz prigond e d’un estiu lusent). En Cerdagne, où Jordi Père Cerdà l’a entraîné sur ses terres catalanes pyrénéennes, une église romane ruinée inspire un poème émouvant dans lequel Lesfargues croit entendre l’eau « que marmusa un chant-planièr » (l’eau qui murmure un plain-chant). Il s’agit d’un chant perdu, une fois de plus, d’un souvenir sonore qui laisse une marque dans ce lieu abandonné. Le murmure de l’eau est la métaphore d’une trace que laisse la parole humaine, un déplacement de l’onde, translucide et insaisissable par essence.
Mais c’est bien dans le dernier recueil La plus close nuit que ce langage de l’eau apparaît clairement (p. 25-26) :
Que les syllabes de l’eau se taisent
et la flûte des marais
pour que j’entende dans la nuit
ce que n’ose ta bouche
mais que ton cœur trahit à chaque battement
Ces « syllabes de l’eau » font écho au rythme régulier de la mer qui « dépose ses algues / et des coquillages que la lumière éblouit / offerts à la caresse d’une joue / à l’émerveillement d’une oreille ». Aux eaux douces que nous avons jusqu’alors largement évoquées, Lesfargues ajoute l’image de la mer, de l’immensité des eaux salées. « L’émerveillement d’une oreille » met en avant l’attachement au son, l’écoute attentive du monde qui coule et s’épand de toutes parts. Mais les rivières reprennent le fil du poème, et les oiseaux des rivages aussi :
Quand tu dors
la nuit marche sur la mousse.
Triomphe
d’un règne humide et végétal !
Quand tu dors
je sais le vif-argent de tes rêves.
Je sais que trente mille oiseaux
viennent boire à tes lèvres
et puis s’en vont mourir
aux paluds de la Prusse.
Nous retrouvons les différents aspects de l’eau, ses diverses métamorphoses, mais surtout une eau qui jaillit des lèvres de l’être aimé telle une langue secrète dont s’abreuvent les oiseaux. Ce texte est particulièrement intéressant pour clôturer notre réflexion, il synthétise à lui seul toute la poétique de l’eau lesfarguienne. Après la loutre et l’anguille, voici, dans les derniers vers, les « martres zibelines », autres incarnations animales de l’ondoiement, des courbes sinueuses de l’eau courante… Mais le plus important est de tendre l’oreille, car
il suffit d’écouter
si les mots ne trahissent pas leur poids de mots
si la plume sait à quoi elle s’engage
même si je dois attendre très longtemps.
Lesfargues le traducteur patient de chefs-d’œuvre de la littérature espagnole et catalane connait ce « poids » des mots et sait le temps et l’énergie nécessaire à l’écoute d’une langue pour pouvoir en transcrire la musique, ailleurs, dans une autre langue, une autre eau, un autre écoulement de sens et de sonorités. Il faut donc savoir écouter, se laisser aller à « l’émerveillement d’une oreille » pour entrer dans l’univers du poème qui, tel un coquillage égaré sur la plage, conserve la vibration du monde (p. 62) :
Richard Cœur de Lion, Richard,
pourquoi pensais-je à vous dans la nuit printanière ?
Le vent prêtait à la forêt ses ailes.
Le monde était un coquillage,
Dieu l’avait oublié sur la plage du temps.
Chez Lesfargues, nous venons de le voir, la création poétique est une quête de la source tout autant qu’une divagation à la surface des miroirs illuminés de l’eau. Elle est aussi une plongée dans l’obscurité abyssale, un enfouissement dans les profondeurs de l’être, dans les courants de l’angoisse et du doute, dans les gouffres de l’amour et du temps qui passe, inexorable. Elle est loutre, anguille, « pèis o perla o ben tot pèira » (poisson, perle ou simple pierre). Le poème, comme l’eau, murmure et chante mais il s’écoule et nous échappe, seule sa mélodie reste à l’oreille. Le rythme du texte, le rythme de la langue, en occitan, en français, en castillan, en catalan, pose son empreinte dans le corps du poète, il y dépose son eau souterraine, essentielle au jaillissement des sources nouvelles, au dialogue des cultures, à l’art de la traduction, au déchiffrage du rêve. Lesfargues, avec sa poétique de l’eau, chante la fuite, la perte tout autant que la reconquête et la renaissance. Il devient, dans l’acte d’écriture, ce corps d’où rejaillit la fontaine comme celui des lavandières de Siurana : « una dotz d’aiga blavenca / lor sorgentava din’l pitre » (une source d’eau bleuâtre surgissait dans leur poitrine). Chaque poème de Lesfargues, égrainant ses « syllabes de l’eau », recompose la symphonie de la langue, telle une fontaine aux oiseaux, une émergence, un « cap de l’aiga ».