Cap de l’aiga est empreint d’une double mélancolie : c’est le cahier d’un exil du pays natal et une chanson du mal-aimé. Les deux thèmes se mêlent et finissent par se confondre. Ils échangent leurs motifs qui s’interpénètrent : celui de l’eau et de la source, qui suggère la douleur de la langue perdue sans jamais l’exprimer explicitement, celui du village figé autour de son église dans le mystère de la nuit ou la chaleur de l’été, celui des légendes et des chansons dont se sont nourris son pays et ses premières années.
« Brageirac »
Dans la nostalgie d’un paysage d’enfance omniprésent, celui des rives de Dordogne et des villages, églises et châteaux d’alentour, le ton des dix-huit poèmes de Cap de l’aiga est élégiaque. Certaines des formes poétiques les plus en faveur dans les années 40 et 50 sont la strophe de mètres pairs, le couplet de chanson ou le romance espagnol, un genre popularisé par Lorca que Pierre Darmangeat, mentor puis inspecteur pédagogique de Bernard Lesfargues, avait traduit en français.
Le poème inaugural, « Brageirac », est un romance de forme quasi canonique : cinq quatrains d’heptasyllabes assonancés, vers extérieurs à finale féminine, vers intérieurs à finale masculine. La coupe 3+4 leur confère un rythme de soupir. Après une courte inspiration, la voix retombe après l’accent sur la troisième syllabe, comme pour susurrer une mélodie en mineur. Ces arides remarques de versification n’épuisent pas l’impression de charme magique qu’on éprouve dès ce premier poème, un poème qui se récite comme se chante une chanson et où l’on retrouve un écho du « Pont Mirabeau » d’Apollinaire. Redisons-nous une fois de plus la première et la dernière strophe, dont la vertu incantatoire demeure intacte à la centième lecture :
Brageirac sur la Dordonha,
Brageirac del mes de mai,
te perdèri per jamai
amb l’amor e la vergonha.
[…]
Ai ! de l’aiga que davala !
Ai ! amor que te’n vas lèu,
vers Bordèu qu’a de batèus
e Blaia pus de gabarra.
Bergerac, sur la Dordogne,
Bergerac du mois de mai,
je te perdis à jamais
avec l’amour, avec la honte.
[…]
Hélas ! coule la rivière.
Hélas ! amour qui t’en vas vite,
vers Bordeaux qui a des bateaux,
et Blaye plus de gabares.
Comme le remarque Philippe Gardy dans son ouvrage Paysages du poème (p. 101-109), tout part de Bergerac et tout y revient, le thème primordial étant l’écoulement de l’eau, des amours et du temps qui vont se perdre dans le gouffre de la mer, de la mort et du néant. Toute l’œuvre à venir va développer ce paysage d’origine et son sens symbolique.
Édouard Manet, Le port de Bordeaux [et ses gabares], 1871.
« Cançon »
Trois poèmes du recueil sont définis génériquement dans leur titre comme des chansons et tous trois sont écrits en vers de sept syllabes. Dans l’un d’eux, quatrième poème de Cap de l’aiga et simplement intitulé « Cançon », on retrouve le thème de la Dordogne et des gabares. Le poème déplore la fin des gabariers, un peu comme le long Pouèmo dóu Rose de Mistral célébrait la fin de la batellerie fluviale : « Ai ! Dordonha sens gabarras / son tots mòrts los gabarrièrs ? » (Hélas ! Dordogne sans gabare, / tous les gabariers sont-ils morts ?).
Cette chanson est en réalité une mise en abîme de chansons qui se chantent elles-mêmes : la chanson chante un gabarier mort qui chantait une fillette qui chantait un gabarier mort qui ne pouvait plus chanter et à qui elle envoyait des roses jetées dans le fleuve. Cet enchâssement circulaire où la dernière chanson contient la première exerce là encore un effet de vertige et de fascination, égrenant de surcroît des motifs récurrents dans les chants populaires traditionnels : la mer où l’on se noie, le jardin du père, la rose couleur de sang (ce dernier motif revenant fréquemment chez B. Lesfargues, comme on le verra). Motifs ponctués de soupirs lyriques qui pleurent la perte des chansons et, par métonymie, de la langue de leurs paroles. Magie de l’heptasyllabe…
Ausisses pus de cançons
– oblidaira de nevèia
mon còr, el, t’oblida pas –
que son mòrts los gabarrièrs,
ma Dordonha sangglaçada.
Tu n'entends plus de chansons
- oublieuse de la neige,
mon cœur, lui, ne t’oublie pas -
car sont morts les gabariers,
ma Dordogne au cœur figé.
Après ces deux poèmes, il faut attendre Còr prendre en 1965, pour trouver une troisième mention des gabares. Sa première section, L’aiga vièlha, commence par un poème sans titre qui décrit des gabares mortes et pourrissantes, désignées comme des roses : « Ròsa beguda, endolverada […] Gabarra sense davalada, / Ròsa poirida endolverada » (Rose bue, rose imbibée […] Gabare qui ne descend plus / rose pourrie, rose imbibée). La mort, pressentie sur le mode interrogatif dans le premier recueil, est accomplie dans le deuxième. De façon générale, Còr prendre reprend, en les amplifiant, les thèmes de Cap de l’aiga. La mélancolie devient révolte ou désespoir.
« Cançon per un mainatge »
La « Cançon per un mainatge », dédiée « à Bruno », raconte l’histoire de trois cloches qui se sont perdues en voulant faire un pèlerinage dans le ciel, à l’imitation de la lune. Un chasseur crible la lune de plombs et les trois cloches effrayées regagnent le clocher de leur église qui les attendait « coma / zo fariá la maire cloca » (comme / attendrait une mère[-poule]). « E lo gal cocodi cocoda / lo gal las saluda amb lo / riban roge de son cant » (Et le coq, cocodi cocoda, / le coq les salue / du ruban rouge de son chant).
Schéma traditionnel d’un trio (ou d’un duo) d’objets ou d’animaux familiers qui partent en vadrouille. On pense au poème de Prévert paru en 1946 : « À l’enterrement d’une feuille morte / deux escargots s’en vont… » Ici l’heptasyllabe ne soupire plus, il sautille, dans un nocturne poétique et naïf, baigné de lune et d’un peu de mystère, vision à la Marc Chagall, également familière à Lorca (« Romance de la luna, luna »). Un jeune adulte, encore enfant car nostalgique de son pays d’enfance, tente de le recréer à l’intention d’un autre enfant, sous forme de comptine.
« Los quatre aucèls de la nuèch »
C’est « dins las èrbas del cèl » que les cloches se sont perdues. Un autre poème nocturne, « Los quatre aucèls de la nuèch », commence par cette strophe, à laquelle ne manque qu’une discrète mélodie pour être elle aussi couplet de chanson :
Tota la nuèch piula un ausèl
preisonièr de l’èrba de luna,
tota la nuèch, sa votz engruna
los delicis secrèts que s’escondon pel cèl…
Toute la nuit crie un oiseau
prisonnier de l’herbe de lune,
toute la nuit sa voix égrène
les délices secrets cachés en plein ciel...
Ici « èrba de luna » et quatre oiseaux, là « èrbas del cèl » et trois cloches. Les poèmes de Cap de l’aiga se font écho les uns aux autres et tissent un réseau thématique complexe où se dessine tout un univers intérieur.
« Campanièr de Senta-Crotz »
Des éclats de cette « Cançon per un mainatge » semblent se disperser dans d’autres poèmes de ce recueil et des suivants. Nombre d’entre eux, la plupart peut-être dans Cap de l’aiga, évoquent un village chargé d’histoire et de légende, engourdi dans la chaleur de l’été, assoupi au clair de lune, immobile dans la mémoire, comme des miniatures médiévales représentant la vie rustique. Le poème qui suit la chanson pour un enfant s’intitule justement, comme en écho, « Campanièr de Senta-Crotz » et dessine ce décor de miniature sous forme énumérative : « Rumeur d’essaim dans les champs, / femme courbée dans les chaumes, / chien qui aboie, la basse-cour / endormie d’ombre ancienne / où la vie s’est arrêtée / comme une eau pétrifiée / par un miracle quotidien… »
Bruch d’eissame dins las campanas,
femna clinada pels rastolhs,
chin que japa, la bassa-cort
dormilhosa d’una ombra anciana
onte la vida es arrestada
coma una aiga en pèira virada
per un miracle costumièr.
Bien plus tard, en 2001, Bernard Lesfargues écrira 19 textes en prose sur des photos en noir et blanc de Gilles Bruneton représentant des villages, des tours en ruine, des chapelles, églises et châteaux délabrés de son canton, sous le titre Le pays de Villamblard. La boucle est bouclée après le retour au pays natal et les deux livres se répondent à cinquante ans d’écart.
« Moiracs »
À cette église de Saint-Croix (sans doute Saint-Croix de Beaumont, en Périgord), répondent celles de Moirax (« Moiracs ») et de Saint-Martin (« Òrbalutz de Sent-Martin »). Dans l’assoupissement estival de Moirax, bourgade du Lot-et-Garonne, le temps s’est arrêté. « Cap de bruch. Tanben somilha la sauvatgina / […] un tropèl d’aucas semena la paur dins lo vilatge. » (Plus un bruit. La sauvagine elle-même somnole / […] un troupeau d’oies sème la panique dans le village.) Sauvagine et oies de toujours, peut-être contemporaines du pape Urbain II, le prédicateur de la deuxième croisade qui passa par ici dans sa tournée française : « Ausirem, cu sap, damont d’aquela tuca / l’esquilon agrelet de la mula del papa Urban / amb son seguiment las e lent e chimarrat… » (Peut-être entendrons-nous du haut de ce coteau / la sonnaille aigrelette de la mule du pape Urbain / avec sa suite lasse, lente et chamarrée…). On trouve pour la première fois dans ce poème une illusion chère à Bernard Lesfargues, qu’il cultive quand le décor s’y prête et dont il aime à faire poème. Soit un monument ancien, si possible intact, sans trop de modernité anachronique autour. Il suffit de quelques animaux pour donner vie aux personnages d’histoire ou de légende qui l’ont hanté et pour s’imaginer qu’ils sont ici, quelque part à nous attendre, et les griffons ornant les chapiteaux de la nef participent à leur façon de ce bestiaire. Ce poème est assez ancien puisqu’il figure, sans titre et avec quelques variantes, en compagnie du poème « Legenda », dans l’anthologie de La jeune poésie occitane que Bernard Lesfargues composa avec Robert Lafont dans la revue Le Triton bleu (numéro préfacé par Pierre Darmangeat). Lesfargues et Lafont avaient alors 23 ans.
Eglise Notre-Dame de Moirax, CC BY-SA 3.0
« Òrbalutz de Sant-Martin »
Le poème suivant, « Òrbalutz de Sant-Martin » (Crépuscule de Saint-Martin) relate la même expérience de temps arrêté ou de voyage dans le temps. Dans le crépuscule d’un village oublié, « l’èr portava un gost de ferum / de lapinon e d’avelana. / […] Èrem pres dins l’oblit del temps… » (l’air portait un goût rustique / de lapereau et de noisette. / […] Nous étions pris dans l’oubli du temps…).
Dans le paragraphe de prose qui précède les trois strophes d’octosyllabes assonancés, le poète s’adresse à son ami destinataire : « Soven-te, ò Marc, d’aquelas oras, seràn nòstre tesaur deman. » (Souviens-toi bien, Marc, de ces heures, elles seront notre trésor demain.)
« Recòrd de Segovia »
Dans le seul poème « non aquitain » du recueil, Bernard Lesfargues transpose cette expérience à Ségovie, en Castille, mais cette fois c’est la ville elle-même qui parle pour déplorer son abandon :
Abandonadas mas muralhas,
ò carnèls gafaires de cèl,
abandonat mon Sant-Estève
coma lo mangle d’un cotèl
fissat dins la còla rimada…
Abandonnées, ô mes murailles,
créneaux qui mordez le ciel,
abandonné mon Saint-Étienne [église San Esteban]
comme le manche d’un couteau
planté dans la main de la colline...
Chanson dans la chanson (car ce poème d’octosyllabes pourrait en être une), la ville nous livre un air de sa composition, inspiré du Cantique des Cantiques I, 5 : « Negra, negra, la nuèch mai l’aiga, / ieu sei negra, mas ieu sei brava… » (Je suis noire, mais je suis belle…). Le poème s’achève sur une image qui rappelle la Dordogne à Bergerac (« Ai ! de l’aiga que davala ! ») :
una carrièra que davala,
davala que davalarà,
vèrs l’aiga que sens fin ni pausa
entre pibols marmusa e canta…
une rue qui dévale,
dévale, dévale,
vers l’eau qui sans repos ni fin
entre les peupliers murmure ou chante...
Cette rivière de Ségovie, c’est l’Eresma, sur laquelle Bernard Lesfargues écrit en 1959 un poème en français, « L’Eresma, la nuit », publié une première fois dans Bergerac et autres lieux (1993), puis repris dans La brasa et lo fuòc brandal. On y retrouve nombre d’éléments épars dans son œuvre : le noir et la nuit, le passage du temps, l’eau de glace, l’eau érotisée : « Eau glacée caparaçonnée / d’étoiles et de peuplier… ».
Le poème se termine sur une image fortement érotisée de la rivière : « Eau pour les lèvres, Eresma, / eau qui se plaint et gémit comme / l’amante aux bras de son amant. / Eau de nuit qui chante la nuit. »
« Çò que l’aiga jonjoneja »
Le recueil est un tissu, il suffit d’en tirer les fils. Suivons le fil de l’eau pour arriver à l’un des poèmes les plus évocateurs de Cap de l’aiga, un poème qui en justifierait le titre à lui seul. « Çò que l’aiga jonjoneja » (Ce que l’eau fredonne) condense toute l’inspiration du poète. À la source de cette inspiration, la naissance de l’eau, sur laquelle s’ouvre le poème : « Una aiga que nais miraclosa… » (Une eau qui naît tel un miracle…) Rappelons le sens que le poète donne au toponyme-titre dans une note finale de Brageirac e autres luòcs (1993) :
Cap de l’aiga […] est la forme languedocienne du limousin « Chap de l’aiga ». Francisé de longue date en Chapdelaygue, c’est un lieu-dit de la commune de Saint-Jean d’Eyraud. Comme le nom l’indique (« tête de l’eau »), l’Eyraud y prend sa source. Ce merveilleux toponyme est aujourd’hui déshonoré par un panneau où se lit « Chapdeleige ». À quand Chat de neige ? ou Chasseneige ?
Philippe Gardy, dans son étude déjà citée (p. 105), note justement « l’érosion des noms de lieux, la perte de signification qui en résulte ».
On a déjà rencontré « l’èrba de luna » (p. 29) et « las èrbas del cèl clar » (p. 35). Dans ce poème, le ciel est une fois de plus végétalisé, comme s’il était un reflet de la terre, une autre terre couverte de plantes et peuplée d’êtres vivants : « Que lo solelh s’es entraupat / dins la brodacha nivolosa. » (Car le soleil s’est entravé / dans la broussaille des nuages.).
Comme l’Eresma à Ségovie qui « marmusa e canta », cette rivière naissante est bordée de peupliers ; comme elle, elle « marmusa » et « jonjoneja » (murmure et fredonne) ; et pour la première fois elle parle d’Occitanie, comme si elle était la voix de ce pays ou sa langue matérialisée, mais c’est une chanson triste qu’elle fredonne : « Occitans, nòstra Occitània, / tots los camins ne son dobèrts / a la tempèsta. » (Occitans, nostre Occitanie / a tous ses chemins ouverts à la tempête.). Les moulins ont des ailes tordues « e n’espèran pus lo Quixòt / qu’ara se poirís dins lo ventre / de sa maire » (et n’attendent plus le Quichotte / qui maintenant pourrit dans le ventre / de sa mère). Le ton élégiaque du recueil s’assombrit. La source au nom défiguré pressent la fin de la langue qu’elle parle et dont elle est l’incarnation métonymique : « Mas ieu me’n vau / onte ben sabi, dins la baissa / que tot desaire se i acaba. » (Mais je m’en vais, moi, / où je sais, dans cette plaine / où tout regret prend fin.) L’eau de la source reprend ici la dernière strophe du poème « Brageirac ».
Il faut rapprocher ce poème d’un autre, écrit seize ans plus tard, en mai 68, et publié dans Ni cort ni costier, « Diga-li, Ròse » : un autre cours d’eau, le fleuve Rhône, est pris à témoin des émeutes et chargé de porter un message en forme de déclaration d’amour. Le pessimisme de la source périgourdine fait place à l’espoir volontariste du militant dans la résurrection possible d’un peuple et de sa langue : « Tu, Ròse, diga-li / a la tèrra occitana / que lèu vas rencontrar, / diga-li qu’aquí soi / per l’amor d’ela. » (Toi, le Rhône, dis-lui / à la terre occitane / que tu vas rencontrer / dis-lui que je suis là / pour l’amour d’elle.).
La dernière strophe de « Çò que l’aiga jonjoneja » conclut le poème par une image complexe et singulière :
Pel cèl espelís una ròsa
coma un jorn de far segason
e son rebat duèrm sus la lausa
au mai prigond de l’aigador.
Dans le ciel s’étale une rose
comme un jour de moisson
et son reflet dort sur la pierre
tout au fond de la source.
Une fois de plus, le ciel est un parterre. Cette fois-ci, c’est la reine des fleurs qui y éclot, la fleur de l’amour, laquelle se reflète dans l’eau de la source, juste au-dessus d’une pierre immergée qui se charge et se décore de son image immatérielle. Cette image énigmatique fait aussi songer aux roses que jette à l’eau la « drolleta » de « Cançon » pour qu’elles aillent réchauffer son ami gabarier mort en mer.
« Cançon de la cara negada »
Quant à l’image de la pierre reposant au fond de l’eau, on la retrouve développée dans la troisième chanson du recueil, « Cançon de la cara negada » (absente du recueil de 1952, mais publiée, nous apprend Philippe Gardy, dans la revue Letras d’òc en 1964), qui débute ainsi :
Dins lo fons del fons de l’aiga
es tombada e s’es negada
una cara qu’ai aimada.
Dison d’uns que qu’es ’na pèira.
Quand lusís la creson pèrla
o peis de l’escalha freja.
Au fond tout au fond de l’eau
un visage que j’aimais
est tombé et s’est noyé.
Les uns disent que c’est une pierre,
qu’elle brille et c’est une perle
ou un poisson froid d’écaille.
Le visage noyé de la femme prend ici l’apparence de « peis o pèrla o ben tot pèira ». Peut-être est-ce sur cette pierre-visage que se pose le reflet de la rose céleste dans le poème « Çò que l’aiga jonjoneja ». Son interprétation est ouverte : amante noyée par désespoir, amour défunt ou langue oubliée. En tout cas, c’est l’oubli qui l’emporte définitivement, le dernier vers du poème reprend le premier : « e lo recòrd s’es negat / dins lo fons del fons de l’aiga. » (et s’est noyé le souvenir / au fond de l’eau tout au fond.)
« Al ròc d’Anglars »
L’histoire de la femme noyée est reprise dans le poème suivant, l’avant-dernier du recueil, « Al ròc d’Anglars » (dont Philippe Gardy remarque qu’il ne figure pas dans la première édition de Cap de l’aiga en 1952, mais qu’il fut publié dans la revue Òc en 1948, soit plus d’un demi-siècle avant sa reprise dans La brasa e lo fuòc brandal). Là encore, une chanson s’insère dans le poème : le poète, « per gardar una contenéncia », chantonne (canturleja) la chanson traditionnelle de Jeanne d’Aymé, où la malheureuse héroïne se noie de chagrin au pied du roc d’Anglars : al ròc d’Anglars / i a ’na clara fontana. On sait que cette vieille chanson, dont Joseph Canteloube a harmonisé la mélodie dans ses Chants d’Auvergne, a inspiré Louisa Paulin, entre autres écrivains occitans.
Pour résumer prosaïquement l’histoire, le poète se penche sur la source et croit y voir, par les yeux du souvenir, le visage d’une femme qu’il a aimée, tandis que lui revient aux lèvres la chanson de Jeanne d’Aymé, noyée par désespoir.
Ta cara la vesi tremblar
dins l’aiga de totas las fonts
[…] mas sabi pas ont te dirai
los mots d’amor qu’ai sus las pòtas
dempuei lo temps que ta cara
s’es negada dins quela fontana
Ton visage je le vois qui tremble
dans l’eau de toutes les sources
[…] et j’ignore où je te dirai
les mots d’amour qui sont sur mes lèvres
depuis le temps où ton visage
dans cette source s’est noyé.
Ainsi, « Çò que l’aiga jonjoneja » forme une sorte de triade poétique avec « Cançon de la cara negada » et « Al ròc d’Anglars ». On comprend mieux le sens que peut prendre le reflet de la rose céleste sur la pierre de la source, un hommage crypté, le souvenir d’un amour de jeunesse, peut-être plus rêvé que vécu.
« Arma, mon arma »
Le même ton élégiaque baigne les autres poèmes du recueil, composés du même vocabulaire symbolique. Après le « Bergerac » inaugural, qui parlait de l’amour qui s’en va, « Arma, mon arma », le deuxième titre de Cap de l’aiga, pourrait être la complainte d’un cœur amoureux, qui tente de se consoler sur un ton désabusé en désenchantant le monde :
Qual escriguèt qu’una estèla
es l’amiga d’aqueu mond ?
[…] L’estèla es non mas una estèla
[…] Amaga-te, ò nevèia
de las tucas de mon cèl.
Qui a écrit qu’une étoile
est de ce monde l’amie ?
[…] L’étoile n’est qu’une étoile
[…] Efface-toi, ô neige,
des coteaux de mon ciel.
Dans l’avant-dernière strophe, l’injonction « Amossatz-vos nècias flambas, / morirai jamai d’amor » (Éteignez-vous, sottes flammes, / je ne mourrai jamais d’amour) peut se comprendre comme un refus de la rhétorique amoureuse rebattue.
On remarquera que la neige est toujours désignée dans la poésie de Bernard Lesfargues sous sa forme dialectale « nevèia », à laquelle il semble tenir comme un terme d’enracinement, de même qu’il emploie souvent le mot « tuca » pour désigner le coteau.
« Espèra »
Dans le poème « Espèra », le poète joue sur l’opposition entre attente et désespoir (espèra e desespèr), issus de la même racine en occitan :
Se sabiá que venguèsses pas,
te cercariá al fons del desespèr
ont florisson las ròsas de la sau…
Si je savais que tu ne viennes pas
je te chercherais au fond du désespoir
où fleurissent les roses de sel…
De sombres images transfigurent l’attente, dernier refuge d’un cœur en peine, transformant « la nuèch longa » en un vaste et somptueux espace de désolation : « una selva de lenha mòrta, de glais e de desaires » (une forêt de bois mort, de glaïeuls et de regrets).
« Legenda »
À l’instar du poème « Al roc d’Anglars » qui rappelle la légende de Jeanne d’Aymé, et cite, comme on l’a vu, deux vers de sa chanson, le poème intitulé « Legenda » évoque de façon tout aussi allusive le tragique destin du seigneur de Fages (commune de Saint-Cyprien, où son château existe encore), dont on apprend qu’il fut tué de trois coups d’arquebuse au lieu-dit la Bessède, alors qu’il chassait le loup-garou. Nous n’en saurons pas plus. Reste cette chanson, au vers-refrain cinq fois répété : « Ont moriguèt lo senhor de Fajas… » et une histoire contée en pointillés, comme si l’oubli l’avait à moitié effacée. Ce poème figurait lui aussi avec « Moiracs » dans l’anthologie du Triton bleu, en 1946.
« Lo flume dau matin » « La patz del ser »
Deux poèmes de neuf vers chacun se répondent et s’opposent. « Lo flume dau matin » rêve au beau fleuve que feraient « las fonts tindantas » (les sources résonnantes) et « los cants de l’auselum » (les chants des oiseaux) s’ils « se glissaient au mois de juin dans les villages qui s’éveillent ». À ce chant du réveil plein de clarté qui doit son élan à l’heptasyllabe, fait écho « La patz dau ser », poème empreint de sérénité mélancolique (vers de six syllabes), que baigne
una clartat de sòm
ont la votz d’un mainatge
fai dindolar ambe delici
lo cristal sorne un pauc de vièlhs remembres
une clarté rêveuse
où la voix d’un enfant
fait délicieusement tinter
le cristal un peu terni de vieux souvenirs.
Certaines inflexions rappellent l’ambiance poétique des Sòmnis dau matin de Max Rouquette : « tota la patz d’un ser, clartat de sòmi, de vièlhs remembres ». Curieusement, le recueil Cap de l’aiga s’achève sur une variante sans titre de ce poème : « Tota la patz d’un ser » devient par exemple « Tota la patz del ser ». Le poète y déclare dans les derniers vers, en guise de conclusion et peut-être de commentaire rétrospectif des poèmes précédents : « E çò qu’en ieu demòra / coma un rebat de sòmi / es la votz d’un mainatge… » (Et ce qui demeure en moi / comme un reflet de rêve / c’est la voix d’un enfant…).
*
Dans ce survol de Cap de l’aiga, on aura été frappé par le goût de Bernard Lesfargues pour les formes simples et populaires. Sa poésie s’inspire des romances (dans les deux sens du mot, au masculin et au féminin), des complaintes, comptines et rengaines. Dans la transparence et la lisibilité de ses poèmes, sous leur apparente spontanéité, on découvre un réseau complexe d’images, dont le sens est très ouvert, mais qui expriment, avec une pudeur traversée de quelques éclats de voix, une blessure intime, à la fois amoureuse et étroitement liée à son pays.
Au-delà de ce recueil, l’ensemble de l’œuvre poétique présente une belle et profonde unité, malgré des tons très différents, du murmure élégiaque devant la Dordogne qui s’écoule, jusqu’au coup de gueule de mai 68 à Lyon ou la vaine révolte contre l’âge et la mort (Finie, la fête, 2004). Elle exprime d’un bout à l’autre le même sentiment d’incomplétude existentielle, d’imperfection ontologique, d’impermanence des êtres, des choses et des langues.
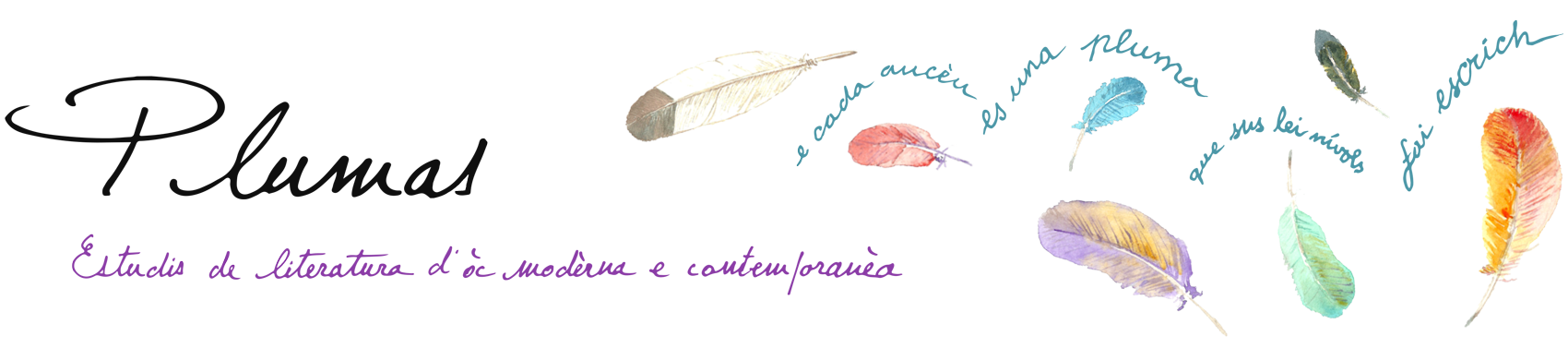
![Édouard Manet, Le port de Bordeaux [et ses gabares], 1871.](docannexe/image/1080/img-1-small800.jpg)
