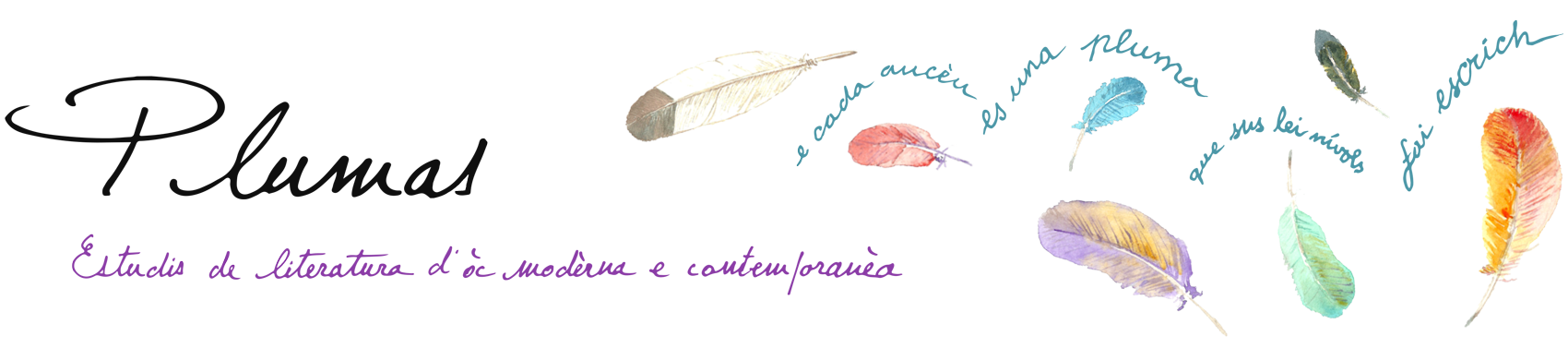Écrites en prose et figurant juste avant la Table des matières, les deux dernières pages du livre de Bernard Lesfargues (Lesfargues 2014) ne sont pas précédées d’un titre qui aurait pu être, comme cela se produit souvent chez les poètes d’aujourd’hui en Europe : « Note », « Note initiale », etc., ce qui permet à un écrivain d’introduire quelques remarques très personnelles, afin d’éclairer ou même d’orienter ses lecteurs. Cependant, le texte qui figure dans ces deux pages de Bernard Lesfargues, dont la signature – B.L. – s’inscrit à la page 46, nous paraît essentiel dans la mesure où il aborde strictement les questions relatives à la création poétique, le pourquoi et le comment de l’écriture en langue française dans Odes et autres poèmes.
Un premier point retient l’attention : nous apprenons ici que les textes publiés dans ce recueil ne sont pas récents, qu’ils sont longtemps restés dans des tiroirs avant d’être relus par l’auteur, et surtout corrigés, parfois même modifiés, ce qui a amené l’écrivain, pleinement responsable et indépendant, à les publier. Nous, lecteurs, sommes donc totalement libres face à ce contexte et ce qui nous importe, c’est d’effectuer une lecture rigoureuse des mots de chaque poème, sans avoir à nous servir de circonstances biographiques que nous pourrions être tentés de plaquer sur l’écriture poétique afin de mieux l’expliquer. Nous nous attacherons au déchiffrage des enjeux poétiques, c’est-à-dire des structures et des formes de celui qui prend la parole dans les poèmes et que nous désignerons ici par les termes de locuteur ou de voix poématique.
Un deuxième point est abordé par Bernard Lesfargues avec la plus grande rigueur : il s’agit du fait d’écrire en langue française, et non en occitan, langue majoritairement présente dans son œuvre. Le choix du français ne déclenche ici aucun long développement car la question est résolue depuis fort longtemps. Toutefois, des lecteurs ont souhaité connaître la raison qui a conduit le poète à délaisser l’occitan dans Odes et autres poèmes, alors que son œuvre poétique est surtout écrite en cette langue. Bernard Lesfargues évoque avec humour ses « rares lecteurs » et se montre totalement conscient de ses choix, tant en ce qui concerne l’occitan qu’il a courageusement défendu que le français qu’il a si souvent utilisé en poésie.
Il n’y a dans ce texte aucun signe de vanité, aucune allusion au succès des poèmes, tant en occitan qu’en français, si souvent commentés par les hispanistes et les catalanistes, lors de colloques ou au cours de lectures et si fréquemment inscrits dans des communications qui ont donné lieu à des publications fortement consultées.
Un troisième et dernier point est abordé à la fin de ce texte de Bernard Lesfargues : il s’agit de l’harmonie qui doit prédominer dans l’écriture et de la nécessité de lire les poèmes à haute voix « afin d’en percevoir la musicalité. » (p. 46). La dernière phrase met en valeur l’exigence du poète et une conscience aiguë de la difficulté de la création poétique, des échecs possibles et même probables de l’écriture. Le locuteur est étranger à toute idéalisation ou sublimation en poésie.
La lecture des Odes et autres poèmes se fera selon trois axes, qui, bien entendu, sont loin d’épuiser les richesses de ce recueil de Bernard Lesfargues. En un premier temps, l’analyse s’attachera à la perception de la temporalité par le locuteur-poète. En second lieu, l’on étudiera les jeux et enjeux de l’écriture et surtout, plus précisément, la place des mots, la syntaxe et la composition des vers. Enfin, l’on s’attachera spécialement à l’étude du lyrisme dans les Odes et dans les autres poèmes.
Une obsédante temporalité
Dès la première lecture s’impose la présence d’un locuteur qui se sert de la première personne du singulier dans vingt-et-un textes sur vingt-cinq, un « je » qui manifeste une fréquente angoisse face au passage du temps. La mémoire joue un grand rôle dans ce livre, de même que l’observation des changements et mutations dus aux saisons, les vœux et les rêves, les regrets et aussi tous les signes d’une intense souffrance face à ce que le temps dérobe ou réduit au silence. Cependant, à la fin de plusieurs poèmes, le moi prononce des mots d’espoir, même après avoir dit que l’espérance est un rêve. Le temps reste donc une obsession, mais le lecteur est frappé par la diversité de l’écriture car chaque poème n’existe que pour inscrire du nouveau, sans ressemblance avec le poème qui précède et celui qui le suit.
Le deuxième texte du recueil, « Tant de rues » (p. 9), évoque les craintes qu’éprouve le locuteur pendant ce temps quotidien qu’est la nuit. Encore que dénué de ponctuation, puisque seul figure le point final au dernier vers, ce texte se fonde sur une symétrie quasi majoritaire, puisqu’il se compose de trois quatrains suivis d’un quintil et il s’appuie sur l’isométrie car le seul vers employé est l’heptasyllabe. Chaque strophe suit le schéma rimique ABAB et le quintil adopte le modèle ABABA. Dans les quatrains, le seul temps grammatical est le présent de l’indicatif, consacré à la douleur, mais les trois derniers vers du quintil se placent sous le signe du futur, qui traduit chez le locuteur le désir d’échapper au désespoir. Le moi ne raconte aucune anecdote et il ne décrit pas non plus les douleurs de l’intériorité, ni les soucis ni la peur ni les fantasmes. La temporalité n’est signalée que par la mention très sobre de l’heure :
Et cette voix qui m’obsède
Et cette main que je fuis
Ces songes à quoi je cède
Cette horloge de minuit (p. 9),
mais deux vers retiennent l’attention à cause de la juxtaposition de trois mots dont deux ne devraient pas être employés à côté l’un de l’autre, sous peine de pléonasme, mais qui, ici, traduisent l’épaisseur active du temps :
Je connais tous les phantasmes
De la nuit noire et nocturne (p. 9).
Certes, l’expression « nuit noire » est courante et même familière, mais la nuit ne peut être « nocturne » ou plutôt elle n’est pas que noire, donc visible, mais, si elle est nocturne, c’est que son essence est d’être la nuit même.
Ce texte est donc d’abord une construction musicale où l’ordre langagier permet de suggérer l’impossibilité ou la difficulté de nommer le temps, d’où l’image finale de la brisure des urnes et la présence de ce dernier vers,
De vent pleines et de flammes. (p. 9),
qui pourrait être simplement formulé ainsi : « pleines de vent et de flammes », mais le poète a placé les mots dans un ordre différent afin que le lecteur perçoive la violence finale après un vers idéaliste du quintil qui s’annonce au futur :
Mais je sauverai mon âme (p. 9).
Cette strophe finale est donc bien l’image complexe d’une démarche intérieure constamment remise en question.
Le troisième poème du recueil, « Ode à mes souliers » (p .10-11), est radicalement différent : il s’agit d’un texte compact où la ponctuation est couramment utilisée, où deux types de vers alternent, l’alexandrin composé de deux hémistiches et le dodécasyllabe accentué sur 4-8-12. Cette ode est la deuxième de ce livre et, en tant que telle, elle est censée avoir des liens avec la définition d’un certain type d’écriture, celle de l’ode, mais le titre met en évidence l’utilisation d’une forme noble ou savante pour célébrer une réalité modeste, des chaussures déjà qualifiées par un vers de Boileau que cite en exergue Bernard Lesfargues, Mes souliers grimaçants, vingt fois rapetassés. Boileau (p. 10). Dès le premier vers, le poète réutilise le mot de Boileau dans une phrase exclamative ardente :
Ô vieux souliers rapetassés, que je vous aime ! (p. 10).
Et il proclame son amour pour ses souliers qui méritent et exigent une célébration dans une ode. Ce poème évoque donc d’anciennes marches du locuteur dans Paris : la temporalité est ici un passé perdu et le mot fondateur est ici la mémoire, tandis que le locuteur tente de se souvenir, en particulier de ses gestes, pour parvenir à retrouver une identité :
quelle heure à tout jamais perdue, ô ma mémoire,
d’un passé méprisé et chéri tour à tour, (p. 10) ;
toi dont je cherche le visage au fond des nuits. (p. 10).
Les modestes souliers « rapetassés » suscitent l’émotion du locuteur et tout le poème consiste en une méditation intense, élégamment formulée, fondée sur l’extension des vers, sur la longueur d’une phrase centrale de huit vers (« Quelle heure lourdement… »). L’évocation du passé a de l’ampleur et cette ode n’inclut aucune raillerie, aucun mot dévalorisant.
Cependant, si le passé reste omniprésent dans un poème intitulé « Recommencer » (p. 13), il l’est sous des formes différentes. La nostalgie s’inscrit ici, en ton mineur, avec des heptasyllabes et des octosyllabes qui alternent ainsi qu’avec un tétrasyllabe et un disyllabe. Le locuteur parle à mi-voix, avec douceur, sans recourir à la métaphore, mais le titre du poème est démenti par les derniers vers porteurs de mélancolie. Le présent du subjonctif traduit certes le désir d’agir et l’écoute du chant triste d’un oiseau suscite de l’espoir mais dans une seule et même phrase surgit d’abord, sur le ton de la confidence familière, un début d’espoir, une possibilité, toutefois sans verbe actif dans ce segment interrompu,
Patient, j’écoute et me dis
qu’un jour peut-être, un jour, (p. 13),
tandis que la fin de la phrase passe au futur qui sera résolument négatif :
et je suis certain que ce jour
ne sera pas. (p. 13).
Les trois derniers vers, inscrits au conditionnel et au subjonctif, suggèrent que ce qui n’a pas eu lieu l’a été de fort peu. Le regret s’insinue avec des répétitions et surtout surgit le verbe au subjonctif : « recommençât », forme rare, peu employée dans la vie ordinaire et qui représente ici le non-accès au recommencement :
Mais il aurait fallu si peu de chose,
si peu,
pour que la vie recommençât (p. 13).
Le poème intitulé « Depuis si longtemps » (p. 14-15) est clairement mis en relation avec le précédent, puisqu’il évoque un avenir négatif, donc tout ce qui n’aura pas lieu. Cependant, le ton du locuteur se caractérise par une certaine véhémence qui réside dans l’emploi de quelques procédés non utilisés jusqu’ici en ce début de recueil. Les verbes sont majoritairement au futur de l’indicatif :
Nous ne verrons plus les noces de la salamandre,
nous ne verrons plus le lièvre gambiller dans la prairie,
nous ne saluerons plus les grands frênes
enracinés dans le ciel
et nous méconnaîtrons la fragilité de la bruyère. (p. 14).
L’anaphore est de mise : elle concerne la perception du monde, mais aussi l’échec du langage dont se sert le locuteur, au point d’ailleurs de le perdre peu à peu :
Beaucoup de mots sonneront creux,
beaucoup de mots nous deviendront oiseux, (p. 14) ;
Nous chuchoterons la litanie
de tout ce que nous avons perdu
au cours des années ardentes (p. 14).
Un choix s’impose au long du texte, qui consiste à employer le pronom de la première personne du pluriel, « Nous », qui ne désigne pas un couple particulier ou des personnes connues, mais tous les lecteurs qui sont aussi des écrivains ou qui, du moins, se servent du langage écrit. La polymétrie est ici d’usage : se succèdent en effet quelques vers brefs (un trisyllabe, un tétrasyllabe) qui alternent avec des hexasyllabes, des hendécasyllabes et aussi des vers de treize syllabes. La métaphore n’est pas majoritaire et le poète ne se prévaut pas de fréquents jeux de mots, tels que « serments » et « sarments » :
Quel souvenir gardons-nous des serments échangés,
des sarments dont la fumée clôture l’automne ? (p. 14).
La pesée du temps, annoncée dès le titre du poème, est à nouveau formulée à la fin du texte et de manière décisive, mais grâce à une image du dernier vers :
Et les étoiles mortes depuis si longtemps. (p. 15).
Les mêmes mots ont d’autres sonorités et l’image des étoiles filantes, dont la lumière nous parvient alors qu’elles ont disparu, confirme pleinement la notion d’une visibilité éteinte de ce qui fut.
Cependant, les quatre années qui séparent les deux rédactions de ce texte (27 novembre 2007 et 11 décembre 2011) (p. 15), ne nous éclairent que sur la libre décision du poète qui a retenu une version définitive. Si le texte initial nous était connu, nous aurions tout loisir d’analyser l’évolution du langage entre 2007 et 2011 mais, même en n’en disposant pas, nous sommes amenés à réfléchir sur le passage du silence à la réécriture. Quelle que soit la langue utilisée par un poète, chaque texte a sa propre histoire, ses aléas, et, si chez certains écrivains, demeurent des brouillons non publiés, en revanche, chez d’autres, un poème risque toujours d’être détruit, sans qu’à sa place surgisse un nouveau poème qui serait en quelque sorte un remplaçant. Nous lecteurs ne pouvons pas nous prononcer en faveur de tel ou tel choix, mais les deux dates apposées par Bernard Lesfargues à la fin de « Depuis si longtemps » mettent en exergue les liens complexes qu’entretient l’acte d’écrire de la poésie avec la difficile temporalité quotidiennement vécue par un auteur.
Dans un poème composé d’une seule phrase de dix-sept vers, tous écrits en heptasyllabes, et intitulé « Nos visages de demain » (p. 16), où l’emporte à nouveau le pronom de la première personne du pluriel, « Nous », s’inscrit très nettement l’opposition très forte entre le passé et le présent. Ici s’opère une dure remise en question du passé. En effet, en un premier temps (quatorze vers), le locuteur avoue que sa mémoire est abîmée et son histoire dilapidée mais, dans les trois derniers vers, sans aucune justification, réapparaissent les mots du titre, « nos visages de demain » (p. 16), dans le cadre d’une aurore symbolique et aussi par le biais de deux mots qui ont la même rime : « encore » et « aurore » :
et nous poursuivons encore
pour trouver dans quelle aurore
nos visages de demain. (p. 16).
Le poème intitulé « C’est l’heure terrible » (p. 19) nous ramène au présent immédiat, quotidien, où aucune allusion n’est faite au locuteur et pas davantage au « je » qu’au « nous » : seul le « on » est ici employé :
Quand on ouvre une porte, on ne sait pas
ce qui pourrait surgir derrière (p. 19).
Nous sommes en présence d’une famille – un enfant, sa sœur, la grand-mère –, le soir, dans leur logis, entre vent et pluie. La référence à un chapelet et au diable – le Malin – est évidemment critique et sur le ton humoristique. Ce poème relève-t-il d’une préoccupation sociale ? Le locuteur a-t-il voulu inscrire dans ce poème une certaine image des autres, sans rapport direct avec lui, en guise de témoignage sur l’immobilité d’un groupe familial ? Un abandon ou un oubli des pauvres est-il signalé ? L’heure terrible serait-elle celle de la solitude de ce groupe ? Ce poème est-il une simple image, une sorte de photographie sur laquelle nous ne nous posons pas toutes les questions qu’avaient suscitées les textes précédents ? Serions-nous en présence d’une ébauche de poésie engagée ?
La lecture du poème suivant nous écarte de cette hypothèse quelque peu réductrice. En effet, ce texte, intitulé « J’aime » (p. 20), nous ramène à la voix personnelle strictement individuelle, qui est celle du locuteur. Il n’y a ici aucune ponctuation, aucun point final après le dernier vers. La polymétrie s’impose, mettant en valeur des pentasyllabes. La structure strophique se fonde sur une symétrie partielle : un premier tercet précède un quintil, lui-même suivi de deux tercets. Le titre du poème, « J’aime », devient le vers initial de chaque strophe, ainsi placée sous le signe du verbe dont les compléments occupent les vers de chaque strophe. De quoi s’agit-il dans ce poème ? Le locuteur mentionne des lieux, des sentiments, des choses qu’il aime et qui se caractérisent tous par leur finitude ou par leur négativité. Ce texte vertical est marqué par la reprise ponctuelle de certains mots (« les », « qui », « j’aime »). Le locuteur, qui parle exclusivement de lui-même, entre donc dans une même structure grammaticale qui se répète dans chaque strophe et le verbe, « j’aime », peut apparaître comme le refrain de ce poème qui a l’allure d’une chanson. Il y a là un paradoxe, puisque le moi aime systématiquement ce qui est négatif et destructeur, mais les deux derniers vers introduisent un nouveau paramètre, car le locuteur, sans autre justification, évoque ce qui subsiste, donc positivement, dans ce qu’il aime. La rime qui s’établit entre le négatif et le positif,
les amours qui meurent
et ceux qui demeurent
de tout ce que j’aime (p. 20),
signale ainsi la double perception du temps, c’est-à-dire l’achèvement par la mort et la persistance de la vie qui confirme la reprise du verbe qui figurait dans le titre :
de tout ce que j’aime (p. 20).
Dans un autre poème, qui a pour titre « Du calme » (p. 25-26), nous retrouvons un éloge du silence et de l’harmonie et aussi celui d’un temps en mutation qui serait apaisant pour la nature et les hommes :
le temps pour un instant laissant du temps au temps (p. 25).
Or, ce calme ne dure pas et diverses personnes s’agitent, ce qui se traduit par les gestes et les cris des adultes ainsi que par la perte de toute harmonie dans la nature. La polymétrie règne dans ce poème où interviennent à la fois des hexasyllabes, des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, et aussi un pentasyllabe… Le locuteur retrouve ici un espace familial peu propice à l’écriture et à la contemplation et il rêve de solitude, comme le disent les trois derniers vers :
Je rêve d’une combe et d’un lit de fougère,
d’une terre légère et d’une odeur de menthe,
d’un silence d’aiguilles de pin (p. 26).
Ce texte (p. 25-26) nous paraît donc proche de « C’est l’heure terrible » (p. 19) et aussi de « Grand-Castang » (p. 31-32), où le locuteur évoque un village du Périgord avec seulement deux personnages : un gamin à bicyclette et une vieille dame qui entre à l’église. Ce qui l’emporte ici c’est le silence radical, l’impossibilité d’avancer et de changer : le locuteur se demande si un jour, c’est-à-dire plus tard – mais quand ? – le gamin cassera le silence, ce qui créera peut-être le retour du temps :
On dirait que personne ne réside dans ce village.
Un silence que rien ne brise, mais que brisera
un jour, qui sait, le gamin
qui fait des ronds avec sa bicyclette. (p. 31-32).
Dans le rapport au temps, il arrive que surgissent l’oubli et la perte du souvenir, mais le locuteur passe outre et il évoque des images qui, dans son esprit, restent extrêmement précises. Ainsi, dans le poème intitulé « Hubert Robert del. »1 (p. 36), le locuteur ne parvient pas à se souvenir du nom d’un village de Sardaigne où il s’était trouvé et il le dit dans les deux premiers vers, mais ensuite il décrit des thermes avec beaucoup de précision, il évoque des dalles et des fragments de colonne ainsi que des paysannes qui y lavaient leur linge dans une eau abondante. Cette évocation suggère au locuteur l’idée que ces paysannes n’ont émis aucune interrogation sur ces lieux,
Généreuse, l’eau coule et lave le linge
de ces paysannes accroupies.
Aucune
ne se soucie du dieu qui favorise leur tâche.
Et si jamais on leur montrait
un dessin d’Hubert Robert
elles ne reconnaîtraient pas le lieu
et ne se reconnaîtraient pas elles-mêmes. (p. 36),
alors que lui-même parle des dieux anciens et s’interroge sur un éventuel tremblement de terre qui, jadis, aurait détruit tous les bâtiments. Le locuteur n’émet aucun jugement et il ne prend pas position, mais, de fait, les fragments de colonnes sont les signes visibles d’un passé que l’on tentera ou non de traduire et d’interpréter.
Détail du tableau d’Hubert Robert, Ruines d'un bain romain avec lavandières, après 1766, Philadelphia Museum of Art.
Cependant, le souvenir peut avoir aussi d’étonnantes et intenses résonances chez le poète, à la fois grâce au regard et grâce à l’ouïe, ainsi dans « Des coqs chantent » (p. 37), qui est l’un des textes les plus riches de ce livre. Le locuteur célèbre ici la force et la diversité de ses souvenirs, qui sont présents en lui, non point de manière passive, mais du fait qu’ils produisent un chant, celui-ci étant au cœur même de la mémoire. Deux anaphores président avec bonheur les deux premières strophes qui sont un quintil et un huitain :
Des coqs chantent dans ma mémoire (p. 37).
Les coqs du souvenir incarnent une pleine créativité sonore, à la fois dans le passé et dans le présent de l’écriture, mais nous découvrons que des noms sont également présents dans l’esprit du locuteur ; ces noms sont esthétiquement « beaux » (p. 37) et certains sont ceux des amis, mais, de fait, le locuteur accède ici à une parfaite connaissance de bien d’autres noms relatifs à la nature, ainsi à la rivière, aux ronds que fait la pluie dans l’eau. Sans transition, le poète introduit alors dans son discours, au pluriel, le mot « poèmes » qui renvoie aussi à la mémoire et dont il se souvient parce qu’ils contiennent des noms qu’il aime. Le premier vers du septain met en valeur ce qui semble être une conséquence de ce qui précède, c’est-à-dire le fait de vouloir écrire un poème, ce que souligne le verbe au futur :
J’écrirai un poème
sur la chauve-souris en papier de soie (p. 37).
Suivent alors tous les animaux et les êtres sur lesquels portera l’écriture.
Mais ce poème tripartite, qui ne comporte que trois points, dont un à la fin de chaque strophe, a pour titre « Des coqs chantent » (p. 37). Les vers 1 et 6 en sont le prolongement, mais, face à l’unité textuelle de ces trois strophes, la présence des espaces blancs nous interroge et surtout la place donnée à un seul vers qui était déjà inclus en tant que vers 2 :
Des coqs chantent dans ma mémoire (v. 1),
je me souviens d’une église romane (v. 2) (p. 37).
Ce souvenir ne donne lieu à aucune description et il est en soi essentiel mais cette simple évocation en rend la survivance d’autant plus intense.
L’un des derniers poèmes, « Minuit » (p. 39), qui est un brillant jeu verbal, fait pour la lecture orale, ici à deux voix, celle de la poésie et celle des chiffres, se fonde sur l’emploi de vers échelonnés pour inscrire poétiquement les douze coups de minuit, ceux-ci figurant à quatre reprises sous la forme de trois chiffres entre 1 et 12,
La cloche au clocher de la nuit
tisse douze coups
un deux trois
Le vent ne s’en soucie pas et poursuit
un rêve qu’il n’achèvera pas
quatre cinq six (p. 39).
Ce parcours, scandé par les trois syllabes chiffrées, marque un aboutissement car minuit est bien la fin du jour, mais ici intervient, de manière inattendue, l’image métaphorique d’une toile qui devient la présence du temps :
et les douze coups
dix onze douze
sont douze solides fils d’une toile
où, prisonnier, le temps
s’immobilise. (p. 39).
Le point final de ce texte, qui était jusque-là dépourvu de ponctuation, entérine donc une affirmation indiscutable qui n’a pas besoin d’être justifiée ou démontrée. Dès lors, le temps est un mot qui se suffit à lui-même et le verbe, « s’immobilise », dernier mot du poème, interdit tout autre retour à la temporalité.
Odes et autres poèmes : jeux et enjeux du langage
Cependant, quelle que soit l’intensité de ce langage habité par la réflexion sur le temps, à la fois profonde et nourrie d’universalité, nous lecteurs sommes frappés, dès le départ, par le ton ou plutôt par les tonalités du discours que tient le personnage du locuteur, par la jonction entre l’inventivité poétique, la familiarité et l’humour. Jamais nous ne nous lassons de ces textes : nous nous arrêtons pour jouir d’un simple vers ou d’un seul mot, puis pour percevoir une image. À aucun moment nous ne nous éloignerons du locuteur qui ne cessera de nous surprendre et de nous interroger. Il n’y a pas ici d’exhibition ni même d’individualisme : le moi est poète et sa création nous concerne. L’on passe donc parfois de l’émotion à la drôlerie, de la beauté d’un paysage à une question qui n’a pas nécessairement de réponse.
Plusieurs procédés sont ainsi mis en jeu dès le premier poème, « Ode à la nuit, un » (p. 7-8), et nous repérons tout d’abord la juxtaposition de faits qui s’opposent ou qui, du moins, s’excluent dans le vécu habituel. Le moi parle ainsi de son amour pour son aimée :
Ton nom m’est un paysage déchirant de solitude,
le froissement de l’air sous l’aile d’un ramier.
J’ai mal au cœur ce soir comme le premier soir
que je t’aimai. La nuit s’est dévêtue. J’attends (p. 7).
L’indéniable passion est donc inséparable de la douleur ou de la souffrance, mais le poète ne cesse d’exprimer cet amour ; or, il est impossible d’en rester là car il s’agirait d’un simple topique, d’où le passage à un langage qui tient à distance la grandiloquence et, en particulier, au refus de la sentimentalité en poésie, l’adjectif « attendrissants » étant une trouvaille inattendue, reprise par trois fois :
Et je pourrais ce soir écrire des vers attendrissants. (p. 7) ;
Ô vers attendrissants et un peu bêtes. (p. 7) ;
Je vais écrire des vers attendrissants pour oublier
que tant d’amour m’oppresse. Suis-je ce chien
qui jappe dans le silence de la nuit ? (p. 8).
Après un dernier espace blanc, le dernier vers signale l’alliance possible entre l’écriture et le monde,
Doucement, je dis ton nom. Tu sais, le monde existe. (p. 8),
c’est-à-dire la résultante d’une parole de poète pleinement conscient, qui mérite d’être écoutée.
Quand le locuteur répète plusieurs fois un mot, dans une même strophe ou dans une même structure symétrique, le lecteur guette l’emploi, ludique ou non, de la récurrence. L’anaphore est un procédé peu fréquemment employé dans ce recueil, mais dans deux poèmes elle détermine l’existence du fait poétique : il s’agit de « Chemin du bord de l’eau » (p. 12) et de « J’aime » (p. 20), que nous tenterons d’analyser ici, mais qui exigeraient encore bien d’autres relectures.
Chacun des dix-sept vers dont se compose « Chemin du bord de l’eau » commence par le mot « chemin », substantif non précédé de l’article, d’où l’existence d’une sorte de verticale initiale fondée sur l’usage des deux syllabes de « chemin ». À trois reprises, s’impose dans le texte la répétition de deux vers :
Chemin du bord de l’eau
chemin du barrage (p. 12),
c’est-à-dire les vers 1 et 2, 7 et 8, 16 et 17, donc le début, le milieu et la fin du poème. Le premier vers évoque l’harmonie que suggère le voisinage du chemin et de l’eau, le deuxième désigne le but de ce chemin, le barrage, qui, certes, est utile par définition, mais qui est aussi le signe d’un arrêt, voire d’un empêchement, et, dans tous les cas, une limite. Le texte comporte, de fait, deux séries de vers entre les trois anaphores qui évoquent différemment les rôles de deux espaces. D’une part, quatre vers font apparaître le plein soleil, le ciel et l’eau, la nuit et les étoiles, la couleur verte qui annonce l’orage, le ciel couvert et la brume : l’on voit coexister la beauté absolue de la nature et les variations prévisibles du temps. Aucune présence humaine ne surgit donc dans cet ensemble d’images. Mais, d’autre part, dans un groupe de sept vers, se succèdent cailloux, arbres, oiseaux familiers, tandis que barques et pédalos sont par nature liés à l’homme et le lecteur qui découvre alors le premier vers de l’anaphore, « Chemin du bord de l’eau », s’attend à lire le deuxième vers, mais cela n’a pas lieu car le chemin est qualifié de « fantasque », mot synonyme de « capricieux », tandis que, dans un même vers, s’impose exclusivement l’humain, « chemin des joies chemin des illusions », qui précède l’anaphore finale, le retour pour la troisième fois à un refrain : « chemin du bord de l’eau / chemin du barrage. » (p. 12). Ce poème ne comporte aucune ponctuation (sauf le point final), mais le rythme des vers traduit subtilement les variations entre les deux moments porteurs d’images. En effet, « chemin du bord de l’eau » est un hexasyllabe (2-4-6), tandis que « chemin du barrage » a une syllabe de moins (2-5).
Le locuteur reste résolument absent de ce texte où ni le « je » ni le « nous » ne se manifeste. Si le cosmos incarne la beauté absolue, alors que les joies et les illusions sont exclusivement humaines, il n’en est pas moins vrai que les mots « orage » et « opaque » sont des signes menaçants pour la nature. Un vers retient particulièrement l’attention : « chemin fantasque » : ce tétrasyllabe y est personnifié, mais négativement et la position unique de l’adjectif frappe le lecteur, car, dans les vers qui précèdent, ne surgissent, après le mot « chemin » que les prépositions « de » et « du ». Un seul autre vers est dans ce cas : « d’arbres fidèles », qui est aussi le seul à ne pas comporter le mot « chemin ». Ces rares variantes, qui ressortent dans la structure symétrique globale, sont très perceptibles lors d’une lecture orale du texte : elles ne sont pas le fruit du hasard et elles révèlent, bien au contraire, l’extrême exigence de l’auteur lorsque celui-ci se prévaut de la difficile anaphore qui, chez Bernard Lesfargues, n’est jamais banale.
Il arrive que le poète se divertisse en signalant dans un texte l’identité de certaines rimes finales et aussi certaines ressemblances phoniques dans un même vers mais, dans ce cas, l’on se trouve en présence d’un jeu qui amuse et procure du plaisir, ainsi dans un poème intitulé « Mirabelle » (p. 17-18), qui se présente comme une déclaration d’amour exclusivement drôle,
Ah que je vous aime, mots
comme armilles et charmilles,
vous avez les yeux mi-clos
et résille sont vos cils, (p. 17),
et qui se termine par un usage cocasse de trois rimes en deux vers :
Je vais faire un feu de joie,
mirabelle
ribambelle, répond-elle,
de fruits veloutés de soie,
mirabelle,
je vous aime. (p. 18).
Le maniement des rimes, leur absence ponctuelle et leur retour inattendu dans certains poèmes aboutit à la mise en valeur d’une idée ou d’un pari final. Revenons maintenant au texte intitulé « J’aime », qui a la verticalité de « Chemin du bord de l’eau ». L’anaphore se construit ici sur le verbe à la première personne du singulier, « J’aime », repris quatre fois et suivi de trois vers, cinq vers, trois vers et à nouveau trois vers :
J’aime
J’aime
les portes qui grincent
les planchers qui flanchent
les murs qui s’éboulent
j’aime
tout ce qui s’écroule
sous le poids des ans
les genoux qui saignent
les amours qui geignent
les âmes en peine
j’aime
les fleurs qui se fanent
le jour qui s’éteint
la foi qui s’étiole
j’aime
les amours qui meurent
et ce qui demeure
de tout ce que j’aime. (p. 20).
Chaque vers, sauf les deux derniers, raconte une expérience négative du locuteur : le monde s’effondre, les êtres connaissent le malheur et la nature se défait. Une rime des trois premiers vers coïncide avec une autre des cinq vers suivants, et ces vers eux-mêmes font rimer « saignent » et « geignent » et, dans les trois derniers vers, est placée une rime « meurent/demeure », qui résout le problème ou plutôt la contradiction entre la finitude et la durée. L’anaphore aboutit donc à « j’aime », dernier mot du poème.
Un mot venu d’ailleurs, c’est-à-dire d’un autre poète, peut conduire à l’invention d’un poème. Le texte intitulé « Vert » (p. 27-28), est précédé d’un vers en italique de Federico García Lorca : « Verde que te quiero verde » (p. 27), qui est fort connu et pas seulement des hispanistes (García Lorca 2013, 372-374). Cette couleur verte lorquienne a donc suscité ou accompagné l’écriture d’un poème, mais, après le dernier vers, Bernard Lesfargues note : « J’ai écrit ce poème en pensant à Franz Marc. » (p. 28). Le texte est donc lié à ce peintre animalier bavarois (1880-1916), dont le souvenir de la série des « chevaux bleus », au pelage luisant, s’impose au poète, dans un original télescopage avec le vert lorquien. L’isométrie règne sans exception, le vers choisi étant le pentasyllabe ; il s’agit d’un tableau en mouvement où interviennent des chevaux qui font l’objet de la poétisation, mais sous le signe de la couleur verte qui l’emporte sur toutes les formes visibles et qui les transfigure. Il n’y a ici aucune rime et la brièveté est de mise d’un bout à l’autre du texte. L’espace initial est la mer, mais le soleil et le ciel sont porteurs de signes verts tandis que les protagonistes, les chevaux, ont de « vertes crinières » (p. 27). Il y a là une unification de l’image car les traces de l’espace se projettent dans les yeux des chevaux. Nous ignorons le lieu où se passe la scène et nous ne savons pas non plus pourquoi les oiseaux sont « narquois » (p. 27). Le locuteur avoue lui aussi ne pas savoir pourquoi, lors de cette fête, des « anges » sont venus : Qui sont ces anges ? S’agit-il d’une autre réminiscence de l’univers poétique de Lorca ? Mais ce qui l’emporte, c’est la vision finale, celle des chevaux verts sur la plage, que le poème réinvente.
Die großen blauen Pferde (Les Grands Chevaux bleus), 1911, huile sur toile, Walker Art Center, Minneapolis
Cependant, Bernard Lesfargues sait aussi composer des poèmes résolument « classiques » en se prévalant de tout un système de signes, par l’usage des quatrains et de l’octosyllabe et par le jeu subtil des rimes, ainsi dans « Anguille » (p. 38). Le poète ne procède pas à des démonstrations : il écrit avec élégance tout en conduisant le lecteur vers une victoire de la sonorité. Ainsi, dans le premier quatrain, la rime se place aux vers 2 et 4 (« maison-fenaison »), puis le deuxième quatrain utilise le schéma ABBA : sillonne / froid / crois / m’abandonne et le troisième quatrain impose la même rime aux vers 2, 3 et 4 (Seine / vaine /veines). La lecture de ce texte implique la plus vive attention car, malgré l’extrême rigueur dans l’usage des signes connus, malgré la présence du moi au sein des trois quatrains, le mot unique « anguille », qui tient lieu de titre, génère un énigmatique premier vers où l’anguille est le premier et le dernier mot, sans aucun verbe,
Anguille sous la roche anguille (p. 38),
et qui surtout nous semble un calque ou une copie de l’expression : « il y a anguille sous roche », c’est-à-dire, selon le dictionnaire, il y a une chose cachée qu’on soupçonne. Le vers suivant crée un lien entre l’anguille et le moi, avec la métaphore du cœur mué en « ta maison ». La présence des herbes semble confirmer le rôle de l’anguille, mais, dans la deuxième strophe, le « couteau froid » plongé par le « tu » évoque plutôt un acte strictement humain. Désormais, l’anguille n’est plus présente et, dès le vers 6 jusqu’au vers 12, le lecteur n’entend parler que des cris et des souffrances du moi. Enfin, le troisième quatrain propose un portrait de ce locuteur désespéré qui n’a plus qu’un seul plaisir :
Ne trouvant plus de goût à rien
Qu’à voir couler l’eau de la Seine (p. 38).
Nous sommes ici du côté de l’intériorité : les mots « vie » et « vaine », qui comportent une allitération (v) désignent l’ardeur et l’inutilité, tandis qu’au dernier vers, s’impose la continuité de la vie dans les veines, dernier mot qui rime avec « vaine » :
Comme la vie ardente et vaine
Coule sans cesse dans mes veines. (p. 38).
Le regard du moi capte l’image extérieure de l’eau de la Seine tandis que s’impose l’image strictement intérieure du mouvement contradictoire de la vie dans le sang du locuteur.
Même si tout lecteur s’interroge sur le rôle du mot « anguille » et même si ce texte ne comporte aucun signe de ponctuation, sauf le point final (v. 12), l’on est frappé par la continuité de l’expression et l’enchaînement logique des phrases. Ce poème se veut sentimental, mais rigoureux, disponible pour tout déchiffrement d’une passion accessible, compréhensible, tout cela allant de pair avec l’équilibre strophique, la parfaite isométrie et le jeu des rimes.
Intensité et rigueur de la parole lyrique
Cependant, notre lecture du recueil se place nécessairement sous le signe du mot initial qui figure dans le titre : « Odes », tandis que lui succède l’autre appellation « et autres poèmes ». Apparemment, il y a donc dans ce livre deux sortes de textes, les odes relevant d’une écriture a priori savante, alors que les autres poèmes se réclament de leur simple existence qui implique aussi leur variété. Que sont ces odes ? Combien sont-elles ? Quel lyrisme se met à exister ou non grâce à elles ?
Bernard Lesfargues publie ici six odes : « Ode à la nuit, un » (p. 7), « Ode à mes souliers » (p. 10), « Ode à la tristesse » (p. 21), « Ode à Saint-Sulpice» (p. 23), « Ode nautique » (p. 34), « Ode à la nuit, deux » (p. 42). Le commentaire en prose du poète (p. 46) est indispensable à notre lecture des odes. En effet, Bernard Lesfargues s’explique sur la présence du mot « Ode » dans le titre du livre et il s’en excuse :
Le titre, on me le pardonnera, est un clin d’œil à Claudel et à ses Cinq Grandes Odes, que j’ai lues avec passion mais que, depuis longtemps, j’ai délaissées. Les Odes de Claudel datent de 1910, un siècle ! la veille de la Grande Guerre, bien sûr, mais aussi, voyez le musée d’Orsay, le règne du kitsch. (p. 46).
Certes, il a beaucoup admiré les cinq grandes odes de Claudel, mais il s’agit d’un livre très ancien qu’il a ensuite complètement laissé de côté. La poésie ne peut dès lors exister que grâce à la création d’écritures rigoureusement nouvelles. Cela signifie que l’emploi du mot « ode » n’est en aucun cas une imitation d’un autre discours poétique. Le mot « ode » n’est donc ici qu’une forme pluriséculaire retenue pour l’intensité du lyrisme qui se crée à travers elle. Cependant, Bernard Lesfargues introduit dans ses odes toutes sortes de motifs, à la fois la célébration de la nature, des images de l’eau et du ciel, des rêves et aussi, dans « Ode nautique » (p. 34-35), une mise en garde finale inattendue, à la fois dans des vers brefs et des alexandrins :
Délice que cette eau
délice que cet œil
demi-clos de roseaux (p. 34).
La familiarité n’est aucunement exclue, ainsi dans l’« Ode à Saint-Sulpice », où le locuteur fait de l’église un personnage qu’il tutoie d’un bout à l’autre du texte. La lecture orale met en valeur une sorte de conversation, comme s’il s’agissait de rassembler des signes positifs, de manière extrêmement claire, sans la moindre métaphorisation :
On dit beaucoup de mal de toi,
Saint-Sulpice, (p. 23) ;
Je t’aime plus qu’aucune autre église de Paris (p. 23).
L’« Ode nautique » se prévaut d’une écriture différente, qui porte sur l’eau venue de loin et qui suscite le plaisir. Les premiers vers comportent le nom d’un lieu éloigné :
Tu sais de quelle lointaine Cilicie
par des poissons
sans yeux et sans écailles
nous vient cette eau. (p. 34).
et l’on pourrait même concevoir l’idée d’une ode d’allure mythologique, car il est question à la fois des génies et d’un possible dieu qui interpelle (p. 35). Il est fait allusion à une terre non nommée, « jamais atteinte » (p. 35), dont les flots sont inaudibles, ce qui amène une autre évaluation de l’origine de l’eau,
cette eau nous vient
de la terre des licornes et des névés
Mais ne bois pas. (p. 34),
mais il y a là une impossibilité, car la licorne est un animal fabuleux venu d’orient et mentionné par les Grecs au IVe siècle, tandis que les névés sont simplement des neiges glacées. Cette « Ode nautique » résulte donc à la fois d’un mythe et d’un phénomène naturel sans mystère. Il y a là une célébration de l’eau, vue ici comme pluralité poétique. Le lecteur se souvient qu’un autre poème, qui n’est pas une ode, et qui a pour titre « Cette eau » (p. 30), comporte des images liées à la négativité, ainsi dès les deux premiers vers où l’eau est prisonnière,
Qu’a-t-elle fait, cette eau, qu’a-t-elle fait
que vous l’emprisonniez derrière des barreaux ? (p. 30),
mais la parenthèse qui occupe les cinq vers suivants contient un souvenir d’enfance qui intrigue le lecteur, car une allusion est faite à la provenance de cette eau, à la terre receleuse de « monstres » :
(Je me souviens du bruit que faisait l’eau
en tombant dans le puits.
Claque sourde, venue de loin, venue
des entrailles de la terre
où prolifèrent les monstres.) (p. 30).
Ces images sont proches de celles de l’« Ode nautique », mais le contexte est différent. En effet, à trois reprises, l’on perçoit dans la phrase exclamative l’interdiction de l’adulte qui somme l’interlocuteur enfant de ne pas toucher le seau qui lui permettrait d’atteindre l’eau :
Arrête de jouer avec la seille ! (p. 30).
À la fin du poème, une voix sèche incite l’enfant à ne pas écouter le bruit de l’eau, donc à dormir :
La nuit venue, si l’on entend
grincer la chaîne et couiner la poulie,
enfonce-toi sous l’édredon, et dors. (p. 30).
Il y a ici l’évocation d’une contrainte et d’une injuste privation, donc le regret du silence qui empêche l’accès au vivant.
Abordons maintenant un poème intitulé « Ode à la tristesse », qui est le onzième texte, juste avant les quatorze autres. Le poète utilise ici la prosopopée, personnifiant ainsi la tristesse qu’il tutoie, qu’il interroge douloureusement, qu’il voudrait convaincre et qu’il défie dans les derniers vers en affirmant qu’il ne se soumettra pas. La polymétrie s’impose, avec des vers qui sont parfois de longues phrases, telles que :
Pourquoi as-tu frappé à ma porte, pourquoi t’es-tu glissée par l’entrebâillement ? (p. 21) ;
heureux comme le sont tous ces objets que je touche de mes deux mains, (p. 21-22) ;
Pour déboucher, au seuil de mai, dans cette vallée où s’égosillent les oiseaux (p. 22).
Le langage se déploie et prend de l’ampleur, mais il est d’abord ponctué d’interrogations, le mot « Pourquoi » se répétant deux fois dans le premier vers,
Pourquoi, ce soir, pourquoi rôdes-tu, tristesse, autour de moi ? (p. 21),
puis comme anaphore dans trois autres vers.
Après une simple question, « pourquoi es-tu entrée chez moi, tristesse ? », cette « Ode à la tristesse » fait exister un moi habité par le conflit entre douleur et désir de vivre, un locuteur qui a incarné plusieurs expériences. Cependant, notre lecture du recueil aboutit à « Ode à la nuit, deux » (p. 42-43), le dernier texte que nous ne tenons pas pour une conclusion, car le chiffre « deux » impose le retour à « Ode à la nuit, un ». Or, dans la première ode, il n’y a pas seulement un hymne à la nuit, mais la célébration d’un amour, celui du locuteur pour un « tu », une personne non nommée, mais omniprésente. Le premier vers,
Ton nom m’est un paysage déchirant de solitude, (p. 7),
puis plusieurs autres se réfèrent à un corps, à une présence, tandis que la nuit qui est le sujet d’autres verbes, se juxtapose avec splendeur à cet amour :
J’ai mal au cœur ce soir comme le premier soir
que je t’aimai. La nuit s’est dévêtue. J’attends (p. 7) ;
Je te dirai que tu es belle, et que je t’aime. (p. 7) ;
Rien n’existe ici-bas hormis ce que je vois
reflété dans tes yeux. Est-ce un miracle ? (p. 7) ;
Le vent souffle. La nuit tourne vers moi ses yeux
de biche. Elle sait que je t’aime
et m’écoute psalmodier ton nom. (p. 7-8).
Dans ce poème s’est imposé dès le départ le syntagme « ton nom » :
Ton nom, je le dirai mille fois, sans me lasser. (p. 7) ;
Je t’aime pour ton nom. Épuisé, le vent tire la langue. (p. 8) ;
Doucement, je dis ton nom. Tu sais, le monde existe. (p. 8).
Le locuteur amoureux n’ignore pas l’intensité du trouble qui l’envahit, mais il est ici question de poésie, d’écriture poétique, de transcription de l’amour grâce à des mots. L’« Ode à la nuit, deux » (p. 42-43) évoque certes la beauté de la nature, mais le lecteur remarque également la présence des mots et expressions « vers », « écrire », « je te dirai », « je le dirai », « écrire des vers », « ton nom ». La relecture du recueil permet de repérer dans plusieurs textes le goût intense des mots, leurs dangers aussi, comme dans « Depuis si longtemps » :
Beaucoup de mots sonneront creux,
beaucoup de mots nous deviendront oiseux, (p. 14).
Dans « Du calme » (p. 25-26), il est question d’écriture et, en ce cas, pointe un certain humour :
Les nuages galopent, ma plume aussi,
le ciel s’assombrit, ma page se noircit
et j’entends ma belle-mère qui rage.
Paix des familles !
Un trait de plume, un coup de faux, (p. 26).
Ont déjà été signalés les répétitions du mot « nom » : « ton nom » (p. 8), « d’un nom » (p. 29), « d’un nom » (p. 33), « le nom » (p. 36) », « j’ai dans la tête les plus beaux noms / ce sont les noms de mes amis / » (p. 37). Surgit enfin le mot « poème », par deux fois, dans « Des coqs chantent » (p. 37) :
et je sais beaucoup de poèmes
qui sont faits de ces noms que j’aime. (p. 37) ;
J’écrirai un poème (p. 37).
Si le locuteur évoque les mots, et en particulier les noms, qu’il fait passer à l’écriture, il ne parle jamais du travail effectué sur le langage, ni d’un quelconque art d’écrire de la poésie. Point donc de métapoésie, moins encore de groupe ou de génération car le poème, issu d’une expérience intense du monde et du langage, exige une solitude créatrice. C’est ici que joue un grand rôle le dernier texte du recueil, « Ode à la nuit, deux » (p. 42-43), où se met à exister la célébration lyrique à la fois de l’aimée endormie et de la nuit. Le poème se compose de quatre huitains isométriques où règne l’alexandrin. Ce texte fait surgir de vastes parcours, des expériences contrastées, et dès le premier vers, s’inscrivent la nuit et celle qui est endormie :
La nuit de tous ses yeux te regarde dormir. (p. 42).
Le locuteur, qui s’exprime avec lenteur, se prévaut d’oxymores pour évoquer la nuit négative et contradictoire, et il joue sur la répétition de rimes destinées à enlaidir, à disqualifier ainsi le rapport entre « robe » et « dérobe » :
Voleuse, à pas de loup, voleuse, elle dérobe
pour des jeux puérils, pour des miroirs sans tain,
ce que le jour aussi dérobe à cette robe.
La nuit, douce ennemie, aimée, haïe, s’en vient
avec son rire aveugle et ce masque enfantin (p. 42).
Le vers 8 est comme une réplique ou un rappel du vers 1 :
sur la pointe des pieds s’en vint te voir dormir (p. 42),
c’est-à-dire à une image de la nuit qui regarde et qui voit.
Le deuxième huitain transcrit la démarche douloureuse du moi, essentiellement par la mise en valeur de chaque hémistiche et grâce à un ralentissement de tous les gestes du locuteur :
Mes nuits sont une longue et monotone plaine, (p. 42).
Un moment essentiel se produit alors au cinquième vers de ce deuxième huitain, lorsque l’amant identifie le « tu » à la nuit et affirme sa propre quête de ce même « tu » :
Tu es toute la nuit et je te cherche en toi. (p. 42).
Cependant, cette grande errance par « ces chemins perdus » s’achève au vers 8 par une claire définition du moi par lui-même et la totale identification de son être avec le « tu » :
C’est en toi que je cherche et que je suis, en toi (p. 42).
Alors que le premier huitain ne comporte que deux rimes (tain /enfantin), dans la deuxième strophe tous les vers ont une rime, selon le schéma ABABCDAC (plaine, veines, m’entraînes ; effacé, enlacées, repasser ; toi, toi). Ainsi, « toi » rime avec « toi », mais le but de la démarche étant ainsi défini, le locuteur doit affronter la nuit, d’où son apostrophe au vers 1 de la troisième strophe et l’interpellation lyrique à la nuit :
Ô nuit, interminable nuit, nuit harassante,
déserte de plaisirs, jamais aucun pavot
n’alourdit en ce lit les paupières du rêve. (p. 42).
Dans le quatrième et dernier huitain, un vers exclamatif traduit un désarroi proche de la folie :
Insatiable cœur que frôle la démence ! (p. 43).
Aucune rencontre ne peut avoir lieu avec « Ce visage interdit aux caresses des mains / au moindre souffle fuit. Oses-tu respirer, » (p. 43). Le locuteur abandonné affirme alors voir ce qu’il appelle « une pure apparition » (p. 43), mais le dernier vers (« créer un monde neuf d’impalpable délice », p. 43) est en totale opposition avec ce qui précède car un temps nouveau pourrait exister et susciter un plaisir qui relèverait de l’imagination ou de l’esprit. Les quatre derniers vers sont pourvus de rimes (ABBA), c’est-à-dire : lisse / délice et voir / noir (p. 43), qui sont les signes créateurs de l’ultime espoir du locuteur après l’échec de ce cri adressé à la nuit.
***
Ce livre évoque à la fois la beauté de la nature et les douleurs humaines, tout cela sans idéalisation, avec parfois un humour subtil. À l’abri de toute théorisation, ces poèmes inventent une parole libre pour une écoute disponible. Le livre de Bernard Lesfargues révèle l’extrême exigence du poète, car tous les mots – et chaque mot – ont été choisis, placés ou déplacés sous le contrôle de celui qui a pris la plume. Rien ne manque, rien n’est en trop, et le locuteur sait nommer sans expliquer ni résoudre. Quant au vers, il se déploie ou bien il se limite pour que le déploiement ait lieu et le langage apparaît toujours comme une jouissance, quels qu’en soient le lexique, la syntaxe et les rythmes.