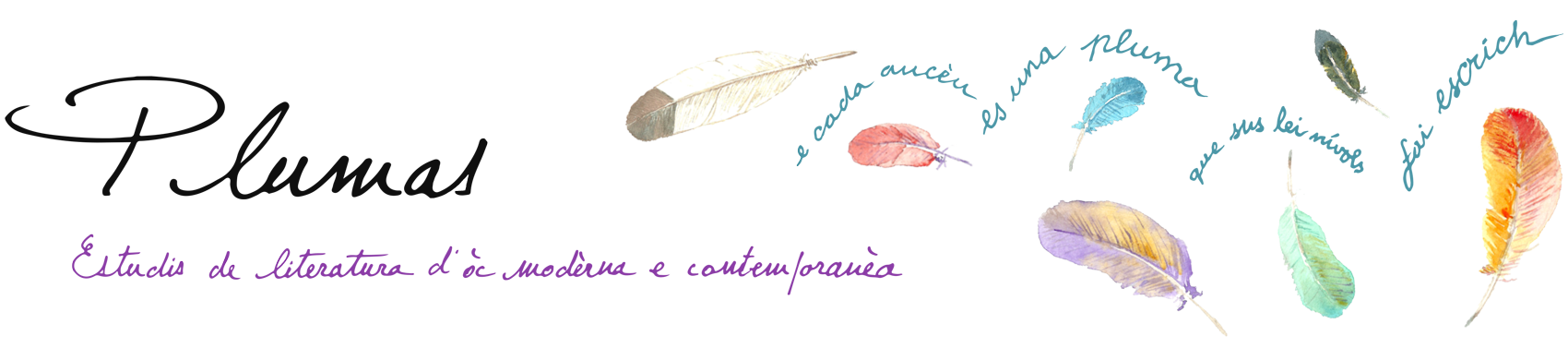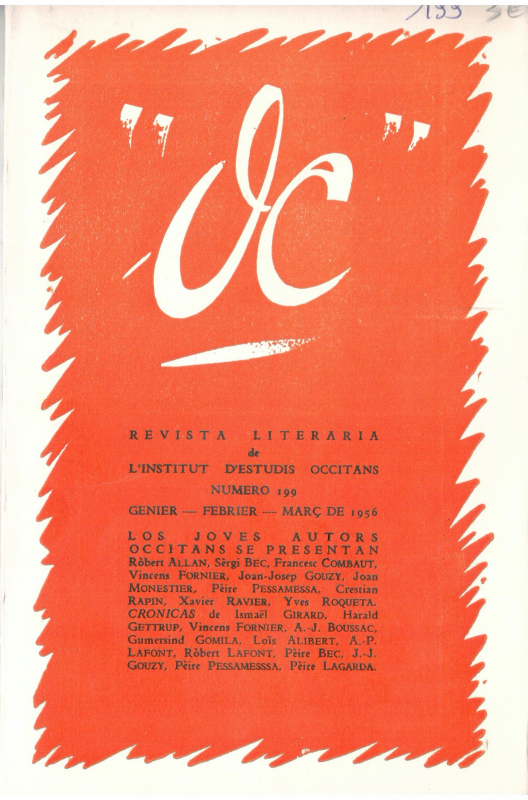1. Du côté des « occitanistes »
C’est dans la revue Oc, pour l’essentiel, mais pas seulement, que l’offensive de la modernité est conduite au lendemain de la Libération. Et c’est assez rapidement Robert Lafont qui prend les commandes de la « nouvelle littérature » d'oc que la revue, après sa reparution, désire promouvoir.
Il n'est pas seul, bien sûr. D'autres noms, de sa génération, mais aussi de la génération précédente (Max Rouquette, Ismaël Girard, René Nelli) se joignent au sien : essentiellement ceux de Félix Castan1, qui en assure pendant une courte période la rédaction, Henri Espieux, Bernard Manciet, Andrée-Paule Lafont. Chacun possède son autonomie de jugement, mais cela n'est pas toujours allé sans heurts, en particulier entre Lafont et Castan, puis dans un second temps entre Lafont et Manciet, au fil des années 1950. Mais c’est bien Robert Lafont qui donne le ton, avec le concours d'Andrée-Paule Lafont. (Cette dernière, tout en partageant les idées et les engagements de son mari, poursuit un travail critique qui ne se confond pas avec le sien). Il oriente la revue dans deux grandes directions : la promotion de nouveaux écrivains, de nouvelles thématiques, et, plus largement, de nouvelles formes d'écriture d'une part. Et, d'autre part, le désir de faire naître une lecture véritablement critique des textes littéraires, du passé comme du présent le plus immédiat. Robert Lafont se révèle ainsi comme un analyste, volontiers érudit et savant (« universitaire », bien qu'il ne le soit pas encore), et comme un observateur-acteur de ces nouvelles écritures, en poésie et en prose (au théâtre aussi), dont Oc et le nouvel Institut d'études occitanes se veulent les inspirateurs et les soutiens2.
Nouveaux auteurs, nouvelles écritures
Cette volonté de faire émerger de nouveaux écrivains susceptibles de promouvoir de nouvelles formes d’écriture en occitan est assez générale. Voici, à côté d’un passage tiré d’un texte programmatique de Robert Lafont (1948), deux autres prises de position significatives, datées de 1947 et 1951, qui vont dans le même sens et définissent une sorte de « ligne de front ». Le premier texte, rédigé en catalan, est publié en 1947 par un membre de l’Institut d’études occitanes et collaborateur d’Oc dans une prestigieuse revue culturelle barcelonaise dont la rédaction a trouvé refuge à Paris, Jean Lesaffre3:
Cal admetre que aquesta seixantena d'anys de Felibrige ha representat una primera etapa en la renaixença, i que el moviment hauria acabat bruscament si aquesta fase no hagués estat seguida d'una renovació ; però molt feliçment la renovació ha vingut : les obres aparegudes d'ençà de fa algun temps en forneixen la prova, i singularment les dues antologies publicades... (p. 258-259)
Els poetes occitans estan demostrant que, tornant a unes fonts diferents d'aquelles en les quals havia poat el Felibrige, peró nacional tanmateix, informen una sang nova a la poesia del migdia de França... (p. 265)4
Robert Lafont, quelques mois plus tard, en occitan, désigne l’une des tâches essentielles à laquelle doivent s’atteler désormais les écrivains d’oc s’ils veulent répondre au désir de renouvellement qu’ils appellent de leurs vœux, en particulier dans le domaine de la prose :
Es penós de veire nostis escrivans ignorar tant coma fan li riquessas de la sintaxi d'Oc, encara viva dins la boca dau poble, quora parla occitàn e mai quora parla francès...
[Suit toute une série d'exemples sur ces ignorances, avec des considérations spécifiques sur la « prose provençale »].
Après la sintaxi, lo vocabulari. […] Nostre vocabulari es trop ric. Fau s'atalar a un apauriment sistematic. Lo gost dau mot ric, l'alegria lexicografica es lo signe d'una literatura trop joina. […] Lo pintoresc deu s'escafar davant la precisión. Tota lenga de civilización es paura de mots e rica de sens »5. (Robert Lafont, « Per una prosa occitana », Oc, octobre 1948, 30-32).
Bernard Jourdan6, critique et romancier en français, poète d’oc aussi à ses heures, propose en 1951 un panorama qui reprend les thèmes déjà exprimés par Jean Lesaffre en insistant sur la rupture qui s’est selon lui produite au cours de la décennie précédente :
Depuis dix ans environ, la poésie de langue d'oc change de visage. Mistral s'éloigne... La jeunesse s'écarte, non pas de lui peut-être, mais d'une ribambelle de pâles disciples tournés vers le passé et qui diluent les fulgurantes images du maître de Maillane.
Les poètes du mouvement occitan se rassemblent moins peut-être pour une graphie nouvelle que pour une conception nouvelle de la poésie. Ils s'abreuvent aux sources toujours vivantes des troubadours, du trobar-dus [= clus] et du catharisme. Ils élargissent leur horizon poétique, saluent Lorca. Ils vont vers l'universalité. Alors que jusqu'ici la poésie félibréenne (dans son ensemble) semble toujours « en marge », la nouvelle poésie d'oc, à travers la guerre et l'Occupation, déborde de jeunesse et d'espoir.
C'est la revanche de Toulouse sur Avignon.7
Suit un court ensemble de poèmes en traduction française de Philadelphe de Gerde, Noune Judlin, Max-Philippe Delavouët, Enric Espieuc [= Espieux], Sully-André Peyre, Max Rouquette, [Jean] Calendal Vianès.
On notera que les poètes retenus par Jourdan, comme par exemple ceux de l’anthologie « du Triton Bleu », appartiennent aux deux principales obédiences graphiques (et esthétiques ?) alors en concurrence plus ou moins polémique. Parmi la toute nouvelle génération, on relève deux « mistraliens », liés à Peyre et à sa revue Marsyas, Max-Philippe Delavouët et Jean-Calendal Vianès, et un autre Provençal, lié lui à l’« occitanisme », Henri Espieux.
Ces trois prises de position vont dans le même sens. Elles entérinent une rupture d’ores et déjà en train de s’accomplir, mais qui reste fragile. Tel est l’objet du texte de Robert Lafont, qui est révélateur d’une attente mais aussi de préoccupations sérieuses. Pour lui, la bataille n’est pas encore remportée, et beaucoup reste à faire.
De ce combat à mener et des résultats qui ont pu être obtenus, les livraisons de la revue Oc, au long des années 1950, ne cessent pas de rendre compte, soit par des sortes de bilans d’étape, soit par le moyen de courtes anthologies, poétiques, dont l’un des objets est de montrer comment l’éventail des thèmes, des styles et des auteurs s’élargit, sans rupture, cependant, avec les écrivains des générations antérieures. Parallèlement, l’écriture en prose est elle aussi interrogée, de façon moins systématique, et davantage à travers des exemples à suivre (ou pas) dont l’émergence est, on le devine, plus malaisée.
On ne retiendra ici que les manifestations les plus remarquables de ce processus. Ainsi, au début de 1956, une large place est faite à un ensemble intitulé Los joves autors occitans se presentan (Oc, 199, janvier-mars 1956, 1-29). Cet ensemble comprenait une présentation en forme de manifeste signée Yves Rouquette, « Aicí siam8 » (1-3) et dont l’affirmation principale est sans aucun doute ce constat : « Nos cal desrevelhar o nos calar tre ara9 » ; des poèmes de Robert Allan, Serge Bec, François (Francesc) Combaut (catalan), Jean-Joseph Gouzy (catalan), Jean Monestier, Christian Rapin, Xavier Ravier, Yves Rouquette ; une prose narrative de Pierre Pessemesse, « Un d'aquestis estius solelhós » ; une prose en forme de manifeste de Xavier Ravier, sans titre : « Joens escriveires d'Oc... ».
En 1960, c’est autour de Robert Lafont de composer une nouvelle anthologie : Poësia d'Oc 196010, (Oc, 216, mai-junh 1962, 1-28). Outre une présentation de R[obert] L[afont], « Poëmas », 1-2, celle-ci contient comprend des textes de 17 poètes (Max Allier, Pierre Bec, Serge Bec, Félix Castan, Jordi Pere Cerdà, Henri Espieux, Gumersind Gomila, Bernard Jourdan, Robert Lafont, Pierre Lagarde, Bernard Manciet, Jean Mouzat, René Nelli, Christian Rapin, Georges Reboul, Yves Rouquette, Jean Rouquette). Parmi eux deux Catalans, l'un d'origine minorquine (Gomila), l'autre roussillonnaise, Cerdà, tous les deux compagnons de route fidèles des écrivains d’Oc et l’IEO.
Dans son avant-propos, Lafont, en cela plus méthodique que ne l’avait été Yves Rouquette en 1956, revenait sur les décennies antérieures et s’interrogeait sur les moments essentiels du chemin parcouru :
Si moments essenciaus foguèron de conquistas, quitament de parturicions. Conquista, devers 1939 d'un dire despolhat d'eloquéncia, d'una qualitat d'èime. Aquela poësia discrèta, escrèta, amb si tèmas ponsians ò roquetians, son agachada nòva sus l'environa naturala, si rèireplans de nauta cultura moderna, la podèm pas dire acabada […] La generacion de la guerra e de la Liberacion porgiguèt d'autri ressòns, d'autri conquistas. Conquista de la vòtz dau sègle, d'una environa mai umana que naturala, e d'una paraula mai espelofida, que d'an en an, entre 1945 e 1955, engrandiguèt lo discors occitan. Messatges contunhava amb de nòus poëtas, amb lis ancians que se cambiavan lo dire : a l'òrdre quichat coma un ponh d'aspra serenitat respondiá lo desòrdre di dolors e dis entosiasmes11. (1-2).
Ces deux anthologies12, au-delà de différences plus superficielles que réelles, sont révélatrices de la sorte de course contre la montre à laquelle tentent de se livrer Oc et, à ses côtés, la collection Messatges, dont le nombre de titres augmente avec régularité13. Refonder, sur des bases renouvelées, une littérature sans pour cela renier les évolutions passées, n’est pas une mince affaire. Le sommaire du fronton de 1960, plus que celui élaboré auparavant par Yves Rouquette, qui obéissait à des exigences en partie autres (la jeunesse), le montre bien : Nelli, Reboul ou Mouzat sont présents, aux côtés de « jeunes » tel que Jean et Yves Rouquette, Christian Rapin ou Serge Bec. Et les « dissidents » n’y sont pas oubliés : on note les noms de Castan et de Manciet, dont la présence, stratégiquement, est jugée opportune, car le premier a été l’un des initiateurs du mouvement qu’il faut poursuivre et amplifier, et le second demeure, depuis ses débuts, l’un de ceux dont les textes sont porteurs d’une grande originalité, dont on ne saurait faire l’économie. On notera que deux années plus tard, en 1962, le nom de Manciet a disparu de l’Anthologie de la poésie occitane, préfacée par Aragon, d’Andrée-Paule Lafont. Pour des raisons qui tiennent aux vicissitudes de la nébuleuse « occitane », entre politique et culture, bien davantage qu’à des motifs proprement littéraires. Mais celui de Castan est bien là. Rassembleuse autant qu’elle le peut, cette anthologie récapitule, en remontant dans le temps (jusqu’à 1900), la trajectoire d’un peu plus d’un demi-siècle, faisant ainsi le lien entre les générations qui se sont succédé et enregistrant en chemin les évolutions les plus visibles.
Revue Oc, numéro 199
Nouvelle critique ?
Inséparable de la volonté de renouvellement littéraire, la promotion d’une critique à la fois attentive et rigoureuse est l’une des intentions majeures des nouveaux rédacteurs d’Oc, affirmée par Castan et poursuivie par ses successeurs. Outre Castan, qui se consacra en particulier à un vaste panorama rétrospectif de l’écriture d’oc aux XIXe et XXe siècles14, les principaux artisans de cette entreprise furent, dans un premier temps, Andrée-Paule Lafont, Robert Lafont et Henri Espieux. Chacun à sa manière, tous trois s’efforcent de jeter sur les œuvres récemment publiées un regard à la fois engagé et distancié, mêlant l’objectivité d’une critique de type universitaire, au sens le plus large, et la partialité d’une vue orientée par un projet forcément partisan. Au début des années 1950, échanges et controverses se succèdent, non sans âpreté, mais de façon féconde, dans la revue.
L’un des moments clés de cette entreprise est probablement le dossier publié dans le numéro 222 d’Oc (octobre-décembre 1961, 1-12), sous le titre général de « Laus de la critica » [à l'intérieur, p. 1, « Convèrsa sus la critica »]. Participent à ce débat, outre Robert Lafont (qui mène la discussion), Henri Espieux, Simone Rouanet, Jean et Yves Rouquette15. Cette première confrontation est suivie, p. 13-28 d'un « Debat sobre l'Escòla d'Avinhon » (p. 13 : « Opinions sus l'Escòla d'Avinhon ») comprenant des textes de Joseph Sébastien Pons, Bernard Jourdan, Robert Lafont, Henri Espieux, à partir essentiellement de deux articles, de Félix Castan et Jean Rouquette, parus dans Oc, 218, octobre-décembre 1960 à l’occasion du centenaire de la Miougrano entre-duberto, respectivement « Per Teodòr Aubanel », 2-20 ; « Lo catolicisme d’Aubanel », 21-31 (ces deux articles étant précédés d’une présentation de Robert Lafont, qui en avait suscité la rédaction). Il s'agit d'une conversation enregistrée au magnétophone le 28 septembre 1961, ainsi que le précise R[obert] L[afont] dans la présentation qu'il signe en tête de sa retranscription. Son thème de départ, selon Lafont, a d’ailleurs quelque chose de quelque peu provocateur : « Benlèu qu'avèm mai besonh ara d'una critica occitana que d'òbras nòvas. O tant. Li doas necessitats s'entremesclan, e fan l'actualitat occitana, en 196116. » (p. 1). Au début de ce débat, son initiateur distingue la critique juste, qu'« amolona li trabalhs paciènts pèr n'arribar a una vesion que voudriá definitiva dis òbras e dis autors. Lo parangon n'es una critica universitària moderna qu'a daverat lo nivèu d'una sciéncia quasi exacta dins quauqui domenis17 » (p. 2). Et une critique injuste, « la di setmanaris parisencs, que cèrca non pas benlèu lo verai dis òbras, mai de dessenhar dialecticament pèr refús e pèr causidas la rega fruchosa de la creacion d'ara, e que pòrta de còps que i a sus lo passat literari de jutjaments tan vius e orientats18. » La discussion porte sur l'intérêt de la critique « universitaire », attaquée, en ce qui concerne les troubadours, par Yves Rouquette, et défendue par Robert Lafont.
Elle aborde aussi la question de l'utilité que peut avoir la critique injuste (qu'Espieux préfère qualifier de « parciala », partiale), quand elle suscite le débat (ainsi celle de Félix Castan à propos à propos d'Aubanel, quand il place son théâtre bien au-dessus de son œuvre poétique).
Autre thème abordé : celui des anthologies. Yves Rouquette est favorable à une « antologia d'umor » une anthologie d’humeur, comme celle d'Éluard pour la poésie française. Robert Lafont plaide de son côté pour une anthologie « scolaire ». Il aborde par ailleurs la question de la critique occitane dans des revues d'expression française telles que les Cahiers du Sud ou Europe :
… aquela collaboracion es pastada d'ambiguitat […] pèr manca d'especialistas, es nosautres que parlam de nosautres […] serà totjorn necessari de pausar, en defòra d'Oc, mai que dins Oc, lo problema major di relacions de la literatura occitana amb la literatura francesa, e d'autri. Fau pas faire grelhar lo mau de la « resèrva »19. (p. 4-5)
Ce tour d’horizon est loin d’épuiser, bien sûr, la question, et les conclusions qui en ressortent ne dispensent pas de faire l’économie d’un examen attentif et détaillé des efforts critiques dont témoigne une lecture des diverses livraisons d’Oc publiées pendant la période considérée. Oc, en première analyse, a pratiqué assez largement, depuis la fin des années 1940 et le début des années 1960, les deux genres de critique distingués par Robert Lafont dans son texte introductif au débat.
Souvent, d’ailleurs, ces deux genres sont intimement mêlés : le souci de rigueur et d’objectivité rencontre plus d’une fois la volonté de distinguer ce qui serait le « bon grain » de l’ivraie, l’originalité du conformisme, un suivisme attardé d’une réelle quête de modernité.
C’est à la même époque une tâche similaire que Robert Lafont poursuivait, en étroit parallèle, dans une prestigieuse (mais non parisienne) publication française, Les Cahiers du Sud, dont il a déjà été question un peu plus haut. De sa collaboration (à la rubrique « Lettres d’Oc » essentiellement) à la revue marseillaise dirigée par Jean Ballard, il tira lui-même une conclusion que l’on peut partager, le temps s’étant écoulé : « Je pense que si l'on avait dit à Jean Ballard il y a quarante ans, il y a trente ans, que sa revue jouerait un rôle essentiel dans l'orientation du mouvement occitan, il aurait souri par incrédulité »20.
Mais Ballard et sa revue, tout en laissant à Lafont une grande liberté de ton et d’appréciation de la production occitane, littéraire ou critique (y compris universitaire), ne paraît pas avoir totalement partagé sa vision de la littérature d’oc la plus contemporaine. Ballard, en effet, s’il n’appréciait guère le Félibrige (provençal), n’était pas totalement en phase avec l’opinion des « occitanistes » concernant le versant « provençaliste » de la littérature d’oc. Si celle-ci ne fut pas absente des Cahiers, elle n’y prit place en tant que telle, dans sa langue le plus souvent et accompagnée d’une version française, qu’à de rares reprises.
Si l’on excepte en effet le numéro spécial de 1943, Le Génie d'Oc et l'homme méditerranéen, les écrivains d'oc publiés dans les Cahiers du Sud ont été peu nombreux (7 textes de 6 auteurs seulement entre 1944 et 1964, dont un seul en prose, de Bernard Manciet). Il s’agit de :
- Jorgi Reboul : Ma terro/ Ma terre ; Espousc/ Jaillissements ; Pèr dous cambarado de travai/ Pour deux camarades de travail), n° 265, avril-mai 1944, p. 242-247.
- Max-Philippe Delavouët : Cantico pèr lou blad/ Cantique pour le blé, n° 312, premier semestre 1952, p. 208-229. (Fronton : « Perspectives sur la pensée médiévale »).
- Max-Philippe Delavouët : Pouèmo pèr Evo (tros) Cant noviau ; Sounge d'Adam/ Poème pour Ève (fragments) Chant nuptial ; Songe d'Adam, n° 318, 1er semestre 1953, p. 238-247. (Fronton : « Fronton pour un jeune poète »).
- Bernard Manciet, Le Cercle (texte traduit de l'occitan par l'auteur21), n° 331, octobre 1955, p. 425-429. (Fronton : « Nouvelles études nervaliennes »).
- Robert Allan : Cantic dau Brau. A la memòria de Federico García Lorca/ Cantique du Taureau. À la mémoire de Federico García Lorca, n°334, avril 1955, p. 435-450. (Fronton : « À la rechercher du roman » ; le poème est suivi d'une note de R[ené] N[elli], qui présente Robert Allan et se conclut ainsi : « … tous nos lecteurs familiarisés avec le provençal littéraire reconnaîtront l'une des plus belles réussites de la poésie occitane moderne et cet accent – si pur – de ʺlégende naturelleʺ que seuls retrouvent avec ingénuité les vrais hommes nouveaux » (p. 450).
- Christian Rapin : Canta de Miqueu Artigas/ Romance de Michel Artigues, n° 371, avril-mai 1963, p. 90-101. (Fronton : « Permanence de Kirkegaard »).
- Serge Bec : L'ombra anciana/ L'ombre ancienne, n° 378-379, juillet-octobre 1964, p. 74-77. (Fronton : « Autour de Mallarmé »).
Ces choix, dont les raisons d’être restent à expliciter22, sont en tout cas révélateurs d’une volonté d’exemplarité alliée, dans la durée, à la recherche d’un certain équilibre.
2. L’autre versant (le repoussoir ?)
Un texte de Félix Castan, proposé à une assemblée générale de l’IEO en 1950 et aussitôt publié dans Oc sous forme d’éditorial laisse bien voir quel pouvait-être le but d’une critique mêlant les deux objectifs dessinés par Robert Lafont une dizaine d’années plus tard :
N’avèm un sadol d’èsser totjorn tardiers d’una piada, d’èsser estats encara romantics amb Mistral, Aubanel e mai Valeri Bernard, d’èsser estats parnassianistas amb Forés e Perbosc, e simbolistas amb d’Arbaud e Peyre. Parli pas de l’engenh de las personas… Quand los occitanistas volgueron reculir l’ensenhament subrerealista, ja l’escola era a cap de rega. Era mestier d’arremosar totes aqueles eiretatges. Mas ara se tracta d’emprentar nostre rodal sus l’estrada23.
Sept années plus tard, le jeune Yves Rouquette, dans une revue littéraire française attentive aux lettres d’oc, fait écho aux propos de Castan :
On en a même profité pour sortir une anthologie de poésies : Pouèto prouvençau de vuei, un livre volumineux, mal illustré, sans surprises. À la place d'André Chamson, j'écrirais des romans en français : ça lui réussirait mieux que le vers provençal. Quant à l'équipe réunie autour de lui et de Sully-André Peyre, elle est toujours égale à elle-même. Avec elle la preuve est faite que la poésie provinciale post-symboliste n'est pas morte et n'entend pas mourir. Cette Provence-là peut reposer en paix. Elle semble vraiment avoir fait son temps. (p. 56)24.
Ce texte, tout aussi virulent que celui de Castan, était suivi d’un compte rendu, également signé Yves Rouquette, de deux ouvrages récemment publiés par l’IEO par deux jeunes écrivains de la même génération : un roman de Pierre Pessemesse, Nhòcas e bachòcas25, et un recueil poétique de son compère provençal Serge Bec, Miegterrana26.
L’anthologie attaquée par Yves Rouquette était celle intitulée Pouèto prouvençau de vuei/ Poètes provençaux d’aujourd’hui27. On pouvait y lire des poèmes de Louis Bayle, Émile Bonnel, Marcel Bonnet, André Chamson, Max Philippe Delavouët, Henriette Dibon, Bruno Durand, Charles Galtier, René Jouveau, Charles Mauron, René Méjean, Pierre Millet, Fernand Moutet, Suli-Andriéu Peyre, Jean-Calendal Vianès. Dans sa présentation, Barthélemy Taladoire souligne la nouveauté de l’ouvrage, qui permet notamment d’accéder à l’œuvre de jeunes poètes auxquels on doit un réel renouvellement de la voix poétique provençale :
… la perfection même de l'œuvre de Mistral a pu décourager bien des initiatives, étouffer même d'authentiques tempéraments d'écrivains, victimes d'une fidélité mal comprise. Mais, encore une fois, était-il nécessaire et souhaitable de suivre Mistral pas à pas ? […] Mais le temps a passé. Nous saluons, depuis quelques années, un effort réel de nos poètes pour s'adapter aux rythmes du moment et pour intégrer l'inspiration provençale dans un ensemble de valeurs spirituelles, comme de formes musicales et plastiques qui, tout ensemble, la continuent, la transcendent et lui donnent un sens nouveau L'heure n'est plus de ce Félibrige étroitement conformiste, tour à tour frénétique, nostalgique ou larmoyant – pour tout dire : pseudo-romantique – qui, comme toute chose en ce monde, a vécu son moment [...] C'est cette volonté de dépassement dans l'inspiration et dans le temps qu'exprime notre anthologie. (p. 8-9).
Dans l’intervalle, les principaux collaborateurs d’Oc, notamment Robert Lafont avaient eux aussi insisté, dans la continuité des proclamations faites avant et après la guerre, sur l’apparition d’une génération désireuse de s’inscrire dans la modernité du moment et de s’enraciner dans son siècle au plus près de l’actualité. Un texte à la fois critique et programmatique de Lafont, en 1954, redisait tout cela :
Parlèm clar, e redde. La poësia occitana es pas la recèrca trastejanta sus la taula de l'arquemista, nimai la linha aguda sota l'escaupre dau daurier, e benlèu pas, çò crese, l'ausida tiblada quora vèn que bresilha una plaga intima. Nòstra poësia – per tant que la vouguem nòstra – es la descuberta ardida dau biais occitan qu'avèm de dire li causas, e mai de çò que devèm dire, nosautri toti. » […]
Nòstra poësia tota es prens. Devèm ajudar, que se deliure lèu […] Lo poëma veniá un mond claus, barrat coma una pòrta de palais desconegut e misteriós coma una legenda. Per paradòxe, quora preniá a son pòble li paraulas mai pesudas e comunas e bèlas, lo poëta ne bastissiá un temple que son pòble i podiá pas pus intrar […] Avèm aprés lo poder di mots. La leiçon serà pas perduda. Mai uèi […] nòstra poësia a talènt d'umanitat. M'es vejaire que dins dos o tres ans, tot serà cambiat28. (Robert Lafont, « Orientacion », Oc, janvier 1954, 1-3).
Mais il y avait pour les deux camps, apparemment, modernité et modernité. Andrée-Paule Lafont insistait sur ce point, dans une anthologie qui ne pouvait apparaître que comme une réplique à celle des Pouèto prouvençau de vuei récemment publiée. Évoquant, en tête de la partie III, intitulée « Terroir nouveau29 », de cette anthologie, la période la plus récente, elle notait :
Une telle transformation ne va pas sans accident. Alors que tout le pays d'oc se retrouvait dans une vie intellectuelle libérée, quelques poètes se groupèrent en Provence derrière Sully-André Peyre sur des positions systématiques de refus, reniant toute fidélité autre que celle qui les attache à Mistral, un Mistral revu et corrigé. Ce séparatisme en est arrivé récemment à des positions extrêmes. Le lecteur qui voudrait prendre connaissance de cette école provençale pourra se reporter à une anthologie récemment parue, Poètes provençaux d'aujourd'hui, où est représentée la totalité de ces irrédentistes, plus André Chamson. Tandis qu'un groupe provençal s'attardait ainsi, l'ensemble de la poésie occitane allait de l'avant […] Une poésie veut vivre et rechercher les conditions de son existence, elle refuse l'étouffement provincial, elle tend à l'universel. Elle ne trahit pas pour autant son occitanité. » (Lafont Andrée-Paule 1962, 158).
C'est d’ailleurs la même Andrée-Paule Lafont qui avait rendu compte (brièvement et très négativement) de l'anthologie provençale dans Oc (n° 206, octobre-décembre 1957, 194-195) à l’occasion d’une rubrique « Los Libres. Poesia », où, assez curieusement, les références de l'ouvrage n’étaient fournies que de façon très allusive dans le cours du texte :
L'inspiracion provençala, – la d'aquesti poëtas – a ges de fòrça creairitz. Trepeja sens lassiera li metèis camins. L’« ardidesa » i es gratuitat parlufiera de poëtas qu'an lo mau de l’originalitat […]
Ges d'alen, ges de poësia viscuda, ges de crit. De ritmes gris, que sián regulars o non, de causas grisas. Cercam la poësia […] La mediocritat generala dau recuèlh a ges d'autra encausa que l'estequiment de l'èime uman. I a ges d'uèlhs pron nòus dins aquela Provènça poëtica pèr veire espelir un païsatge amb la rega d'un tropèu sus lo cèu o lo sòmi d'un arbre solitari30.
Seuls trois noms trouvaient grâce aux yeux d'Andrée-Paule Lafont : ceux de Max-Philippe Delavouët (malgré une critique très acérée de son Cant nouviau) ; de Jean-Calendal Vianès (« lo ton simple e grèu d'una meditacion sus lo lengatge31 » à propos de son poème Dire) et de Sully-André Peyre (« fai de poësia vertadiera quand oblida de s'apensamentir, quand oblida qu'es preciós32 »).Conclusion de la recension : « Aqueli dos son amb Delavouët, li melhors d'aquela còla ; la trespassan, la fan pas seguir33. ». On peut partager une partie des jugements contenus dans ce compte rendu, qui met bien en évidence, par exemple, l'originalité des trois poètes sortis du lot à juste titre, mais range dans un même sac tous les autres, de façon assurément un peu rapide.
Robert Lafont avait au même moment, plus longuement (deux pages et demi d'une typographie serrée), présenté l'anthologie provençale dans les Cahiers du Sud (n° 348, novembre 1957, 477), « … par principe un événement important et instructif ».
J'extrais du premier paragraphe quelques propositions présentées sous forme d'affirmations incontestables :
« Il ne fait pas doute que le sentiment d'appartenir à une école inspire ces quinze poètes » ;
« Provence n'est pas une notion géographique mais une catégorie linguistique ou idéologique » ;
« Telle quelle cette anthologie est polémique ».
Lafont prend de nombreuses précautions avant de poursuivre : étant partie prenante de la matière même réunie dans cette anthologie (dont il est cependant exclu), il sait que ses opinions seront aussitôt considérées avec méfiance. « Pourtant il faut juger ! »
Ce jugement est d'abord d'ordre général : ces poètes ne se réfèrent à aucune des marques habituelles de la modernité (Apollinaire, Rimbaud, le surréalisme, La Jeune Parque). Ils sont en effet sous la coupe de Sully-André Peyre (qui « impose » le « ton général » de tous ces poèmes).
La suite (à partir de la troisième page) est néanmoins plus nuancée.
« Parmi ces quinze poètes – cette totalité d'école – on discernera d'excellentes propositions du sentiment, de justes appréciations du langage. Je n'en disconviens certes pas : on assiste en Provence à une véritable éclosion poétique, qui gagnerait à devenir explosion, et qui mérite mieux que les litanies où elle s'enferme ».
Lafont mentionne ensuite pour illustrer directement son propos Henriette Dibon, Pierre Millet, Jean-Calendal Vianès « surtout ». Il fait enfin un sort particulier à deux poètes : Peyre et Delavouët.
Sur le premier : « … cette œuvre ne manque pas de majesté » ; mais il s'est enfermé depuis longtemps dans un processus de répétition dans lequel se sont également enfermés « ses disciples ».
Sur le second : « … il a été, on le sait, la révélation de la poésie provençale, il y a quelques années […] Il est le poète des éléments, capable de bâtir une cosmogonie ». Mais a-t-il vraiment su se « libérer totalement » ? (Comme Léon Cordes, à qui Robert Lafont le compare explicitement). « Nous devons exiger beaucoup plus de lui ».
En conclusion, Lafont s'interroge sur « la position polémique » et « l'esprit d'école », dont il se demande s'ils ne sont pas toujours « un leurre ». En outre, plutôt que de se référer seulement au Poème du Rhône de Mistral, ne faudrait-il pas aller voir du côté du « Mistral grand, ensoleillé », celui de Mireille et de Calendal ?
La fin de cette chronique est consacrée au roman de Pierre Pessemesse, Nhòcas e bachòcas, dont la tonalité, comme celle d'autres écritures absentes de cette anthologie, aurait, selon Robert Lafont, montré la richesse et la complexité réelles de la poésie provençale prise dans son ensemble : elle apparaîtrait ainsi « beaucoup plus nourrie de notre siècle ».
Lafont sait très bien qu'il sera (peut-être) lu dans les Cahiers du Sud par un public différent de celui d'Oc. Cet horizon de réception l’incite sans doute à une certaine retenue, toute en nuances. Mais on peut aussi estimer qu'il lui permet, paradoxalement, d'être davantage lui-même, en s'aventurant sur des chemins plus escarpés, mais plus riches de découvertes : la contrainte signifiée par la revue marseillaise est un aiguillon critique qui préserve au moins partiellement des facilités d'une vision trop partisane et trop étroite. Son appréciation sur cette anthologie n'est pas, au fond, très différente de celle exprimée par Andrée-Paule Lafont, mais en disant les mêmes choses autrement, elle va plus loin, et préserve l'avenir. Celle portée par Yves Rouquette à la même époque dans la revue Entretiens empruntait clairement d'autres voies : celles d'une critique univoque, qui ne cherchait pas à approfondir le jugement émis, mais à le rendre incontestable une bonne fois pour toutes. Question de style ? Sans doute. De génération ? Sans doute aussi. Mais sans doute encore question d'appréciation plus globale : on voit poindre ici deux tempéraments qui, on le sait, n'ont pas cessé de s'opposer par la suite, à ce sujet comme sur d'autres.
Il n’est pas sans intérêt, avant de revenir plus globalement sur les tenants et les aboutissants de la polémique entre « occitanistes » et « provençalistes » pendant la période envisagée, d’examiner rapidement, en guise de transition, comment la plupart des animateurs du camp occitaniste ont pu réagir, en 1961, à la disparition de celui qui avait largement symbolisé pour eux le « retard » provençaliste : l’animateur de la revue Marsyas, Sully-André Peyre.
Commençons par celui dont on vient de voir qu’il pouvait être considéré comme le plus virulent d’entre eux, Yves Rouquette. Dans Oc, il écrivait :
… mesada après mesada una revista, Marsyas, aviá espelit que li deviá tot, 382 numeròs que caldrà comptar amb eles per faire lo bilanç de nòstra poësia […] Vendrà un temps que se tracharà pauc de las istòrias de grafia e de las polemicas d'istòria literària34.
Robert Lafont adoptera une attitude comparable, dans les Cahiers du Sud d'abord, puis, à tête reposée, et de façon plus développée mais similaire, dans Letras d'Oc35, la publication qui succéda à Oc en 1964-1965 après la crise qui venait de secouer l'Institut d'études occitanes et avait eu pour conséquence, parmi d'autres, l'arrêt de la revue, dont le titre appartenait à Ismaël Girard, démissionnaire de l'IEO :
Il n'est pas piquant, il est naturel que dans cette revue Robert Lafont rende à la mémoire de Sully-André Peyre l'hommage qu'elle mérite. Jean Ballard l'a compris, qui m'a demandé d'ouvrir par le nom de ce grand disparu de 1962 une nouvelle chronique et de reprendre pour cela la plume que nous avons cédée à Jean Larzac36.
Peyre était en réalité décédé le 13 décembre 1961, d’où probablement l'erreur d'année commise par Lafont dans son article. Mais il n’avait pas hésité, bien au contraire, à reprendre la plume qu'il avait entretemps transmise à Jean Larzac. Certes il s’agissait de répondre à la demande du directeur de la revue marseillaise, Jean Ballard, mais on comprend très vite que cette sollicitation avait rejoint le désir, chez Lafont, de ne surtout pas passer sous silence le rôle important joué par Peyre depuis de nombreuses années au service de la littérature d’oc.
Dans ces deux textes, Lafont ne renie rien du passé polémique des « occitanistes » contre Peyre et les siens. Il utilise à son égard et à l'égard de ce qu'il continue d'appeler son « école », des formules qui résument bien celles qui avaient cours dès la fin des années 1940 et n'avaient pas cessé d'être employées, en particulier dans Oc, pendant les années suivantes.
En français:
L'attitude de chef d'école qu'il avait adoptée l'obligeait à surestimer publiquement ceux qui le suivaient, et à ne jamais écrire une ligne sur les poèmes occitans qui paraissaient, que pourtant il lisait avec soin et annotait pour lui. (Cahiers du Sud, 202).
En occitan:
Mai que mai se pòt plaçar devèrs 1945 una nòva provincializacion de la poësia provençala, que son espandi tot es dins lo volum Pouèto Prouvençau de Vuei. Peyre n'es responsable, d'abòrd que regnava d'aqueu tèmps pèr una mestresa formala que se n'impausava l'imitacion a sis entorns37. (Letras d’Oc, 11).
Outre cette idée centrale dans sa critique de Peyre et des siens, Lafont insistait au fil de ses deux articles sur les aspects excentrés et hors du temps et de l'Histoire du fondateur de Marsyas. Mais il s'intéressait aussi, assez paradoxalement, à sa poésie et à son œuvre critique (en particulier à propos de Mistral), dont il s'attachait à dégager les intérêts profonds, en contradiction au moins apparente, de surface, avec les condamnations dont toutes ces remarques sont accompagnées : « Caudrà desenant, pènse, traspassar li questions formalas, coma traspassam ara una polemica agotada, e reconèisser aquela granda poësia morala38. » (p. 14).
Autre prise de position, plus tardive, allant dans le même sens, celle de Jean Larzac, qui, en particulier dans un article des Cahiers du Sud de 1966 (partiellement repris dans la revue Viure), comme dans d'autres siennes chroniques « Lettres d'Oc » de la revue marseillaise, accordait une place non négligeable aux « provençalistes » et tout particulièrement à Max-Philippe Delavouët (Larzac 19622; Larzac 1966).
L'impression dominante, quand on essaie de parcourir les divers développements de cette « polémique épuisée », est celle d'une assez grande confusion. Le littéraire s'y trouve étroitement mêlé (confondu ?) avec les questions de langue et de graphie, qui n'ont pas cessé d'être posées de façon têtue pendant la période concernée (et par la suite...). Il se télescope aussi avec les attitudes et les prises de positions politiques et idéologiques. Si les questions de langue et de graphie peuvent être décrites avec une certaine précision, et les oppositions à leur sujet cernées avec une relative objectivité, les idéologies et les appartenances ou préférences politiques rentrent très difficilement dans des cases : bien malin qui pourrait établir un rapport, sans autre méthodologie que le sentiment personnel et l'attribution un peu au hasard d'étiquettes standardisées, entre des choix littéraires et esthétiques et de prétendus engagements ou désengagements politiques.
Il semble que la prééminence des querelles graphiques et linguistiques et leur exacerbation, ajoutées aux différences d'appréciation, parfois plus apparentes que réelles, au sujet de l'œuvre et de la personnalité de Mistral, aient largement contribué à rendre opaque de part et d'autre, avec une certaine dose de mauvaise foi de la part de beaucoup, la diversité d'un paysage littéraire dont on s'efforça, mais pas systématiquement, d'accentuer les caractéristiques et d'envenimer les différences pour en faire autant de motifs d'affrontement.
Lafont, cependant, pointa très bien à propos de Peyre (Yves Rouquette fit de même dans son article publié dans Oc lors de sa disparition) le fait que les deux « camps » n'ignoraient pas (totalement) ce que l'autre pouvait produire en fait de littérature et singulièrement de poésie. Mais que tous s'efforçaient, et ils y réussissaient, de n'en rien montrer.
La promotion d'une « nouvelle littérature d'oc », en lien avec la fondation de l'IEO à la Libération et avec la volonté de populariser la graphie Perbosc revue et progressivement corrigée par Alibert sinon auprès d'un large public, à tout le moins chez ces nouveaux écrivains, se trouvait de la sorte renforcée de l'extérieur, par la présence, sur l'autre rive du Rhône, d'un « ennemi » commun, adepte d'un autre système graphique et ne partageant pas les mêmes idées sur l'histoire de la langue et son devenir, un adversaire par rapport auquel il devenait urgent et facile de se (re)définir pour mieux exister. Quitte bien entendu à en simplifier la nature, parfois jusqu'à la caricature. L'existence de Peyre et de sa revue Marsyas, pourtant déjà bien ancienne, comme, à un degré moindre, celle de FE, animée essentiellement par Marius Jouveau puis par son fils René, deux félibres (ce que Peyre n'était pas), donnait un visage quasi unique à cet adversaire et permettait, par contraste, de consolider et de nourrir un projet littéraire concurrent, plus occidental géographiquement parlant, et auquel il fallait donner une consistance plus affirmée et plus visible. (Sur le contexte voir Martel 2010).
Je me suis intéressé à plusieurs reprises au côté « provençaliste » de cette histoire. Je n'y reviendrai donc pas et je tournerai le regard pour l'essentiel sur la façon dont cette « nouvelle écriture occitane » s'est construite pendant une quinzaine d'années après la Libération. Je dirai cependant, en guise de préalable, que, comme l'a écrit un jour Max-Philippe Delavouët (Gardy 2014), l'existence des « poètes de Marsyas », si elle n'a rien eu d'une fiction, n'a sans aucun doute pas eu grand-chose à voir avec une « école », tant les écrivains qui participèrent à l'aventure initiée ou en tout cas soutenue par Peyre à la même époque étaient divers et parfois opposés (dans le meilleur sens du terme), et que seul un « mistralisme », plus ou moins diffus d'ailleurs, les réunissait. Parler, comme le fait Philippe Martel à la fin de son étude, par ailleurs riche et nuancée, de « l'école de Peyre » (Martel 2010, 308) paraît donc un peu excessif.
Comme semblent tout aussi artificielles les étiquettes, certes revendiquées à plusieurs reprises, qui ont voulu faire croire à l'existence d'une « nouvelle poésie occitane » présentant des caractéristiques communes. Le seul examen des ensembles poétiques publiés par la revue Oc, comme des anthologies et tout particulièrement de celle d'Andrée-Paule Lafont, ou encore celui des titres de la collection de poésie « Messatges » de l'IEO, tout cela montre à l'évidence une diversité dont seules quelques composantes répondent, plus ou moins strictement, aux préconisations présentes, parfois de façon quasi rhétorique ou obsessionnelles, dans les discours critiques du moment. D'ailleurs, chaque fois que ces discours deviennent plus circonstanciés, on y trouve très bien cernée une diversité dont on peut penser, sans forcer le trait, qu'elle fait écho et plus d'une fois correspond à des oppositions souvent tranchées, où les choix politiques, au sens étroit ou plus large du terme, les partis pris esthétiques et les influences reçues se heurtent et s'opposent.
Claire Torreilles a montré, dans une étude sur les « premières anthologies occitanes et l'ouverture d'un champ littéraire » (Torreilles 2010), comment une réelle différenciation s'est instaurée à tout le moins pour la poésie avec la publication, en octobre 1941, de l'anthologie La jeune poésie occitane à l'enseigne du Triton bleu, par les soins de Robert Lafont et Bernard Lesfargues. De la division par région, adoptée peu de temps auparavant par René Nelli dans l’anthologie de la revue toulousaine Pyrénées, on passait à une appréhension thématique en trois moments, dont l'orientation principale était la jeunesse des auteurs rassemblés et les efforts de renouvellement que l'on pouvait y constater.
Or dans cette anthologie tournée résolument vers l’avenir et dont nombre de participants évoquaient sans ambages les malheurs du temps et les espoirs qui malgré tout les habitaient, les futurs « pouèto prouvençau de vuei » figurent en bonne place : on y lit des textes de Max-Philippe Delavouët (deux chansons, dans la deuxième partie, « Odeur du temps... »), de Jean-Calendal Vianès (« Amour », dans la première partie, « Couleur des heures... ») ou de Charles Galtier (trois poèmes dans la deuxième partie). Georges Reboul, mistralien mâtiné depuis longtemps d'occitanisme, est également présent dans la deuxième partie, avec deux poèmes, l'un en « provençal rhodanien » et l'autre en « provençal marseillais », tirés de son recueil Terraire nòu, publié par les éditions Marsyas de Peyre. Auparavant, il faut noter que Reboul avait fait usage dans ses publications non seulement de la graphie « occitane », mais encore de formes que l'on peut qualifier de languedociennes : tel est le cas de deux poèmes publiés dans Oc en 1927 (n° 78, « A Forés » et 1928 (n° 95, « Lo ciprès ») ; et d’un recueil daté de 1930, Escapolon. 7 trobas en Oc amb un estampel de Carles Camproux (edicien de l'Amistanso dei joueine, Marsiho, 1930, recueil multigraphié)39.
La dissociation se produisit peu de temps après (Gardy 20114), autour des questions de graphie pour l'essentiel. Elle semble n'avoir eu à l'origine aucune motivation littéraire précise. C'est seulement a posteriori, et très vite, que tout un système d’évaluations, de dépréciations et d’ignorances (feintes ou réelles) réciproques s'est mis en place et a aussitôt pris une importance considérable, venant occulter ce qu'on peut appeler la réalité des faits littéraires au profit de procès d'intention et de reconstructions plus ou moins fallacieuses de part et d'autre. Dès l'anthologie du Triton bleu, si l'on peut dire, le ver était dans le fruit : une note, sous la préface très perspicace de l'hispaniste Pierre Darmangeat, l'un des introducteurs de Lorca en France, présentait la graphie « mistralienne » de « quelques-uns des textes » proposés comme un fait quasi résiduel (destiné à rapidement disparaître ?). À partir de ce moment-là, il fallait impérativement bâtir cette altérité revendiquée au-delà des « simples » dissensions graphiques et linguistiques en lui donnant un contenu, proclamé ou réel, immédiatement perceptible. Bien entendu, cela ne fut possible qu'en tenant compte d'une diversité d'écriture repérable chez des poètes plus anciens, tels que René Nelli ou Max Rouquette, dont l'œuvre était en cours d'élaboration et avait d'ores et déjà trouvé son ton et ses thèmes de prédilection. Il devint donc nécessaire, tout en se réclamant de ces conquêtes d'avant la période de la guerre qui connaissaient des prolongements féconds, de promouvoir autre chose. En gros, une poésie plus actuelle, plus engagée aussi, et plus avide de références contemporaines. Celles d'une certaine modernité, qui correspondait à la culture des plus jeunes écrivains, sans qu'elle fût obligatoirement d'ailleurs celle dont s'inspirèrent alors nécessairement les poèmes qu'ils pouvaient écrire.
Premières de couverture de Anthologie de la poésie occitane et de Poueto prouvençau de vuei
|
|
Les éditeurs français réunis 1962 / Groupamen d'estudi prouvençau 1957
3. Modernité, modernisme et avant-garde
Que le mot soit prononcé ou non, c'est la notion de modernité qui est ici en cause. Robert Lafont le met implicitement en avant dans les Cahiers du Sud dans sa présentation des Pouèto prouvençau de vuei, quand il invoque à leur propos une « querelle du modernisme » dans laquelle, étrangement, il refuse d'entrer alors même qu'il vient de prononcer le mot. Pour lui, les écrivains rassemblés autour de la revue Oc se sont résolument placés de ce côté-ci de la littérature et visent à constituer, par rapport à ceux auxquels ils ont choisi de s'opposer, une avant-garde. Le mot n'est pas davantage prononcé, semble-t-il, mais la notion apparaît en transparence des discours critiques de Lafont ou de ses compagnons occitanistes. Un tel mécanisme n'a rien d'exceptionnel : on sait qu'au XIXe et au XXe siècle en particulier, c'est ainsi que toutes les avant-gardes se sont affichées et proclamées comme telles (Joyeux-Prunel 2015). Et que c'est au terme de tels processus qu'elles ont été (ou non ?) reconnues comme telles, au détriment de tout ce qu'elles cherchaient ainsi à renvoyer dans les ténèbres de l'oubli ou, en tout cas, d'un certain archaïsme. Ce que Pascale Casanova a très bien explicité quand elle écrit, dans un chapitre consacré à « Leopardi et le français » :
La seule manière d'être « moderne » dans le monde des livres, c'est de mettre en cause le moderne existant ou la dernière révolution esthétique et de les détrôner par une œuvre ou une langue décrétée plus présente que le dernier « modernisé ». (Casanova 2015, 112).
La revue Oc et la collection « Messatges » ont été mises au service de cette entreprise, tandis qu'une autre collection, « Pròsa », était créée dans la foulée pour venir renforcer l'ensemble.
Du côté « provençal », c'est une autre modernité qui cherchait à s'imposer immédiatement avant et après la guerre. Peyre, on le voit très nettement dans sa correspondance avec Max Rouquette (donc entre 1938 et 1945, date de leur « rupture »), s'opposa violemment au Félibrige à un certain moment, et ses arguments étaient pour l'essentiel des arguments littéraires. Il cherchait à se dégager de modèles qu'il jugeait dépassés et stériles et prônait l'exploration de territoires esthétiques nouveaux, avec l'espoir d'être rejoint par d'autres écrivains plus jeunes que lui capables de l'épauler dans cette entreprise. Il y eut ainsi, d'abord, Georges Reboul, puis, progressivement et dans le désordre, Max-Philippe Delavouët, Jean Calendal Vianès, Charles Galtier et quelques autres. Max Rouquette représenta furtivement pour lui une authentique bouffée d'oxygène. En l'accueillant à bras ouverts dans Marsyas, il souhaita faire de lui un exemple ; mais les oppositions graphiques et linguistiques eurent vite raison de cette tentative d'élargissement. Elles prirent le pas sur les enjeux littéraires et finirent très vite par en détourner le sens : la volonté moderniste de Peyre, battue en brèche par les jeunes « occitans » peu à peu réunis autour de Rouquette et de Nelli, ne put subsister qu'au prix d'un repliement et d'un isolement. Peyre chercha et trouva des alliés en Provence, ceux-là même (le Félibrige par exemple) qu’il avait voulu fuir, et se retourna contre ceux sur lesquels il avait fait reposer un court temps ses espérances de renouvellement. Simultanément, le nouvel occitanisme commença de se construire et de se renforcer contre l'ennemi campant sur ses terres d'outre-Rhône, tout en cherchant périodiquement à renouer avec lui sans grand espoir de réussite. Il ne fut plus alors question, pendant un long temps, que de transfuges, de traitres, de doubles jeux, de prises de guerre et d'échanges de prisonniers...
J’aimerais terminer par quelques considérations que l’on jugera peut-être rassurantes cette évocation d’une bataille par définition sans résolution rationnellement envisageable. De plus en plus inextricablement liées, questions graphiques et sociolinguistiques d’un côté, rivalités littéraires d’un autre, ont déteint les unes sur les autres au point de rendre impossible sur le moment une analyse un tant soit peu rationnelle de la situation ainsi créée. Car la volonté de devenir une avant-garde, ou de le rester, demeure toujours la plus forte, surtout quand une telle bataille se déroule, comme c’est bien évidemment le cas, dans un contexte culturel défavorable. La communication en langue d’oc n’a cessé de se réduire comme peau de chagrin, malgré, comme on dit, quelques « beaux restes », et le sentiment de dépossession qui s’en est suivi n’a fait qu’accentuer un phénomène lié à cette constatation de quasi-faillite : l’apparition, par compensation, de luttes internes au processus déjà bien enclenché40. La volonté d’acquérir une suprématie littéraire est de celles-ci, dans un monde, celui du milieu du XXe siècle, où, en France peut-être plus encore qu’ailleurs en Europe, la littérature, comme institution, joue un rôle important. Deux stratégies, dans un pareil contexte, ont été pour l’essentiel mises en œuvre. D’un côté, il s’est agi d’invalider systématiquement ou presque toutes les productions de l’autre camp. Dans la revue Oc, comme dans les anthologies, tout ce qui provenait de la rive gauche du Rhône dans la « mauvaise » graphie (la mistralienne en l’occurrence) était dévalorisé. Les critiques les plus aiguisés n’hésitaient pas, par principe, à minoriser les œuvres mistraliennes en raison des retards de tous ordres (genres, style, influences, etc.) qui les auraient caractérisées, sans exceptions notables. De Mistral aux écrivains les plus récents, une telle propension à refuser toute forme de modernité était mise en avant. L’une des manifestations extrêmes de ce procès consista, par exemple, à opposer Mistral à Aubanel, le second étant considéré comme une victime du premier, alors même qu’il aurait en son temps incarné une authentique modernité que Mistral se serait acharné à combattre. Cette thèse, appuyée sur les réelles oppositions qui ont existé entre ces deux personnalités du premier Félibrige provençal, fut défendue par Félix Castan dans un article de la revue Oc mentionné plus haut, à une époque où l’on entreprenait de transcrire dans la graphie de l’IEO, avec l’approbation de ses descendants, les œuvres du poète avignonnais41.
Dans l’autre « camp », c’est pour l’essentiel le silence, ou, ce qui revient au même, l’effacement, qui prévalut : les écrivains et les œuvres autres que strictement provençales, n’étaient plus mentionnées, ni en bien ni en mal ; et les écrivains provençaux qui avaient « trahi » graphiquement furent l’objet d’un traitement semblable. Un cas d’école à cet égard est représenté par le Marseillais Georges (Jòrgi) Reboul, un poète largement publié, en revue et en recueil, par Sully-André Peyre, sous le signe de Marsyas. Il est absent de l’anthologie des Pouèto prouvençau de vuei, tout comme un autre provençal, Robert Allan, dont les Cahiers du Sud avaient néanmoins mis en relief en 1955 le Cantic dau Brau. A la memòria de Federico García Lorca.