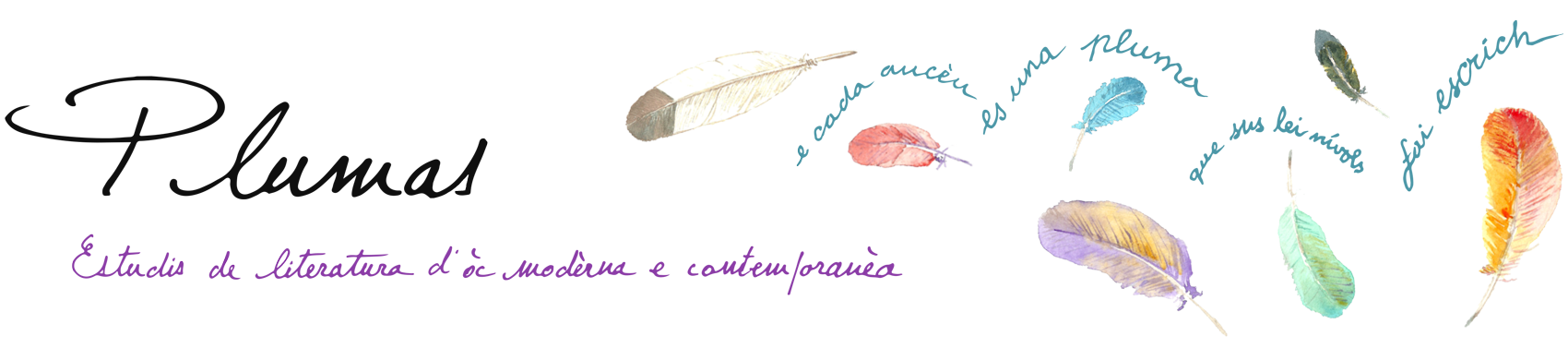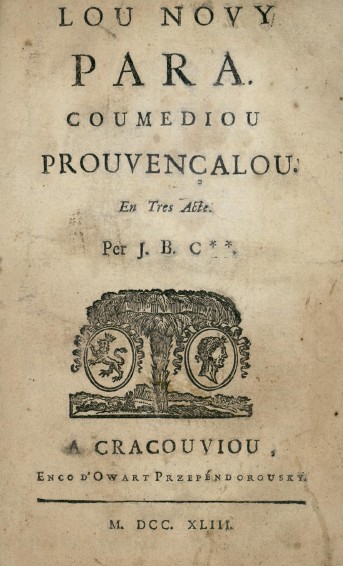Sur la vie de Jean-Baptiste Coye, on ne dispose que de quelques repères. Il est né le 6 juin 1701 à Mouriès, village situé au pied des Alpilles, en Provence, à une trentaine de kilomètres de la ville d’Arles1. Il est issu d’une famille de ménagers, paysans aisés comme on en trouve en Provence. Selon l’indication qu’il nous donne lui-même, lorsqu’il a douze ans, en novembre 1723, ses parents viennent s’établir à Arles2. Toujours d’après ce qu’il nous en dit, Coye n’aurait pas fait d’études très poussées puisqu’il affirme ne pas connaître les langues anciennes3. Selon toute apparence, la famille vit de ses propriétés de Mouriès. C’est là que vers la fin de sa vie, Coye se retire et qu’il meurt, en 1771, qualifié dans l’acte de décès de « bourgeois »4.
À en juger par les épîtres en provençal qu’il adresse à des personnalités locales, Coye est inséré dans les cercles lettrés d’Arles. La pièce Lou Novy para que nous allons examiner ici est précédée d’une « Epitrou a Moussu de Moran » en qui il faut reconnaître Pierre de Morand (1701-1759), né à Arles mais établi à Paris à partir de 1731, auteur de tragédies, comédies et ballets5. Avant d’être imprimée en 17436, la pièce de Coye semble avoir été communiquée à un cercle restreint de lecteurs sans que l’on sache pour autant si elle fut représentée. L’auteur affirme en tout cas dans sa préface qu’il s’agit là de sa première œuvre littéraire :
Tout ce que nous avons en cette Ville d’illustre & de sçavant, a honnoré mon Essai de son suffrage : avantage bien rare pour un Ecrivain, qui étant parvenu à l’âge de 30. ans sans avoir fait un Vers, à eu la temeraire Emulation de débuter par un Ouvrage, qui en contient plus de 1600. (Lou Novy para, 1743, n. p.)
Il convient donc de situer vers 1741 l’entrée en littérature de Coye, un début qui se fait dans le double cadre de l’écriture en provençal et de l’écriture dramatique. Par la suite, Coye ne va cependant pas persister dans le genre théâtral, Lou Novy para est la seule pièce que l’on connaisse de lui. Sa production comprend un grand nombre de textes poétiques dont un seul sera imprimé de son vivant, Lou Delire (1749), poème héroï-comique qui narre une descente aux Enfers à l’occasion d’une forte fièvre7. Le reste de son œuvre poétique sera publié au XIXe siècle, une première fois à Arles en 1829, dans une édition procurée par l’avocat arlésien Jean-Antoine Estrangin, une seconde fois, toujours à Arles, en 1854, par son collègue Frédéric Billot (1805-1868), ces deux éditions contenant à chaque fois le texte du Novy para. Les nombreux manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques, sans doute des copies8, témoignent de la diffusion des œuvres de Coye dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle.
Les historiens de la littérature provençale et de la littérature d’oc ne sont guère tendres envers la pièce de Coye. Pour Auguste Brun, le Novy para, de Coye, est « franchement ridicule avec ses alexandrins en coupe française et son style noble où le provençal semble un déguisement » (Brun 1927, 45). Robert Lafont et Christian Anatole jugent la pièce « bien fade et molle à [leur] goût » (Lafont/Anatole 1971, 445). Fausta Garavini, qui analyse assez longuement la pièce de Coye, considère qu’elle s’appuie sur un « argomento banale […] e, quel che è peggio, trattato con insopportabile pesantezza » [argument banal […], et, ce qui est pire, traité avec une lourdeur insupportable] (Garavini 1971, 84). Plus récemment, Philippe Gardy estime, lui aussi, que la pièce est globalement « assez banale […] Et la mise en scène, pour les rares critiques qui l’ont lue, ne semble pas devoir racheter cela » (Gardy 2015, 178). Notre objectif est ici de poser un regard le plus objectif possible sur une œuvre qui semble avoir été aussi appréciée en son temps9 que peu considérée par la suite.
Page de titre de l’édition de 1743 (Gallica, BNF)
Une pièce conventionnelle
Le volume qui paraît en 1743 se compose de plusieurs parties :
-
une préface en français (6 pages)
-
l’« Epitrou a Moussu de Moran » (iii-viii)
-
un « Proulogou dóu Novy Para » (1-6)
-
la pièce proprement dite, Lou Novy para. Coumediou Prouvençalou (7-60)
-
un « Vaudevillou Canta per quatre Mathalo & un Actour de la Péçou » (61-62) qui précède un ballet dansé par ces mêmes acteurs
Dans le prologue, écrit en vers irréguliers, l’Amour et l’Hyménée (L’Hymeneou) font état de leur désaccord devant un Mercure chargé par Jupiter de les concilier. L’Amour condamne les mariages imposés par l’intérêt que promet l’Hyménée :
Tanto vou qu’un tendroun, ou beou de sa jouinesso
Espouse un degoustan Vieillar,
Et qu’infidelle à sa proumessou
Laisse son Aman à l’escar,
Per ye temougna de Caressou
Mounté lou Cor n’a ges de par.
Tanto qu’un jouvençeu à la flour de son age,
Prene per interés une vieillou Sartan,
Qu’apportou per tout avantage,
L’Argén & lei tré de Satan.
D’aqui s’ensui, lou grand desordre
Lou Mary devén impuissan (2)
[Tantôt il [l’Hyménée] veut qu’un tendron, dans la beauté de sa jeunesse
Épouse un dégoûtant vieillard,
Et qu’infidèle à sa promesse,
Elle délaisse son amant,
Pour lui témoigner des caresses
Où le cœur n’a aucune part.
Tantôt, il veut qu’un jouvenceau à la fleur de son âge,
Prenne par intérêt une vieille mégère,
Qui apporte pour tout avantage
L’argent et les traits de Satan.
De là s’ensuit le grand désordre,
Le mari devient impuissant.]
tandis que l’Hyménée se lamente sur une jeunesse qui recherche en priorité les plaisirs sensuels :
La jouinessou aujourdhuy per l’ou vice esblouide,
Vou plus vieoure qu’en liberta,
Et de fau prejugea sa cervellou ramplidou,
N’amou qu’emé coumoudita.
L’ou vice es trioumphan, & la vertu timidou
Gemi din la calamita.
Vesen plus gés d’amou intrepidou,
Lei cor soun plen d’iniquita.
La debaucho, en un mot, su leis huméin presidou
Tout respirou l’oubcenita.
L’impudénçou per tout vén d’unou man hardidou
Arboura l’Estandar de la lubricita. (4)
[La jeunesse aujourd’hui éblouie par le vice,
Ne veut plus vivre qu’en liberté,
Et de faux préjugés sa cervelle remplie,
Elle n’aime que par commodité.
Le vice est triomphant et la vertu timide
Gémit dans la calamité.
Nous ne voyons plus d’amour intrépide,
Les cœurs sont pleins d’inéquité.
La débauche, en un mot, préside sur les humains,
Tout respire l’obscénité.
L’impudence partout vient d’une main hardie
Dresser l’étendard de la lubricité.]
La pièce, entièrement rédigée en alexandrins, sauf le vaudeville final, se compose de trois actes. La situation de départ est simple : la jeune Nourado aime Tourvillou alors qu’elle doit sous peu épouser Casteouroux qui a les faveurs de son père, Griffou.
Le cadre de l’action est situé à Arles, « dins la salou bassou de l’Houstau de M. Griffou ». Il ne s’agit donc pas d’une pièce alocalisée ou dont l’action se déroule à Paris comme il est fréquent dans le théâtre de langue française. L’auteur prend soin de placer les personnages dans un milieu, certes conventionnel, mais dans une ville pour laquelle il manifeste, dans l’épître à Morand, son vif attachement. Pour autant, cette localisation ne débouche pas sur une accumulation de références au cadre local. Le Rhône qui joue un rôle dans l’action puisque les amoureux fugitifs y essuient une tempête10 n’est jamais nommé. Tout au plus trouve-t-on la mention d’un micro-toponyme (Saint-Martin, III, 8) et des arènes d’Arles (III, 10). L’accent n’est pas mis sur l’environnement local à travers les lieux de la ville ou de ses environs, ni non plus par des mentions de la réalité quotidienne arlésienne et sur ce point, la pièce ne se distingue donc qu’à peine de ses équivalents de langue française.
Les personnages, au nombre de huit, portent des noms qui relèvent de l’anthroponymie provençale : l’amoureuse Nouradou, diminutif d’Ounourado, son père Griffou, son oncle Pistachou, le mari promis Casteouroux, la servante Alphounsinou, tous cependant, sauf Nourado, étant relativement transparents en français. M. Dodu tire son nom de l’adjectif français dodu, l’amoureux Tourvillou évoque le maréchal de Tourville (Anne Hilarion de Costentin de Tourville, 1642-1701) et le nom de la servante Nerinou provient de Molière (Monsieur de Pourceaugnac, Les Fourberies de Scapin). De toute évidence, l’auteur ne recherche pas une différenciation maximale par rapport au français. Il joue au contraire sur la proximité entre les deux langues.
Examinons l’intrigue. Elle peut se résumer de la façon suivante11 :
Acte I. (1) Nouradou confie à la servante Nerinou son aversion pour le mari que son père lui destine. Nerinou lui vante les charmes de Casteouroux mais se déclare prête à aider sa maîtresse. (2) Face à Casteouroux, Nouradou paraît résignée à obéir à son père. (3) Nérinou offre son aide à Casteouroux. (4) Casteouroux manifeste son intérêt pour la dot de Nouradou. (5) Casteouroux se montre très amoureux en présence de Griffou qui se fait fort de vaincre les résistances de sa fille. (6) Pistachou prend le parti de Nourado devant Griffou. (7) Griffou campe sur sa position. (8) Nerinou apprend à Griffou que Nouradou est amoureuse de Tourvillou. (9) Nerinou se félicite d’avoir choisi le camp du père et du mari promis.
Acte II. (1) Griffou se lamente sur l’ingratitude de sa fille. (2) Nouradou déclare à son père qu’elle préfère le couvent à un mariage qui lui répugne mais Griffou la menace de sa haine. (3) Nourado s’apitoie sur son sort. (4) Elle se désole que Tourvillou l’ait quittée pour une autre et Alphounsinou cherche à la rassurer. (5) Tourvillou paraît, il est toujours amoureux de Nourado qui peine à se laisser convaincre, finit par céder et accepte de fuir avec lui. (6) Alphounsinou écarte les scrupules de Nourado. (7) Nouradou leur annonce que le mariage est prévu pour le lendemain. (8) En présence de son père et de Casteouroux, Nourado fait mine d’accepter l’union.
Acte III. (1) Alphounsinou s’apprête à apprendre à Griffou une terrible nouvelle. (2) Elle lui dévoile que Nouradou et Tourvillou ont fui sur les conseils de Nerinou. (3) Griffou laisse éclater sa colère. (4) Il envisage avec son ami et voisin M. Dodu les actions juridiques à mener contre le séducteur Tourvillou. (5) Nerinou fait état auprès de Griffou de rumeurs selon lesquelles les amoureux ont fui en bateau. (6) Casteouroux exprime sa colère à Griffou qui chasse Nerinou. (7) Casteouroux réclame à Griffou l’argent qu’il lui a avancé pour le mariage. (8) Pistachou revient et relate comment le navire qui emportait les amoureux a été pris dans une tempête sur le Rhône et a fait naufrage. Griffou est toujours en colère contre elle mais Pistachou demande qu’il lui pardonne. (9) Dodu tient le même discours, Griffou commence à fléchir. (10) Griffou s’en prend à Alphounsinou, Dodu intercède en sa faveur. (11) Pistachou amène les deux amoureux qui implorent le pardon de Griffou. Il l’accorde et accepte leur mariage.
On peut compléter ce résumé par un tableau indiquant la présence des personnages sur scène :
|
|
Acte I |
Acte II |
Acte III |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Griffou |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Nourado |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Alphounsinou |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
Tourvillou |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Nerinou |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Pistachou |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
X |
|
Casteouroux |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
Dodu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
Griffou occupe une place considérable dans la pièce. Présent dans 17 scènes sur 28, il constitue, par le choix qu’il a fait du futur mari de sa fille et son refus de prendre en considération l’inclination de celle-ci, l’obstacle principal à l’union des deux amoureux. Jusqu’aux toutes dernières scènes, son obstination est constante. Elle confine à l’insensibilité lorsqu’il apprend que Nourado a échappé au naufrage. Ne manifestant aucune pitié ni aucun soulagement, il apparaît comme autocentré, obsédé par sa propre situation et la désobéissance à son autorité :
O Naturou ! ô ma Fillou ! ô Pérou infourtuna !
A de mau sensou fin, Ciel ! sieou ti coundana !
Pode ti perdouna sa fautou irreparablou !
Deve ti l’immoula !
[…]
Unou Fillou pôu ti justifia sa fuitou ? (III, 8, 52-53)
[Ô Nature ! ô ma fille ! ô père infortuné !
À un mal sans fin, Ciel ! suis-je condamné ?
Puis-je pardonner sa faute irréparable ?
Dois-je l’immoler ?
[…]
Une fille peut-elle justifier sa fuite ?]
À l’inverse, le couple d’amoureux n’est que peu présent sur scène. Si Nouradou déclare son amour pour Tourvillou dès la première scène, ce n’est qu’au milieu de la pièce (II, 5) qu’on le voit paraître. Auparavant, Nouradou le croit disparu, parti avec une rivale, motif qui n’est pas développé tant l’amoureuse se fie aux déclarations enflammées de son soupirant. Cette scène d’amour, l’une des deux plus longues de la pièce, fait office de pivot dans l’intrigue puisque c’est à ce moment que se décide la fuite des amants. L’initiative vient de Tourvillou :
Et qu’an nostei parén usoun de Tiranniou,
Lou parti de fugo n’a gés d’Innouminiou. (II, 5, 33)
[Et quand nos parents usent de tyrannie,
Le parti de la fugue n’a rien d’ignominieux.]
Ses longues déclarations amoureuses font écho à celles de Nourado. Celle-ci est mue par le seul sentiment amoureux. Sa jalousie ne dure qu’un instant, vaincue par les protestations de l’amant, et si elle offre plus de résistance à la perspective de la fuite, les arguments de Tourvillou et d’Alphounsinou finissent par la faire céder. Au départ, Nourado est en effet écartelée entre son devoir filial et son amour pour Tourvillou :
Se suive moun deve, quint exces de miserou !
Se suive moun Amour, quin chagrin per moun Pérou ! (II, 5, 34)
[Si je suis mon devoir, quel excès de misère !
Si je suis mon amour, quel chagrin pour mon père !]
Alphounsinou fait valoir les droits de la Nature supérieurs aux obligations de la vertu :
Un excés de vertu n’es jamai que blamable,
Quan choquou la Naturo, & nous rénd miserable. (II, 5, 34)
[Un excès de vertu n’est jamais que blâmable
Quand il choque la Nature et nous rend misérables.]
tandis que Tourvillou brandit la menace de la mort que lui causerait un refus de sa part. La motivation de Nouradou, lorsqu’elle accepte le principe de la fuite, n’est pas la recherche des plaisirs sensuels ; elle obéit au seul sentiment amoureux.
Les deux servantes jouent un rôle opposé. Au début de la pièce, le spectateur peut penser que l’adjuvante de Nourado sera cette Nerinou qui lui promet son aide. Très rapidement, il comprend que cette servante joue un double jeu. Intéressée par les présents matériels qu’elle reçoit du mari pressenti et de Griffou, elle cherche à attirer Nourado dans les rets de Casteouroux. Ce n’est qu’au milieu de la pièce (II, 4), juste avant la rencontre des amants, qu’apparaît la servante réellement fidèle, Alphounsinou. Successivement, elle prépare le retour de Tourvillou (II, 4), prête main forte à celui-ci dans sa proposition de fuite (II, 5 et II, 6), essuie la colère de Griffou (III, 2 et surtout III, 10) et, en chargeant faussement Nerinou (III, 2), elle met en place les conditions qui vont mener Griffou à chasser la traîtresse (III, 6).
La résolution de l’intrigue ne peut cependant pas être mise entièrement sur le compte de cette servante à la fois bienveillante, fidèle et un peu rouée. Du point de vue de l’action, Alphounsinou se contente de conforter la décision de sa maîtresse et de faire tampon avec le père furieux. La résolution intervient en fait au terme d’un enchaînement de circonstances qui mène de la fuite au naufrage et du naufrage au retour des amants infortunés et au pardon final. Dans cette succession d’événements, le rôle de l’oncle Pistachou est déterminant. Dès sa première apparition (I, 6), il cherche à rendre son frère attentif au changement d’humeur de Nourado qu’il interprète comme le signe d’une absence d’amour pour le mari pressenti. Lorsqu’intervient le naufrage, c’est lui qui rapporte à Griffou les circonstances de l’événement (III, 8) et son action bienfaisante à l’égard de la jeune rescapée (il la retrouve, la fait porter chez lui, sa femme s’occupe d’elle). Son comportement est empreint de compassion, les contraintes morales lui paraissent secondaires (« En de tém mens fachoux ranvoye ma Mouralo »). L’invitation au pardon qu’il adresse à son frère est placée sous le signe de la Nature :
L’homme es jamai plus gran que quan sau perdouna :
Tro d’oubstinacioun pôu deveni fatalou,
La Naturou, & sei plour vous diran tout lou resto. (III, 8, 53)
[L’homme n’est jamais plus grand que quand il sait pardonner ;
Trop d’obstination peut devenir fatale,
La Nature et ses pleurs vous diront tout le reste.]
Ses qualités humaines sont relevées par lui-même12 et son talent d’orateur mis en valeur par Dodu auprès de Griffou (III, 9). La générosité complète le tableau de ses vertus : sans enfants, il a institué Nouradou comme héritière et au moment où le mariage est décidé, il lui accorde mille écus (III, 11).
La question de l’argent, essentielle dans les affaires de mariage, oppose ainsi un Casteouroux intéressé par la dot (I, 4) et soucieux de récupérer son prêt à Griffou une fois que les choses tournent mal (III, 7) à un Tourvillou peu soucieux de l’apport paternel (III, 11), le tout dominé par la figure d’un oncle qui, par l’effet conjugué de son éloquence et de sa générosité financière, vainc l’opposition du père jusque-là intraitable. De façon caracteristique, c’est Pistachou qui prononce les ultimes paroles de réconciliation :
Anen, que vostei Cor, delivra dei suplice,
D’un amour conjugal ressentoun lei delice. (III, 11, 60)
[Allons, que votre cœur, délivré des supplices,
D’un amour conjugal ressente les délices.]
Comme annoncé dans le prologue, la pièce a démontré que le mariage amoureux était possible. Le sentiment amoureux l’a emporté sur le mariage imposé.
Une pièce cohérente
Telle qu’elle se présente, la pièce possède une remarquable unité de ton grâce à l’usage constant de l’alexandrin et surtout d’un registre langagier élevé. Seules deux inflexions viennent légèrement altérer cette ligne mélodique parfaitement uniforme. La première tient à la dimension comique assurée par la servante Alphounsinou dont le registre de langue n’est pas tout à fait à la hauteur des autres personnages. Dotée d’un esprit terre-à-terre, Alphounsinou introduit un décalage comique lorsqu’elle prend à la lettre les paroles de sa maîtresse :
Yeou vous tuya ? fau proun quan tuye qu’auquou Niérou (II, 4)
[Moi, vous tuer ? C’est bien assez quand je tue quelque puce]
Sa langue accueille des mots sans équivalents en français (carcaigna, II, 4, 26), des expressions imagées (« un bon co dei Bouffe », id. ; « un Pérou que dor emé leis yeux duber », III, 2, 41) ou des comparaisons empruntées au monde animal (« imita dounc la Lébre », II, 5, 34). Le comique, chez elle, n’est pas lié à la situation, sauf lorsque, imitant la voix de sa maîtresse, elle s’exprime à sa place (II, 4), c’est un comique fondé sur une distorsion dans les registres.
Le contraste est particulièrement marqué lorsqu’il est question de sexualité. Alphounsinou confesse à Nourado (II, 2) qu’elle est amoureuse d’un certain Boûthezard dont le père refuse l’union avec la servante et l’a envoyé sur un vaisseau. Ce qui pourrait constituer une intrigue secondaire n’est pas développé, le personnage de Boûthezard ne fait pas partie de la distribution de la pièce et il n’en est guère question que lorsqu’Alphounsinou l’évoque à titre de comparaison avec la situation de sa maîtresse. Ainsi, lorsqu’il s’agit de conforter Nouradou dans sa décision de prendre la fuite, elle représente en termes à peine voilés un amant intéressé par les plaisirs sensuels :
Dins unou de sei man tén mei pougne sarra,
Et soun autre agissén d’unou façoun hardidou
Toumbou fourtuitamen mounté l’hazard la guidou. (II, 6, 37)
[Dans une de ses mains, il tient mes poings13 serrés,
Et de l’autre, agissant de façon hardie,
Tombe fortuitement là où le hasard la guide.]
Cette évocation permet à Nouradou de faire montre de sa vertu en refusant d’en entendre davantage. L’opposition entre plaisirs des sens et sentiment amoureux est ainsi affirmée, au bénéfice du second. La dimension comique, présente à travers les contrastes de registres, reste subordonnée à une intrigue générale particulièrement cohérente.
La seconde inflexion observable dans la pièce concerne la satire du monde judiciaire présente dans l’échange entre Griffou et son ami et voisin Dodu (III, 4). Dans cette scène, la plus longue de la pièce, Griffou, qui est en réalité procureur, et Dodu discourent des moyens juridiques dont pourrait faire usage le père offensé. C’est l’occasion pour Dodu d’accumuler les noms de juristes et historiens célèbres14 en offrant l’image d’un pédant ridicule. D’un point de vue dramaturgique, on pourrait s’interroger sur l’utilité de cette scène qui semble nuire à la cohérence de l’ensemble mais on peut aussi remarquer qu’elle fait office de moment dilatoire tout en ancrant le texte dans la tradition théâtrale de la satire15. Les références aux juristes en vogue ou encore aux dispositions judiciaires récentes (une ordonnance de Blois, un autre de Marly, datée de 1730) signalent une connexion avec la réalité contemporaine.
La pièce se veut en effet ouverte sur le monde contemporain. À la faveur d’une comparaison, on y trouve une mention du microscope (I, 1, 9) et il est fait état de villes situées en dehors de la Provence, en France (Lyon, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Paris, Nîmes, Toulouse) et en Europe (Venise, Hambourg, Londres, Amsterdam). L’horizon s’élargit encore plus dans le vaudeville final où il est question du Japon et de la Jamaïque.
Quelques références à la culture de langue française émaillent le texte comme l’allusion au prédicateur Bourdaloue (III, 8) ou le personnage moliéresque de Scapin auquel est comparée Alphounsinou (I, 8). Cette ouverture, même modeste, à la science ou aux connaissances (juridiques en l’occurrence) contemporaines comme au monde européen et extra-européen ou encore la présence explicite de la culture française assurent à la pièce une place à part dans un corpus théâtral de langue occitane généralement centré sur une réalité plus strictement locale.
Une pièce française en provençal ?
Lou Novy para est une pièce profondément pénétrée de culture française. La présence d’un prologue et d’un vaudeville final avec chant et danse rappelle moins le Théâtre de Béziers du siècle précédent que le Théâtre de la Foire contemporain où les prologues ne sont pas rares et les fins avec vaudevilles quasi systématiques. Le débat entre Amour et Hyménée est présent dans la littérature française depuis le XVIIe siècle. On le trouve au théâtre et à l’opéra comme dans L’Amour et l’Hymen, opéra des fils Lully, représenté en 1688 à Paris16, ou en poésie, comme dans le poème, attribué à Chapelle, « Le divorce de l’Amour et de l’Hyménée17 », la satire du mariage étant commune dans la littérature libertine.
Le motif de la fuite des amants n’a rien de rare dans la comédie française, pas plus que celui de la tempête qu’essuient les amants. Il est courant dans le Théâtre de la Foire, particulièrement depuis le succès de la traduction de Robinson Crusoe par Thémiseul de Sainte-Hyacinthe (1720), avec Arlequin roi des Ogres de Fuzelier, Orneval et Lesage (1720), Arlequin-Deucalion de Piron (1722). On trouve des récits de tempête dans de nombreuses pièces comme dans Électre (1708) ou Rhadamiste (1711) de Crébillon père ou dans des parodies de la Foire reprenant la scène de tempête dans Alcyone (1706) de Marin Marais.
De la même façon, le personnage de l’oncle bienveillant qui participe plus ou moins activement au dénouement rappelle Molière. On pense à Béralde, le frère d’Argan, dans Le Malade imaginaire qui tient un discours sur la médecine opposé à la foi béate de son frère, à Cléante qui incarne sagesse et modération auprès d’Orgon, ou encore Ariste dans Les Femmes savantes, combattant l’aveuglement de son frère et soutenant le couple d’amoureux.
Pour composer sa pièce, Coye s’alimente de la production française de son temps et du siècle précédent, plus certainement qu’il ne transpose en provençal une pièce française préexistante, même si on ne peut exclure cette dernière hypothèse. En fait, plus probablement, l’Arlésien, en connaisseur du théâtre français, reprend à son compte les éléments constitutifs de pièces du répertoire français (l’intrigue amoureuse, l’obstacle paternel, la fuite, le retour, la résolution rapide). En choisissant l’alexandrin, il se situe dans une tradition d’écriture prestigieuse, illustrée par Molière, Rotrou, Regnard et tant d’autres. Lorsqu’il place l’intrigue à Arles et qu’il remplace la tempête en mer par un épisode semblable situé sur le Rhône, Coye ne produit pas un quelconque effet de couleur locale. Il se contente de déplacer dans sa région de Provence une action qui, dans le modèle français, est alocalisée ou parisienne (voire exotique). En maintenant, mais en les limitant au maximum, les différences de registre, il rejoint également une certaine tradition française et surtout, il tourne délibérément le dos aux pratiques antérieures du théâtre provençal qui, comme chez Zerbin un siècle plus tôt, jouait précisément de ce type de décalages dans le cadre d’un théâtre carnavalesque18.
La langue employée par Coye participe également à la proximité avec la production française. Le jugement de Mistral qui parlait, à propos de la langue dans Lou Novy para, d’« aquéou jargoun bastard entrelarda de barbarige emé de francihot » [de ce jargon bâtard entrelarde de barbarismes et de français] (Mistral 1858, 93), est sévère mais compréhensible. L’érudit avignonnais Pierre Pansier s’est amusé à juxtaposer le texte provençal et sa traduction en français pour montrer à quel point le provençal de la pièce est proche du français :
Victimou de l’amour coumou dou mariage,
Me foudra dounc dou sort senti touto la rago,
Et n’espera pus rèn de moun pérou irrita
Que leis tristeis effès de sa severita !
Victime de l’amour comme du mariage
Me faudra-t-il du sort sentir toute la rage
Et n’espérer plus rien de mon père irrité
Que les tristes effets de sa sévérité ! (Pansier 1932, 51)
Cette proximité entre un occitan très francisé et le français est située par les contemporains dans le cadre urbain (Courouau 2015, 14) par opposition avec un espace rural censément plus hermétique aux influences du français. On peut également penser que le francisme est un marqueur de distanciation sociale propre aux milieux urbains et élitaires en général. Le linguiste Patrick Sauzet (2014) a ainsi démontré que Jean-Baptiste Fabre recourait pour la langue du narrateur de l’Histoira de Jean l’an pres à des formes francisées (souer, par exemple) tandis que la langue du paysan conservait la forme idiomatique (vèspre, en l’occurrence). L’occitan francisé, urbain et élitaire, représente au XVIIIe siècle le registre élevé de l’occitan (Courouau 2023). Il n'est cependant pas facile de déterminer si la langue de Coye reflète très exactement ce qu’on pourrait qualifier d’acrolecte provençal arlésien ou s’il force le trait en provençalisant systématiquement des formes françaises. Le fait est là, en tout cas : tant les modèles esthétiques que linguistiques sont orientés dans cette pièce vers la langue et la littérature françaises.
Une ambition pour le provençal
Cette perméabilité à la langue et à la littérature françaises chez Coye s’explique par le projet linguistique et esthétique qui l’anime. Celui-ci est exprimé dans la préface en français du Novy Para et dans l’« Epitrou a Moussu de Moran ».
Coye présente d’abord sa pièce comme une nouveauté absolue, il ne se reconnaît aucun devancier provençal et tient à se distinguer, sans les nommer, de toutes les autres entreprises dramatiques provençales imprimées jusque-là (Brueys 1628, 1665, 1666 ; Zerbin 1650) :
Le NOVY PARA est une piéce si nouvelle dans son Genre, qu’on pourroit peut-être la dire unique. Les Comédies en Vers, qui ont parû jusqu’ici en Provençal, sont si éloignées de la Poësie & du Théâtre, qu’elles ne méritent pas le nom de Poëmes Dramatiques.
L’originalité de sa démarche se fonde sur le rapport entre le français et le provençal. Coye enregistre, d’une part la dévalorisation sociolinguistique dont est victime le provençal auprès des élites :
Le François est si fort en vogue aujourd’hui, que les beaux esprits dont la Provence fourmille croiroient avilir leur plume s’ils écrivoient dans leur langage naturel.
Son propre choix linguistique est justifié par réaction à cet abandon et par fidélité à l’héritage des troubadours. De façon caractéristique, les noms de troubadours que mobilise Coye sont tous ceux de souverains ou d’aristocrates (Frédéric Ier, Richard Cœur de Lion, Raimond Bérenger de Provence, la comtesse de Die, Guillaume IX…). Les troubadours reçoivent leur légitimité de leur influence sur les cours européennes et sur la reconnaissance de leurs mérites par Dante, Pétrarque, Le Tasse, côté italien, et Étienne Pasquier, côté français.
Sur ces deux points, la dévalorisation sociale du provençal et la revendication de l’héritage médiéval, Coye a beau dire mais il s’inspire d’un argumentaire très présent en Provence et singulièrement de celui développé par le poète François-Toussaint Gros dans l’avis « Au Public » qui ouvre son volume de Pouesiés prouvensalos paru en 1734. L’idée, différemment exprimée, est la même pour l’un comme l’autre thème :
Alte-là ! (mi dira un Critique)
Tu n’es qu’un sot, qu’un animal
De t’escrimer en Provençal. (Gros 1734, 9)
[..]
Lou Prouvençau si parlavo autreis fes,
Eis Cours d’Anglaterro & de Franço (Gros 1734, 10)
[Le provençal se parlait autrefois
Dans les cours d’Angleterre et de France]
Là où, cependant, Gros prend soin de valoriser le provençal en ignorant le français, Coye déploie tout une argumentation destinée à justifier son choix tant linguistique qu’esthétique en mettant les deux langues en rapport. Pour lui et malgré qu’il en ait, le provençal occupe clairement une position subordonnée au français :
Il est vrai que le François plus grave, plus noble, & plus élegant rend la Versification plus majestueuse, plus élevée, & plus harmonieuse : & que le Provençal plus rude, & moins usité presente bien d’ostacles à un Autheur.
Parmi ces obstacles, il cite dans un premier temps les difficultés causées par la rime et le hiatus, puis plus loin, la diversité dialectale, inconvénient qu’il résout en utilisant le parler d’Arles. Plus profondément, cependant, on sent bien que tout un ensemble de représentations sociolinguistiques associent le français au raffinement, à l’élégance, à une langue fixée, à une pratique experte de la littérature tandis que le provençal, qualifié à une seule reprise de « patois », reste cantonné à un état « souvage » [sauvage] de la langue19 :
Il faut convenir que nôtre Patois a une Energie, un naturel dans ses expressions, & un tour si heureux qu’il charmeroit, si quelqu’un les sçavoit trouver.
La mission que s’est fixée Coye est précisément de dompter ce parler « sauvage » et le moyen adopté pour cela réside dans la convergence avec les modèles linguistiques et esthétiques élaborés et véhiculés par la langue et la littérature françaises. Cette proximité avec le français est à la fois niée et assumée :
Il semble d’abord que ce Poëme est dans le stile François, & qu’il n’y auroit presque rien à changer dans les Vers, pour en faire la Traduction ; cependant il est constant que lors qu’on l’examinera de prés, l’on y trouvera bien des endroits, qui embarrasseroient un Traducteur qui voudroit les rendre fidélement.
Coye tient à afficher une distance entre la langue de son œuvre et le français, tout en revendiquant la congruence avec le modèle. Son éloge du parler d’Arles se fonde précisément sur la proximité avec le français :
Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que l’on dit Arles en France. La terminaison & la prononciation briéve de nos mots forment un accent, qui approche si fort du goût François, que pour s’en éloigner il nous faudroit renoncer au langage.
De la même façon, alors que Coye ne mentionne aucun autre nom d’auteur provençal puisqu’il se considère sans prédécesseur, il est révélateur que son épître en provençal contienne ceux de Molière et de Voltaire et qu’il y fasse référence aux pièces françaises de Morand.
Dans la recherche d’un style, Coye choisit donc la voie française. Il s’agit d’un choix pleinement assumé, effectué par démarcation face à des tendances opposées. Entre deux registres extrêmes, celui des pièces françaises de haute volée et celui des comédies provençales de type carnavalesque, l’auteur affirme privilégier une voie médiane :
Il est difficile en Provençal de n’être ni Empoulé, ni Rampant : pour peu qu’on se néglige, l’on tombe dans le bas ; & lors qu’on s’éleve trop l’on devient guindé. Mais il est un heureux milieu qu’il n’est pas impossible de trouver, lorsqu’on s’attache bien au choix des mots, & qu’on a une façon de penser juste & naturelle.
En réalité, Coye choisit la voie française mais pas n’importe laquelle. Il privilégie clairement, par sa langue et ses modèles esthétiques, des modalités qu’il juge supérieures. On peut ainsi élargir au choix poétique la conclusion que Philippe Gardy émet à propos de la langue francisée de la pièce, « comme si Coye dans son souci d’égaler le provençal au français classique, n’avait pu faire mieux que de procéder à une imitation très stricte de son modèle prestigieux » (Gardy 1984, 985).
*
Fruit d’une ambition littéraire, culturelle et linguistique élevée, la pièce de Jean-Baptiste Coye demande, pour être appréciée plus justement que ce ne fut le cas jusqu’à présent, à être rapportée à l’intention de l’auteur et aux modèles qu’il se fixe pour parvenir à son objectif. D’un point de vue dramatique, si on la rapproche de la production française contemporaine, elle est loin de faire pâle figure. À l’exception peut-être de la longue scène satirique qui nous paraît plaquée, l’intrigue est correctement menée, conformes aux pratiques dramaturgiques françaises du temps. C’est précisément cette recherche d’une proximité avec les modèles français, menée jusque dans la langue, qui a obscurci les jugements formulés depuis un siècle et demi sur cette pièce. Elle n’est pas originale si on la rapporte à la production française dont elle ne se distingue finalement que par le choix de la langue d’écriture et il peut paraître, certes, tentant de voir dans le conformisme d’une pièce en forme, somme toute, d’exercice de style, une marque de soumission au cadre diglossique qui s’impose en France aux langues et cultures régionales. Ce serait oublier deux choses. D’une part, les modèles théâtraux français s’imposent au XVIIIe siècle partout en Europe20. D’autre part et surtout, une des voies que les auteurs écrivant dans une langue minorée empruntent fréquemment est précisément celle qui consiste à se rapprocher le plus possible des modèles esthétiques de la culture dominante dans le but d’exhausser au niveau de celle-ci la culture dominée. Les poètes du néo-pétrarquisme occitan, bien souvent, ne procèdent pas autrement (Courouau 2012, 203-253) ; au XVIIIe siècle, dans l’espace germanique, on compose comédies et opéras dans le goût français et Johann Christoph Gottsched traduit Racine dans l’espoir de permettre à la littérature allemande de combler son retard par rapport à la littérature française (Jaubert 2012). En Catalogne, le bénédictin Miquel Ribes traduit en catalan et fait représenter par les paroissiens de Thuir Esther et Athalie de Racine, Polyeucte de Corneille (Pons 1929). Les exemples, en Europe, seraient nombreux. Aussi paradoxal que cela puisse paraître à certains, Lou Novy para est une pièce provençale écrite « à la française » pour le seul bénéfice de la langue et de la littérature provençales.