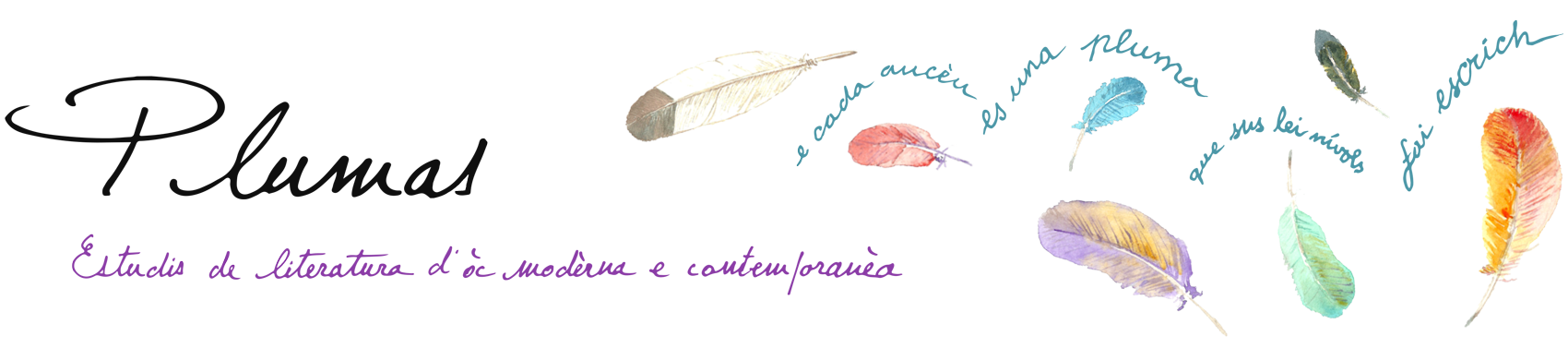Dans la littérature nissarde, le genre dramatique est fort riche, comptant plus de deux cent trente pièces écrites et pour la plupart jouées du début du XIXe siècle à nos jours. Même si le rapport à l’histoire est « un élément constant de toute dramaturgie […] car toute œuvre dramatique […] qu’elle s’intitule ou non pièce historique, fait référence à une temporalité et représente à ce titre un moment historique de l’évolution sociale » (Pavis 1980, 201), dans ce vaste corpus les pièces destinées à présenter un moment précis de l’histoire de Nice ou de son comté ne sont pas nombreuses. Le plus souvent, le cadre historique n’est qu’un décor temporel, par exemple les années 1830 et le règne du roi de Sardaigne Charles-Félix, utilisés par plusieurs dramaturges du XXe siècle. En revanche, au XXIe le Théâtre Niçois de Francis Gag1 crée en une dizaine d’années cinq comédies qui exploitent à des degrés divers l’histoire locale. De Jean-Luc Gag Santìssimou Bambino2 en 2006 et Raça ’stirassa [Bon sang ne saurait mentir] en 2010, reprise et publiée en 2016 ; de Hervé Barelli Ahì [Oui] en 2010, Doun van béure li bèstia ? [Elles vont boire où, les bêtes ?] en 2013 et Crònica d’en riba de mar [Chroniques du rivage] en 2015. Le propos sera d’examiner l’usage dramaturgique que font ces auteurs de la matière historique, puis leurs intentions en représentant le passé de Nice, enfin la manière dont ils le transcendent.
Dramaturgie
La typologie générique de ces pièces est aisée à établir. Leurs sous-titres à valeur architextuelle annoncent des œuvres comiques et parfois soulignent leur dimension historique. Santìssimou Bambino est une « comédie historico-policière » en quatre actes, huit intermèdes et un épilogue, Doun van béure li bèstia ? une « comédie archéologique » en trois actes, Raça ’stirassa une « comédie baroque » en soixante-six scènes, Crònica d’en riba de mar une « comédie littorale » en trois actes, un prologue et un épilogue. Ahì se distingue en tant que « comédie dramatique » en deux actes.
Qu’en est-il des fables ? La situation initiale de Santìssimou Bambino est inspirée d’un article d’Henri Costamagna paru dans Nice Historique, dans lequel on lit, à propos du sanctuaire de Notre-Dame de Laghet : « 1666 : le duc Charles-Emmanuel II venu avec son épouse implorer la naissance d’un fils (futur Victor-Amédée II) offrirent [sic] en remerciement un "bambino" d’or massif » (Costamagna 64). Mais au XVIIe siècle les Mémoires du notaire Honoré Giraudi (9-11) indiquent que le duc de Savoie vint seul à Nice du 16 janvier au 2 février 1666 (en effet, la duchesse, Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, dite Madame Royale, allait accoucher quatre mois plus tard, le 14 mai). Au XXe siècle un article de Charles-Alexandre Fighiera (821-822) ajoute que le couple envoya en 1667 à Laghet, comme ex-voto, une statue représentant l’enfant à sa naissance. Jean-Luc Gag, qui situe l’action de sa comédie en 1668, fait du Bambino une offrande propitiatoire et une œuvre d’art sacré : « il y a deux ans, notre Duc Charles-Emmanuel est venu avec Madame Royale, implorer la naissance d’un enfant mâle […] et il a fait l’offrande à la Vierge d’un bambin Jésus en or massif » (Gag 2006, 25). Le réemploi et la modification de la version d’Henri Costamagna simplifie l’exposé de la situation. L’action débute avec une transgression majeure, le vol de la statuette. Le moine archiviste, récemment diplômé de l’université de Bologne, Fraire Inoucent le bien nommé, est chargé de l’enquête et la mène dans la bibliothèque du monastère. L’on reconnaît là des souvenirs du Nom de la rose d’Umberto Eco, roman historique dont Jean-Luc Gag évoque avec humour le dénouement par la bouche de Fraire Beat : « Noun parlà de fuèc en la tiéu biblioutèca ! » [Ne parle pas de feu dans ta bibliothèque !] (Gag 2006, 58). Le détective improvisé apporte la médiation3 attendue en découvrant que, selon un schéma assez classique dans les fictions policières, le coupable n’est autre que celui qui prétend avoir découvert le crime et a donné l’alerte, c’est-à-dire justement Fraire Beat. De manière tout aussi classique, l’enquêteur obtient les aveux du suspect grâce à une preuve qu’il révèle ensuite avoir inventée. Le vol est en rapport avec le fait que Laghet est dirigé par un abbé détesté par le clergé et les édiles niçois depuis douze ans que les Carmes ont fait du sanctuaire un monastère. Dans la réalité ce changement n’a pas encore eu lieu en 1666, il surviendra en 1674 et les oppositions qu’il soulèvera dureront encore au XVIIIe siècle, mais cet anachronisme favorise la dramatisation. Le vol et la résolution de l’énigme ayant lieu le 25 mars, fête de l’Annonciation, l’on fait passer pour un miracle la disparition et la réapparition du Bambino : il serait allé à Turin guérir le petit Victor-Amédée alors gravement malade. Le prestige du monastère s’en trouvera renforcé. Ce subterfuge final est évidemment permis par la transformation de la statue du petit prince en représentation de l’Enfant Jésus. L’intrigue s’enrichit en outre de la présence d’une princesse envoyée par le duc enquêter secrètement sur la gouvernance de l’abbé ainsi que de pèlerins hauts en couleur, dont un vieil homme riche, sa jeune épouse et un soi-disant aveugle qui est l’amant de celle-ci.
Raça ’stirassa est adaptée de Sior Todero brontolon o sia Il Vecchio fastidioso de Carlo Goldoni, pièce en vénitien écrite en 1761 et créée en 17624, elle-même influencée par L’Avare de Molière. À Nice, au XVIIIe siècle, un vieux grippe-sou veut marier l’aînée de ses petites-filles au fils de son intendant. Mais la demoiselle aime un jeune Anglais et le fils de l’intendant est amoureux de la servante. La petite-fille cadette conseille aux deux couples de « s’enlever » pour imposer leurs mariages. Quoique s’opposant à son grand-père, elle est sa digne élève, aussi rusée et cupide que lui, d’où le titre.
Doun van béure li bèstia ? est inspirée d’un passage du journal intime de l’abbé Bonifacy (Barelli 2013, 4) contant qu’en 1825 on découvrit un sarcophage à Cimiez, dans la propriété du comte Garin de Cocconato. Dans la pièce, dont l’action se déroule « en 1820, ou pas loin » (Barelli 2013, 5), certains membres du conseil d’administration de la Société philharmonique sont enthousiasmés par la valeur archéologique de la découverte et le comte par sa valeur vénale, mais les paysans ne voient pas l’intérêt de ce qu’ils considèrent comme un vieil abreuvoir. Le sarcophage étant pris dans les racines d’un arbre mort, pour le dégager le général Michaud fait sauter la souche à la poudre à canon et… pulvérise ce vestige romain.
L’action de Crònica d’en riba de mar se déroule vers 1600. Sur la grève de la Baie des Anges, des pêcheurs voient un Siamois descendre d’une felouque, puis repêchent un cadavre chargé de pièces d’or et enfin assistent à l’échouage de la galère d’un cardinal espagnol.
Ahì montre Rosa Vercellana, la maîtresse niçoise du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II, arrivant à Nice pour affaires le 16 avril 1860. En ce jour du plébiscite sur l’annexion du Comté à la France, elle reçoit plusieurs visiteurs intéressés.
Quelles sont les caractéristiques des univers de fiction ? Les choix chronologiques sont en général novateurs. Le XVIIe siècle, deux fois présent ici, est d’habitude absent de la scène nissarde. Le XVIIIe y est plus fréquent5, mais les débuts du tourisme à Nice, vers 1760, n’ont jamais été évoqués avant Raça ’stirassa. Certes, on représente souvent le XIXe siècle, mais Ahì est la première pièce consacrée à l’Annexion. En revanche, le traitement de la temporalité est très classique, la plupart des pièces respectant l’unité de temps. L’action de Santìssimou Bambino, abstraction faite de l’épilogue, tient en moins de vingt-quatre heures, comme celle de Raça ’stirassa. Ahì se déroule entre l’aube, quand la servante Madalena « duerbe lu escur » [ouvre les volets] (Barelli 2010, 7) de l’appartement de Rosa, et le crépuscule, lorsque Rosa « va serrà lu escur » [va fermer les volets] (Barelli 2020, 72) et repart pour Turin. Seules Doun van béure li bèstia ? et Crònica d’en riba de mar ont une action qui dure trois jours.
Les choix géographiques exploitent le répertoire textuel commun aux auteurs et au public. Situé entre Nice et Monaco, le sanctuaire de Laghet, haut-lieu de la piété niçoise, ligurienne et piémontaise, est très populaire6. Ahì se déroule dans un modeste logement du Vieux-Nice, rue de la Condamine, et respecte l’unité de lieu. Cimiez et la plage de la Baie des Anges, cadres des deux autres pièces de Hervé Barelli, sont connus de tous. Seule, Raça ’stirassa a une localisation imprécise et symbolique qui synthétise le littoral et la campagne : il est dit qu’une fenêtre de la maison donne sur le port et le décor unique représente le jardin, avec la balançoire empruntée au tableau de Fragonard, Les Hasards heureux de l’escarpolette (1767)7, qui illustre la couverture de l’édition du texte.
Les personnages, de conception classique, sont souvent imaginaires, mais certains sont historiques, telle Rosa Vercellana (1833-1885), dite la Bella Rousin. Cette fille de tambour-major fut faite comtesse de Mirafiori et Fontanafredda par le roi, puis devint son épouse morganatique. Même chose pour les membres de l’authentique Société philharmonique que l’auteur de Doun van béure li bèstia ? met en scène en adaptant ou modifiant leur biographie pour accentuer leur caractérisation. Selon Jean-Baptiste Toselli (90-100), le général Alexandre Michaud, comte de Beauretour (1772-1841), après avoir été un soldat héroïque au service de la Russie pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire, l’aide de camp du tzar et un habile diplomate, s’est retiré à Turin. Mais dans la pièce, revenu à Nice, sa ville natale, il est la caricature du vieux militaire borné, radoteur et dur d’oreille – ce qui est savoureux pour un membre d’une société de mélomanes et de musiciens ! Le comte Hilarion Spitalieri de Cessole (1776-1845) préside la Société8. On le présente dans la fiction comme Premier Président du Sénat de Nice, alors qu’il remplira cette fonction à partir de 1833 selon La Vie de la noblesse niçoise de Simonetta Tombaccini (158). Sa fille, née en 1806 et prénommée Delphine, devient dans la pièce Mathilde, une autre Spitalieri de Cessole née en 1835 (Tombaccini, 9e p. hors-texte après 394). Il peut y avoir extrapolation à partir de données du même ouvrage. Ainsi le baron Millonis9 du Touët qui « vivait comme un reclus dans son fonds de Cimiez » pour y soigner ses affections « nerveuses » (Tombaccini 76, 181), devient sur scène un nouvel Alceste, un peu fou, reclus dans sa « campagna de Carabacèu »10 (Barelli 2013, 7). Le comte Garin de Cocconato, qui avait vendu une ferme que son épouse possédait au Piémont pour acheter son domaine de Cimiez (Tombaccini 96), se voit reprocher sur scène par la comtesse d’avoir vendu sa terre des Iscles du Var. Le marquis Peyre de Châteauneuf, que dans la réalité la marquise quitta pour un autre homme (Tombaccini 280), se console dans la pièce avec des prostituées. Revendiquant sa liberté de créateur, l’auteur précise :
Tous les membres de la Société philharmonique qui vivront sous vos yeux ont réellement vécu. De là à dire qu’ils étaient comme ça, qu’ils se parlaient comme ça […], il y a un grand pas que la fiction m’encourage à franchir allègrement... (Barelli 2013, 4)
Autre exemple de ce jeu entre imagination créatrice et réalité historique à l’œuvre dans le processus d’écriture, il est question dans la pièce d’un hivernant, lord Abercrombie, président de la Société royale d’histoire de Londres :
aquel ome es touplen interessat en lu antìcou. A jà viajat per touta Itàlia, e finda en Grècia, e n’a trouvat un mouloun, qu'a rapourtat à Loundra. […] E aloura, ’stou matin, per cas, si trouvava à Cimiés, a vist lou sarcoufage, e lou vòu croumpà per lou si pourtà à Loundra (Barelli 2013, 27).
Cet homme est passionné par les antiquités. Il a déjà voyagé dans toute l’Italie, et aussi en Grèce, et il en a trouvé tout un tas, qu’il a rapporté à Londres. […] Et alors, ce matin, par hasard, il se trouvait à Cimiez, il a vu le sarcophage et il veut l’acheter pour l’emporter à Londres.
Ce personnage semble le produit du croisement de près d’une demi-douzaine de données historiques. Il y eut des lords of Abercrombie, mais le dernier est décédé en 1681. La Royal Historical Society existe, mais a été fondée en 1868. Un lord Abercromby of Tullibody, décédé en 1795, fut l’un des fondateurs de la Royal Society of Edinburgh qui s’occupe entre autres d’histoire, mais existe depuis 1783. Un Abercromby, John, cinquième baron de Tullibody, fut effectivement archéologue et grand voyageur, mais, arrière-petit-neveu du précédent, naquit en 1841 et mourut en 1924 !
Contrairement aux constantes des drames historiques en français ou en occitan du XIXe siècle et du début du XXe11, les personnalités de premier plan n’apparaissent pas sur scène et ne font l’objet que d’allusions, tels Charles-Emmanuel II, le tsar Alexandre Ier, Charles-Félix, Victor-Emmanuel II, Cavour ou Garibaldi. Quant au peuple, il a des représentants imaginés, personnages principaux comme les pêcheurs de Crònica d’en riba de mar ou secondaires comme les paysans de Doun van béure li bèstia ?, sortes de clowns shakespeariens, ignorants, stupides et prompts à se battre pour des motifs dérisoires. Les visiteurs de la Bella Rousin dans Ahì sont, pour reprendre une formule de Marx, les « porte-parole de l’esprit du temps » (Pavis 202). Mais si chacun symbolise une option politique, aucun n’est une abstraction, tous ont une épaisseur psychologique. L’affairiste Bermondi a aimé Rosa et elle l’aime encore, le Dr Maulandi a été amoureux de la servante Madalena, le curé a de l’affection pour Rosa qu’il a baptisée, le cordonnier Bertoumiéu veut acheter l’appartement pour l’offrir à sa propre fille qui va se marier.
Dans l’ensemble, ces pièces sont fidèles au classicisme nissart dont Francis Gag fut en son temps le meilleur représentant, avec une action reposant généralement sur des dialogues brillants interprétés dans des décors très discrets. Mais elles s’en distinguent par l’originalité des thèmes et l’audace de certaines répliques, parfois lestes, ainsi que, dans Crònica d’en riba de mar et Doun van béure li bèstia ?, par une plus grande exploitation de l’espace scénique, des jeux de scène violents et collectifs (des bagarres en tout genre) ainsi que quelques moyens techniques spectaculaires, élément de décor (l’« esperoun de sièi metre » [éperon de six mètres] de la galère du cardinal surgi des coulisses « qu’atravessa ourizountalament la scena de jardin en court e si ferma aquì, d’un còu » [Qui traverse horizontalement la scène de jardin en cour et s’arrête là, d’un coup] (Barelli 2015, 101)) et pyrotechnie (l’explosion du sarcophage, avec « grand remoun e gran lume » [Grand bruit et grande lumière], « fum e pous en l’ària » [Fumée et poussière dans les airs] (Barelli 2013, 137)).
Motivations
L’intention des auteurs peut être esthétique, à savoir susciter le dépaysement temporel par la pièce en costumes. C’est peut-être plus sensible dans Raça ’stirassa qui est surtout une comédie de caractère, mais il est possible que ce soit aussi un but secondaire de l’écriture des autres œuvres. Cette pièce obéit de plus à un dessein réflexif original, que l’auteur indique :
RAÇA ’STIRASSA :
locution populaire qui manifeste le prolongement d’une lignée, à rapprocher de : Una prunièra noun fa de figa. Et dans cette comédie, c’est bien de prolongements qu’il s’agit :
– prolongement de l’œuvre de Francis Gag, dont une ébauche de traduction de Carlo Goldoni sert de base à l’écriture de la présente comédie de Jean-Luc, son petit-fils ;
– prolongement en scène, où Pierre-Louis le fils, et Marie l’arrière-petite-fille, revivent leur véritable lien familial ;
– prolongement de l’autorité du vieux despote Felis, qui va transmettre son pouvoir familial à sa petite-fille cadette.
RAÇA ’STIRASSA : la tradition du théâtre en langue niçoise franchit les époques (Gag 2016, 2).
L’intention didactique est plus évidente. Selon Hugo, « le théâtre est un lieu d’enseignement » (140). Les auteurs sont précisément des enseignants et Hervé Barelli est historien. Mais plutôt que de reconstituer avec réalisme des événements historiques, ils stylisent et révèlent l’ambiance de certains moments d’une histoire du Comté que l’école oublie ou occulte. Raça ’stirassa montre que le tourisme apparaît à Nice plus tôt qu’on ne le croit habituellement. Angèlica aime un Anglais, Toby Stuart12, dont le prénom évoque Tobias Smollett, écrivain écossais qui résida à Nice de décembre 1763 à avril 1765 et par ses écrits fit découvrir le pays aux Britanniques (Smollett 1994). L’époux qu’on veut imposer à la jeune fille est le fils d’un des Suisses qui ont créé l’hôtellerie niçoise : « A servit en aquelu "hôtel" que n’an pourtat lu Suissa »13 (Gag 2016, 53). Le philosophe Johann Georg Sulzer est le plus célèbre des premiers touristes helvétiques, bien qu’il ait vécu à Berlin de 1747 à sa mort en 1779. Il résida à Nice en 1775 et décrivit la ville dans son Journal de voyage. Smollett et Sulzer, comme d’autres, étaient venus y soigner leur tuberculose. Aussi, apprenant que Toby « Caminava plan-planin en riba de mar… […] semblava proufità dau soulèu e respirava à plen poumoun l’ària de la mar » [Il cheminait lentement au bord de mer… […] il avait l’air de profiter du soleil et il respirait à plein poumon l’air de la mer] (Gag 2016, 47), Angèlica s’exclame « Mai un malaut ! Venon toui aquì ! » [Encore un malade ! Ils viennent tous ici !] (Gag 2016, 47). Il est en effet « un pauc deble dóu poumoun… aloura, lou soulèu dóu miejour, capissès… » [un peu faible du poumon… alors le soleil du midi, vous comprenez…], avoue Rufina, la faiseuse de mariages (Gag 2016, 21). La scène indique en outre que les Britanniques apportèrent à Nice « le désir de rivage », pour reprendre l’expression d’Alain Corbin (1988). Les paysans de Doun van béure li bèstia ? traitent de fous ces hivernants parce qu’ils regardent la mer pendant des heures (Barelli 2015, 67), ce qui fait allusion à la réalisation en 1822 du chemin du bord de mer (la future Promenade des Anglais) grâce aux quêtes organisées par le révérend Lewis Way auprès de la colonie britannique.
Santìssimou Bambino rappelle que le Comté fit partie des États de Savoie pendant un demi-millénaire et que les princes, comme le peuple, vénéraient Notre-Dame de Laghet. Même traités sur le mode comique, les détails concernant pèlerinages et miracles sont exacts et inspirés par l’article d’Henri Costamagna déjà cité : pèlerins estropiés ou aveugles, visites de confréries de pénitents, ex-voto, onctions d’huile de lampe, etc. Ainsi, en 1677, « la bienheureuse Marie des Anges, novice au couvent des Carmélites à Turin, fut guérie par des onctions d’huile des lampes de Laghet » (Costamagna 64). D’où la réplique du faux aveugle : « quoura […] provi de m’ougne lu uès embé l’oli dei lampa, davant de l’autà de la Madona, n’en mèti dapertout » [quand j’essaie de m’oindre les yeux avec l’huile des lampes, devant l’autel de la Madone, j’en mets partout] (Gag 2006, 43). De même, en 1715, la duchesse Marie-Jeanne-Baptiste offrit une jambe d’argent au sanctuaire, en remerciement d’une guérison (Costamagna 64-65). C’est pourquoi dans la pièce le vieux mari trompé apporte un ex-voto identique et explique : « veni just per li miéu camba » [mje viens seulement pour mes jambes !]. Il ajoute à l’intention d’un pèlerin discourtois à son égard : « E après, ti farai tastà dóu miéu pen ! » [Et après, je te ferai tâter de mon pied !] (Gag 2006, 13)
Doun van béure li bèstia ? se situe pendant la renaissance culturelle niçoise qui éclot sous la Restauration sarde. Il y est question de quelques grandes figures de l’époque comme le poète dialectal Joseph-Rosalinde Rancher ou le peintre Paul-Émile Barberis, on y voit le naturaliste Jean-Baptiste Vérany et le général Michaud de Beauretour y rabâche ses faits d’armes contre Napoléon Ier, dont la victoire de la Bérézina. De même, un des paysans s’enorgueillit d’avoir participé à la défaite des Français sur l’Authion en 1792. Cela rappelle que pour comprendre l’histoire des Niçois mieux vaut la lire en quittant le point de vue de l’histoire de France.
La troisième intention est d’effectuer une relecture critique de l’histoire communément admise. Toujours dans Doun van béure li bèstia ?, la peinture de l’intelligentsia niçoise de la Restauration sarde est un jeu de massacre qui, avec des nobles parfois de fraîche date, vulgaires, rongés par l’inimitié14, exploiteurs, capables de se battre comme des chiffonniers avec les paysans, nuance l’image positive que la littérature nissarde offre le plus souvent des années 1820-1830, époque du buon governo de Charles-Félix. Quant à la fille du comte Spitalieri, lectrice de René de Chateaubriand, elle est la caricature de la jeune romantique exaltée. Hervé Barelli indique que sa pièce est « teintée de l’influence ironique » de l’écrivain sicilien Andrea Camilleri (Barelli 2013, 4). On y retrouve en effet l’humour grotesque et l’extravagance d’un auteur qui s’inspire souvent de l’histoire. L’explosion finale du sarcophage et de son contenu fait ainsi songer à celle du cadavre du Père Uhu, bourré d’explosifs, dans le roman Il Re di Girgenti.
Plus grave de ton, Ahì a été créée pour les cent cinquante ans de l’Annexion de Nice à la France. On songe cette fois à une autre œuvre sicilienne, Le Guépard que Giuseppe Tomasi di Lampedusa écrivit à l’approche du centenaire de l’unité italienne. Contredisant l’historiographie, ces deux œuvres audacieuses révèlent l’importance de l’opportunisme dans l’adhésion à de nouveaux États de régions à fort particularisme, ainsi que les doutes qui pèsent sur la validité des plébiscites organisés alors15. Ahì, selon l’auteur « obra imaginària. Encara que… » [œuvre imaginaire. Encore que… ] (Barelli 2010, 1), démythifie un vote destiné à confirmer une décision déjà prise. Pressée de prendre parti, la Bella Rousin s’y refuse, disant ne pas s’intéresser à la politique. De plus, ajoute-t-elle, le roi lui a confié sur l’oreiller que les résultats du scrutin ont été fixés à l’avance par Cavour et le gouvernement français. Elle avoue ses souffrances de « petan d’un Rei » [putain d’un roi ]16 (Barelli 2010, 41), certes aimée de celui-ci, mais méprisée par la cour. L’aristocratie est représentée par la comtesse de Venanson, qu’ennuient la politique et les intrigues des Français, des Russes et des Anglais à propos de Nice. Pour elle le plébiscite est une « mascarade » (Barelli 2010, 28) et elle n’a qu’une patrie, la jet set d’alors, ses parents ou amis de Madrid, Munich, Paris, Palerme et même Vienne, capitale d’un empire ennemi du royaume de Sardaigne. En revanche, l’affairiste ruiné Bermondi, militant du oui, pense se refaire grâce au Second Empire. Prénommé Càrlou, serait-il la caricature du banquier Carlone, dirigeant du parti profrançais17 ? Le curé apprécie Napoléon III qui est l’ami du pape et rémunère bien le clergé. Le comte de Venanson, chargé par le roi de veiller à la victoire du oui, ne craint pas l’annexion car il conservera ses biens dans le Comté. Seul soutient le non le Dr Maulandi, garibaldien qui déteste le « Néron » de Paris (Barelli 2010, 34). Quant à Bertoumiéu, « brave pegoun » [brave cordonnier] (Barelli 2010, 45) peut-être issu de la chanson populaire Lou Gibous, il représente le peuple tiraillé par les deux bords, harcelé par les profrançais qui abusent de sa naïveté, essaient d’acheter sa voix, lui donnent un bulletin oui et l’emmènent au bureau de vote. Bermondi lui montre deux pièces d’or et lui demande qui elles représentent. Bertoumiéu confond Napoléon III et Victor-Emmanuel II. L’autre triomphe : « avès rasoun, regarjas, soun escasi parié […]. Aloura, cen que vous pòu ben faire ? Riscas ren de voutà lou si » [vous avez raison, regardez, ils sont presque pareils […]. Alors, qu’est-ce que cela peut bien vous faire ? Vous ne risquez rien à voter pour le oui]. (Barelli 2010, 50). On n’est pas loin de Tancrède disant dans Le Guépard : « Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi » [Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change18] (Tomasi di Lampedusa 41). Bertoumiéu n’est pas convaincu : « Mà se soun lu parié, perqué lu mi voulès chanjà ? » [Mais s’ils sont pareils, pourquoi voulez-vous les changer ?] (Barelli 2010, 51). Il se décide pour le oui en apprenant que Napoléon III promet aux Niçois un million de francs et le chemin de fer. Mais il n’aura pas l’appartement de Rosa. Pour lui rien ne change, au fond. Et Rosa ? Elle déclare au dénouement : « La miéu Nissa es mouòrta » [Ma Nice est morte] (Barelli 2010, 72). Et elle s’en va. Ainsi s’achèvent cinq siècles d’histoire.
Dépasser le passé
Selon Florence Naugrette, au XIXe le drame historique représente « le passé pour penser le présent » (Naugrette 186). Est-ce le cas ici ? La satire des temps actuels semble parfois pointer. Doun van béure li bèstia ?, où sévissent cupidité et sottise, où ce « bimbàrou » [cinglé] (Barelli 2013, 133) de général fait exploser le sarcophage, pourrait dénoncer entre autres les destructions du patrimoine niçois qui émaillèrent le XXe siècle, du médiéval Pont-Vieux en 1921 au Palais de la Méditerranée, chef-d’œuvre de l’Art déco, en 1990. Dans le titre, le mot bèstia peut être polysémique !
Ces pièces reflètent surtout, non sans ironie et second degré, des constantes qui relèvent du temps long ou de l’histoire des mentalités. Dans Crònica d’en riba de mar, le majordome du cardinal dit au pêcheur Pètou : « Aquèu paìs ! Toujour mai de prepoutença que de sourdà ! Carguessias lu canoun mé l’idéa que vous fès de vous-meme, serias lu rei dóu mounde ! » [Ce pays ! Toujours plus de prétention que de soldats ! Si vous chargiez vos canons avec l’idée que vous vous faites de vous-mêmes, vous seriez les rois du monde !] (Barelli 2015, 113). Cette remarque est à rapprocher des paroles du prince Salina dans Le Guépard : « I Siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti ; la loro vanità è più forte della loro miseria » [Les Siciliens ne voudront jamais devenir meilleurs pour la simple raison qu’ils croient être parfaits. Leur vanité est plus forte que leur misère] (Tomasi di Lampedusa 217). On pourrait poursuivre le parallèle avec le goût de l’immobilité que le prince prête à ses compatriotes : « il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di "fare" » [le péché que nous, Siciliens, nous ne pardonnons jamais est simplement celui de « faire »] (Tomasi di Lampedusa, 209). Cela fait songer au laisse-mi stà [la nonchalance] souvent reproché aux Niçois. Les Siciliens auraient ce travers pour avoir été soumis, dit le prince, à la « lunghissima egemonia di governanti […] che non parlavano la nostra lingua » [très longue hégémonie de gouvernants […] qui ne parlaient pas notre langue]. Cela pourrait s’appliquer aussi aux Niçois.
En effet, la question des langues est capitale dans le Comté de Nice où, depuis longtemps se confrontent langue d’un pouvoir lointain et langue du pays. Les auteurs dramatisent la problématique diglossique, dénonçant par le comique le mépris linguistique. Leurs pièces revendiquent la dignité du nissart et l’on comprend pourquoi ils se réfèrent parfois à des écrivains qui ont utilisé des dialectes, le vénitien pour Goldoni, le sicilien pour Camilleri. Chez Gag et Barelli, les autorités s’expriment en italien ou en français. L’abbé de Santìssimou Bambino emploie ces langues parce qu’il est savoyard et… abbé, désespéré d’être relégué chez des « mangeurs de blette analphabètes […] Qui ne parlent ni français ni italien » (Gag 2006, 23)19. Le voyageur français qualifie le nissart de « langue de barbares » (Gag 2006, 8). Quoique niçoises, la princesse de Santìssimou Bambino et la fille du tambour-major devenue comtesse de Ahì parlent italien, car leur rang social implique le changement de langue. Bien que niçois, le majordome du cardinal, dans Crònica d’en riba de mar, dit au pêcheur Pètou :
Ti pouòdi […] parlà italian, spagnòu, latin, aramean qu’es la lenga de Nouòstre Signour, grècou, ebrèu e siriàcou, mà per lou moument, ti parli nissart, estent qu’una bèstia couma tu noun capisse qu’una lenga de bèstia (Barelli 2015, 103).
Je peux […] te parler italien, espagnol, latin, araméen, qui est la langue de Notre Seigneur, grec, hébreu ou syriaque, mais pour le moment, je te parle niçois puisqu’une bête comme toi ne peut comprendre qu’une langue de bête.
Parler une langue dominante révèle du pouvoir et en confère. Le Suisse de Raça ’stirassa manipule l’avare, car « Basta que li parle francés e op ! lou vielh es embarlugat. Li fa faire cen que vòu èu ! » [Il n’a qu’à lui parler français et hop ! Le vieux est ébloui ! Il lui fait faire ce qu’il veut lui !] (Gag 2016, 11). Dans Doun van béure li bèstia ?, le comte Spitalieri de Cessole préside en français la réunion de la Société philharmonique et fait enseigner cette langue à sa fille, signe d’appartenance au grand monde à ses yeux, mais « lingua di donne » [langue de femmes] (Barelli 2013, 25) selon le comte Audiberti de Saint-Étienne qui préfère l’italien, autre langue noble. Cependant certains Niçois résistent. Dans Santìssimou Bambino, les pèlerins de Laghet, moqueurs, s’apitoient sur le voyageur français qui ne comprend rien au nissart :
La maigran. – Es pas de la siéu fauta… Es francés, mesquin…
La pichouna. – Ah ! paur’ome… (Gag 2006, 11)
La grand-mère. – Ce n’est pas de sa faute… Il est français, le malheureux…
La petite fille. – Ah ! le pauvre homme…
L’incommunicabilité générale, aggravée par un pèlerin sourd-muet, rend désopilants les interrogatoires de l’enquête. Même dans la haute société, le dialecte revient vite, car comme le souligne Camilleri citant Pirandello, autre Sicilien, il « exprime le sentiment, là où la langue exprime le concept »20. Dans Doun van béure li bèstia ? Mlle Spitalieri le laisse échapper sous l’emprise de la colère. La princesse de Santìssimou Bambino l’emploie pour évoquer son intimité avec le duc et la confidentialité de sa mission. Dans Ahì, en un italien marqué par le piémontais, Madalena demande à Rosa de parler nissart : « adesso che siamo tornate a Nizza […] Mica possiamo parlare nizzardo di nuovo, come lo facevamo tempo fà ? […] È la lingua delle nostre madri. Mica la possiamo dimenticare » [maintenant que nous sommes revenues à Nice, ne pourrions-nous pas parler de nouveau nissart, comme nous le faisions autrefois ? C’est la langue de nos mères, nous ne pouvons l’oublier]. Car le dialecte exprime l’amour du pays natal : « Era pas per parlà, era per dire. […] Per dire… sabi pas iéu. Per dire que siéu ben countenta de m’aretrouvà aquì » [Ce n’était pas pour parler, c’était pour dire. […] Pour dire… Je ne sais pas, moi. Pour dire que je suis bien contente de me retrouver ici] (Barelli 2010, 7). Il apaise aussi les tensions politico-linguistiques. Spitalieri passe au nissart quand le comte Audiberti lui reproche de présider en français et non en italien, langue officielle. Dans la mentalité niçoise la langue fonde la nissardité et son prestige, même concurrencé, reste intact. Dans Crònica d’en riba de mar, le dieu Acheloos tranche par un aphorisme de son cru : « sirena d’un paìs n’en déu parlà la lenga » [sirène d’un pays doit en parler la langue] (Barelli 2015, 55).
Car dans Crònica d’en riba de mar il y a encore des sirènes, des nymphes et des dieux, symboles d’une culture méditerranéenne immémoriale. Pisinoua, Aglaoupa, Telsepìa (Pisinoé, Aglaopé, Thelxiépie) sont issues de la Bibliothèque d’Apollodore le Mythographe, bien qu’elles aient sur scène l’apparence des femmes-poissons de la tradition scandinave et non celle des femmes-oiseaux de la mythologie grecque. Elles tentent sans conviction de dévorer les pêcheurs pour obéir à Teti (Thétis), laquelle s’exprime en grec ancien. C’est un souvenir du roman Maruzza Musumeci de Camilleri, dans lequel des sirènes chantent des vers d’Homère dans cette langue, se vengent d’Ulysse en provoquant la mort du paysan Aulisse, puis veulent vivre en paix avec les humains. Dans Santìssimou Bambino la mythologie est représentée par la statue de Vénus que le concupiscent Fraire Beat a trouvée, dont il est amoureux et que l’abbé lui a confisquée. Beat a volé le Bambino pour se venger, en une opposition inattendue entre paganisme et christianisme. Enfin toute l’action de Doun van béure li bèstia ? tourne autour du sarcophage antique. Mais la culture gréco-latine n’est connue que de quelques savants, oubliée ou saccagée par le reste de la population : la Vénus rejoint les collections de l’historien Gioffredo21, les pêcheurs ignorent les agissements de sirènes effrayantes et inoffensives, le sarcophage est réduit en miettes.
Toutefois la présence secrète et ambiguë de créatures marines fantastiques métaphorise une dimension importante de l’âme niçoise, le rapport à la mer que résume le proverbe Lauda la mar e ten-ti en terra [Loue la mer et reste à terre], proverbe qui est aussi provençal, génois, corse et bien sûr sicilien. Cependant, Hervé Barelli a écrit Crònica d’en riba de mar pour en corriger l’interprétation habituelle qui veut que les Niçois se détournent de la mer. Familier des « textes anciens du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle », il a constaté que leurs auteurs ne parlent que de marchands niçois audacieux, naviguant de la Sicile à la Crimée, jusqu’en Égypte ou aux Açores ; ou de corsaires, niçois, nombreux, et d’autant de courageux marins :
Et si on se méfie de la mer, c’est bien parce qu’on va souvent dessus, elle qui enrichit, qui nourrit et qui libère, elle par qui […] arrivent toutes les innovations, toutes les nouvelles, et aussi bien des dangers (Barelli 2015, 3).
La comédie montre donc ce que la mer apporte. Fortune : l’or du noyé. Épidémies : le noyé est un pestiféré. Rencontres prestigieuses : le cardinal espagnol. Rencontres grotesques : ledit cardinal a le mal de mer et vomit beaucoup. Exotisme merveilleux : le Siamois décrit des temples d’or et des éléphants couverts de soie. Surprises : le Siamois déclare être né à Villefranche-sur-Mer22, se nommer Victor et avoir effectué un périple inouï, dans lequel on reconnaît le quatrième voyage de Sindbad avec naufrage, sauvetage par un marchand, arrivée dans un pays lointain, amitié royale et beau mariage ! Il dit se rendre à Versailles en tant que ministre du roi du Siam, réécriture cocasse de l’ambassade de Kosa Pan auprès de Louis XIV en 1686. Beaucoup de Niçois naviguent donc, puisque le majordome du cardinal est lui aussi niçois.
Cela suggère au pêcheur Chouà de quitter Nice pour fuir son frère Pètou qui l’exploite. Embauché par le cardinal comme « assistent à l’ajount à la gardaróuba cardinalìcia » [assistant à l’adjoint à la garde-robe cardinalice] (Barelli 2015, 115), il part pour Rome, comme le fit – à un autre niveau ! – Du Bellay intendant de son cousin cardinal. Cette fuite rappelle que Victor refuse de rester dans son pays natal où il ne connut que la misère et en baise le sol… avant d’y uriner. Songeons aussi à la décision de Rosa de ne jamais revenir à Nice (Barelli 2010, 72) et peut-être encore à la détestation que le baron Millonis voue à ces « palhàssou de Nissart »23 (Barelli 2013, 41), si mesquins :
Sabès, li soun de jour que mi pantalhi un bèu gran festin de boulet per touta Nissa, aqui, sus lou Cours, embé lou Gouvernatour, lu óuficié de la garnisoun, lou Counsèu coumunal, lou Senat, l’evesque, lou capìtoulou, toui lu preire, lu garda, la noublessa, lu negouciant, lu mesteirant, lu paisan, lu pescadou, toui, lu vielh, li frema, lu pichoui. E crac, l’endeman, toui nec, toui sec e fin de l’istòria ! (Barelli 2013, 11)
Savez-vous, il y a des jours où je rêve d’un grand et beau festin de champignons pour toute Nice, ici, sur le Cours, avec le gouverneur, les officiers de la garnison, le Conseil communal, le Sénat, l’évêque, le chapitre, tous les prêtres, les policiers, la noblesse, les négociants, les artisans, les paysans, les pêcheurs, tous, les vieux, les femmes, les enfants. Et vlan, le lendemain, tous raides, tous secs, et fin de l’Histoire !
Ces comportements sont paradoxaux quand on sait l’attachement viscéral des Niçois à leur ville et à leur contrée. L’auteur en fait-il la satire, ou en montre-t-il l’envers, une sensation d’étouffement due à l’« insularité » du Comté de Nice ? Car ne peut-on appliquer à ce territoire pris entre montagne, mer et fleuve le concept d’« île continentale » proposé par Fernand Braudel dans La Méditerranée (Braudel 147) et repris par Predrag Matvejevitch dans son Bréviaire méditerranéen sous la forme de « lieux insulaires sur le continent » (Matvejevitch 29) ? Ce serait une raison de plus de se référer comme Hervé Barelli à l’œuvre du sicilien Camilleri, qu’il trouve « si proche de nous, Niçois » (Barelli 2013, 4).
Enfin ces pièces abordent la question générale du soi, de l’autre et du même. Elle se pose à partir de l’attitude des Niçois à l’égard des étrangers, caricaturale et décrite avec autodérision, mais qu’expliquent des siècles de guerres, de sièges, d’invasions et de pillages qui ont fait de l’autre, quel qu’il soit, celui dont il faut se méfier et se protéger pour survivre. Dans Raça’stirasssa, Reparata déclare « si cau maufidà dei Suissa : davant la ti fan bouòna e darrié ti tiron la mouòstra sensa que li vègues ren ! » [il faut se méfier des Suisses : devant, ils te sourient et derrière ils te volent la montre sans que tu y voies rien] (Gag 2016, 11) et s’effraie que l’amoureux de sa fille soit anglais : « Se countinùa ensin, un jour à Nissa li serà mai d’estrangié que de Nissart ! » [Si ça continue comme ça, un jour à Nice, il y aura plus d’étrangers que de Niçois !] (Gag 2016, 21) Dans Santìssimou Bambino, le voyageur qui passe la nuit avec les pèlerins est suspecté du vol par les Niçois pour une seule raison : « E qu d’autre ? Es francés ! » [Et qui d’autre ? Il est français !] (Gag 2006, 45) Le coupable, Fraire Beat, a surtout volé le Bambin pour punir l’abbé « de pas estre d’aquì » [de ne pas être d’ici] et provoquer son renvoi en Savoie. « Cadun au siéu ! » [Chacun chez soi], dit-il (Gag 2006, 76). D’ailleurs le nom de l’abbé, Barullaz, bien qu’en apparence inspiré du patronyme savoyard Marullaz que l’on rencontre en particulier à Morzine, fait en réalité jeu de mots avec le verbe d’oc barulà « errer, traîner en tout lieu » et, tel un aptonyme, transforme cet ecclésiastique en vagabond. Dans Doun van béure li bèstia ? le comte Garin injurie ses paysans niçois, gavots et piémontais en les traitant de Français (Barelli 2013, 97), ce qu’ils prennent très mal, puis de « Maufatan », de « Ladre », de « Revouluciounari » et, au terme de son crescendo, de « Prouvençau »24, injure suprême à ses yeux (Barelli 2013, 145).
Or les événements de 1860 bouleversent les consciences et le sentiment d’identité. Dans Ahì, Bertoumiéu résume le problème des Niçois qui, après avoir combattu les Autrichiens à Novara et s’être passionnés pour le Risorgimento, sont sommés de devenir les compatriotes des Français, leurs ennemis séculaires :
Doui an fa, noun si parlava que d’Itàlia, dóu Rei, dei Savòia que iéu noun ai jamai augut à m’en lagne. Despì doui an, noun si parla pus que de França, dei Francés qu’à moun paure paigran li avìon rouinat la maioun, damount, en Bellet [...]. Li a de moument, capissi pas (Barelli 2010, 50).
Il y a deux ans, on ne parlait que d’Italie, du roi, des Savoie dont moi je n’ai jamais eu à me plaindre. Depuis deux ans, on ne parle plus que de France, des Français, qui avaient détruit la maison de feu mon grand-père, là-haut à Bellet. Il y a des moments où je ne comprends pas.
Le thème du soi et de l’autre est particulièrement traité dans l’acte I de Crònica d’en riba de mar, lors de la capture du Siamois par Pètou et son frère Chouà. Dans la bagarre, Pètou, incapable de dépasser l’apparence exotique de l’étranger, ne réalise pas que celui-ci parle comme lui. Il ne reconnaît pas sa propre langue et croit comprendre le « maure » parce qu’il a reçu un coup sur la tête, puis crie que c’est parce que « Lu Mòrou soun toui nissart » [Les Maures sont tous niçois] (Barelli 2015, 33). Revenu à la raison, il met du temps à admettre que le Siamois Victor soit né à Villefranche et parle nissart, puis dit s’être « toujour maufidat » [toujours méfié] (Barelli 2015, 37) des Villefranchois pour maintenir à tout prix l’inconnu dans son statut d’autre inquiétant. Au contraire, Chouà voit dans l’autre son prochain. Lui-même ressemble à un Maure, sa mère le lui a toujours dit et on le surnomme « Lou Mouret », c’est-à-dire le petit Maure. Réciproquement, le Siamois souligne les ressemblances de son bouddhisme avec le christianisme de Chouà.
À l’acte suivant, Chouà dit avoir constaté que personne à Villefranche ne se rappelle Victor ni sa famille. Qui est donc ce mystérieux Siamois ? Un imposteur ? Ou plutôt un symbole valable partout, l’étranger qu’on découvre proche de soi, notre semblable malgré les différences, signe de l’humanité commune qui prime sur toute autre considération ? Ici l’on a le sentiment que l’autre est je et la recherche de l’identité aboutit à la découverte de l’identique25.
Pour conclure, on détournera la formule de Jean-Luc Gag qui définit Santìssimou Bambino comme « una drola d’istòria en un paìs estrange » [une drôle d’histoire dans un étrange pays ]26 (Gag 2006, 3), en l’appliquant à l’histoire mouvementée du Comté de Nice. Les pièces étudiées, qui puisent dans le réservoir d’inspiration que constitue celle-ci, contribuent brillamment à expliquer cet étrange pays d’ordinaire si mal compris. Elles favorisent la réflexion, suscitent une fructueuse introspection collective et conduisent du local à l’universel.