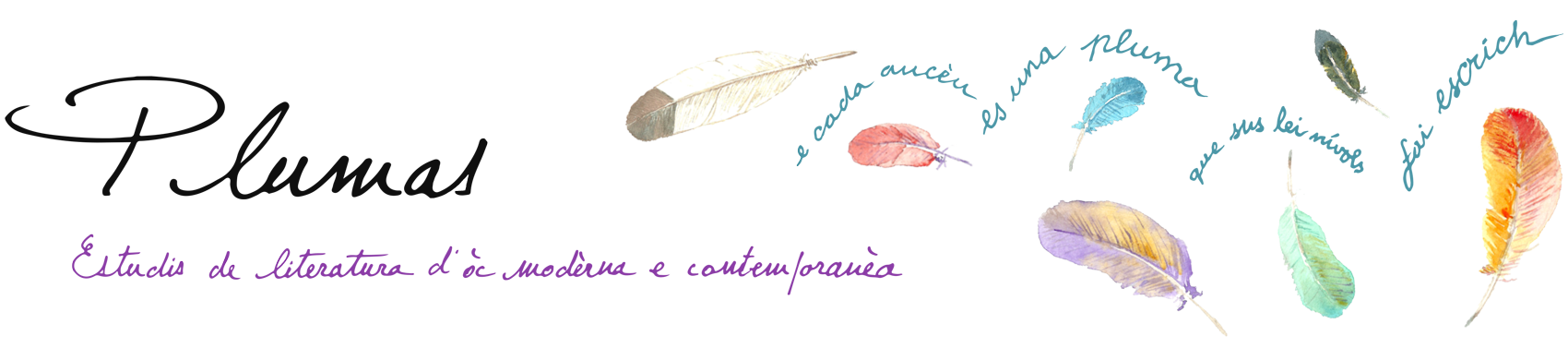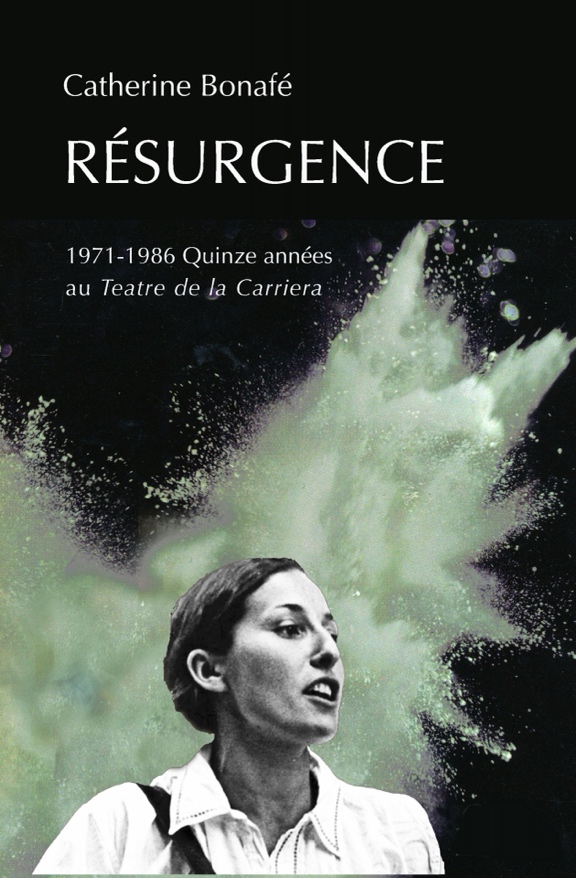Couverture du livre
Le flot des souvenirs que Catherine Bonafé libère sous la forme d’un puissante « résurgence » dans laquelle le lecteur est entraîné, paraît avoir duré bien plus de quinze ans et 180 pages, tant le récit charrie d’histoire collective et individuelle, d’événements, d’émotion et d’énergie créatrice. Catherine est la seule à avoir tenu, de 20 à 35 ans, sur les planches de la Carrièra, du début de l’aventure, liée à Claude Alranq, à la fin, aux côtés de sa sœur Marie-Hélène. La lire c’est la revoir en scène, d’un personnage à un autre, d’un lieu à un autre, partout rayonnante. Son style a sa vivacité débordante et son charme. Sa recherche est à la fois enthousiaste et disciplinée. Les souvenirs, les anecdotes arrivent en foule, avec la passion des jeunes années. Mais ils s’ordonnent selon une périodisation assez classique en quatre actes : « Les prémices », de 71 à 74 ; « Les reconnaissances », de 75 à 78 ; « Les inattendues », de 79 à 83 ; « Les doutes intimes », de 84 à 86. La narration est rythmée par quelques entractes et par les interventions d’une sorte de chœur féminin qui dialogue, commente et introduit de la distanciation dans l’écriture : « Quelle ténacité ! » , « Qu’allez-vous faire maintenant ? »
J’apprécie dans cet ouvrage la démonstration, au fil des ans, dans les circonstances les plus précaires comme dans les périodes de succès, de ce que l’autrice appelle « notre engagement profond et sobre », engagement de saltimbanques intellectuels qui, s’ils acceptent de jouer sur les places des villages, dans les foyers ruraux, les salles des fêtes, ou même les étables, refusent en particulier – toujours avec humeur de la part de Catherine ! – d’être assimilés aux hippies. Et j’admire sa capacité à évoquer les moments d’intense travail partagé et d’échanges, dans la réflexion comme dans l’exécution, dans l’enquête comme dans le jeu. Les exemples sont légion qui éclairent de l’intérieur la succession des pièces que nous revoyons ou relisons. Une photo commentée, une anecdote, un portrait font revivre les lieux et les moments, avec leurs odeurs et leurs lumières, leur charge d’humanité solidaire, des Cévennes minières au Languedoc viticole, de Fos à Avignon, en passant par la Bretagne des luttes (« Guerre du lait » ou « Joint Français »), et par Paris où une fête ministérielle leur fait connaître d’autres théâtres des minorités, au Québec, au Mexique et en France.
La lecture de Résurgence suscite le sentiment permanent et quasiment physique de l’urgence : sans cesse installer et démonter les décors, trouver les scènes, trouver les idées, les soutiens, se déplacer, s’adapter, en permanence, au public qui change, au climat politique, aux arrivées et aux départs.
Et y a des traversées du désert.
La première, à la fin de l’été 72, après Mort et Résurrection de M. Occitania avec le départ des Lyonnais du Théâtre de la Rue. La troupe disloquée se reconstitue au bout d’un an, quand Alranq écrit La guerre du vin et qu’arrivent de Paris Marie-Hélène Bonafé, Charles Robillard et Annette Clément, trois solides piliers.
La seconde est plus douloureuse, c’est le départ de Claude Alranq en 78. Celui de qui « tout part », celui qui a écrit toutes les pièces et porté La Carrièra au Festival d’Avignon, celui que Catherine décrit comme « un meneur, un rassembleur, un visionnaire, un révolté, un écrivain de théâtre », s’en va au moment où la troupe commence à s’institutionnaliser, trop à son goût. Ce départ est un défi majeur. Ce sont les femmes de la troupe qui vont le relever pour donner au théâtre une impulsion nouvelle, pour créer en « cinq années brûlantes », pas moins de huit pièces.
L’autrice montre avec une parfaite honnêteté le mélange d’exaltation et d’inquiétude qui préside à chacune de leurs créations, l’inflexion de ses propres responsabilités et même de son jeu, la collaboration recherchée avec des professionnels du théâtre, comme Jacques Nichet, pour Miroir des jours, en 80, Jean-Claude Perrin pour L’Estrangièr en 81, ou encore Catherine de Seynes pour Miracles ! Miracles ! en 83, et plusieurs autres auxquels va toute sa reconnaissance. Cet engagement des années 80 est une des meilleures leçons de féminisme qui puisse être donné aux nouvelles générations. Avec un légitime orgueil, mais sans triomphalisme.
Le départ de Catherine en 86 procède d’un épuisement physique et moral assumé après des années de fidélité volontariste au projet utopique de la fondation, projet mûri, brillamment réalisé, dans le mouvement des idées et de la société, jusqu’au point inéluctable de décrochage entre désir et réalité.
« C’est exemplaire », écrivait Michel Cournot de Tabò en 1975, dans un article du Monde cité intégralement dans Résurgence. Il ne se trompait jamais.