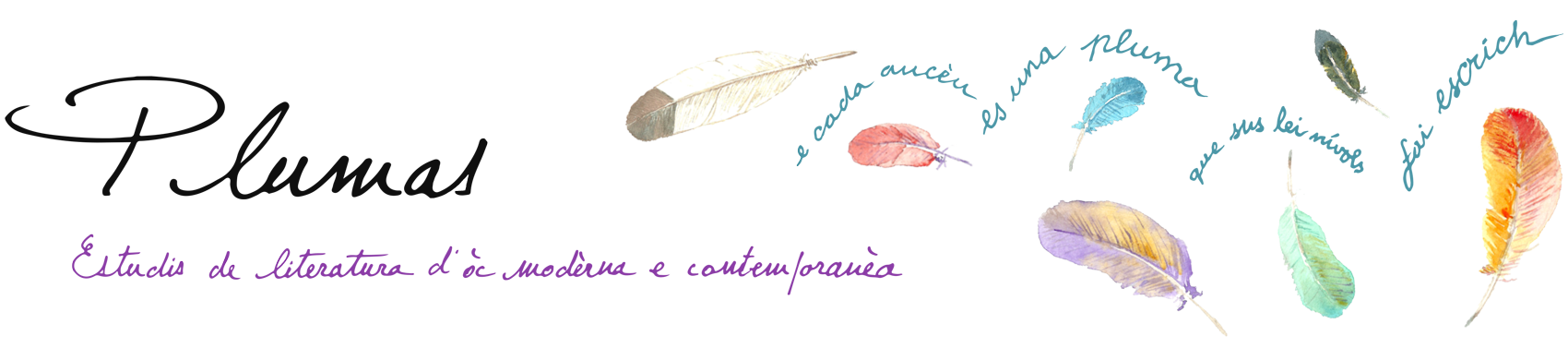L’anecdote du manuscrit trouvé par hasard et qui se met à vivre après des années d’oubli parce qu’il rencontre le lecteur inespéré qui lui donne sens, pour banale qu’elle soit, ne manque pas de faire rêver. Elle ouvre la chasse au trésor, crée une attente de romanesque chez le lecteur qui devient, par mimétisme, une sorte de lecteur-personnage en quête d’un secret caché dans l’écriture. Ce procédé cher à la littérature fantastique, depuis le Manuscrit trouvé à Saragosse, (Potocki 1989) mais largement employé dans d’autres types de romans, constitue un effet de seuil d’une grande efficacité rhétorique. Il permet de franchir la distance entre la convention du monde réel et l’arbitraire du texte qui prétend, à des degrés divers, créer une certaine illusion du réel.
Pour le roman occitan, cette distance a longtemps été un obstacle infranchissable, tant le champ social de la langue paraissait éloigné du champ littéraire. Les historiens de la littérature occitane se sont interrogés sur l’émergence tardive du genre romanesque, sur ses difficultés à se développer, malgré les exhortations renaissantistes renouvelées, au XIXe et au XXe siècles. Philippe Gardy (1996), mettant en relation les lois du genre et les conditions sociolinguistiques de l’écriture1, a montré le poids écrasant non de la langue, mais de ses représentations, sur la prose occitane. Analysant les « pièges de la diglossie », il nous invite à être particulièrement attentifs à toutes les stratégies de contournement que l’écrivain met en œuvre.
L’une d’elle est le récit enchâssé, qui ménage un sas dans le passage à la fiction, comme dans Histoîra de Jean l’an prés de l’abbé Fabre, considéré comme le premier roman occitan (milieu du XVIIIe siècle). Le roman commence par une rencontre le long d’un chemin : le seigneur de la Vaunage interpelle Jean et l’invite à raconter sa vie, et à la fin le remercie de l’avoir fait. Le seigneur parle français et le paysan occitan. « La fiction est présentée comme le simple rapport d’une parole insérée dans la diglossie et contrôlée par elle2 » De façon plus générale (dans la fable ou le récit bref, comme dans le conte) on analysera comme une ruse antidiglossique, plus ou moins réussie, le procédé de la délégation de parole, qui consiste à présenter dans le texte un narrateur sociologiquement vraisemblable pour un discours en occitan. Ainsi la fresque historique des Rouge dóu Miejour de Félix Gras (1896) est-elle insérée dans un récit de veillée à plusieurs épisodes.
Les romans modernes, disons ceux qui sont écrits depuis 1950, et dans une intention délibérée de modernité, pour doter les lettres d’oc d’une prose « déprovincialisée » aux antipodes de la « prose d’almanach », renoncent à singer les conditions de l’oralité traditionnelle. Mais ils ne renoncent pas à la narration insérée ; ils vont même délibérément en exploiter toutes les ressources formelles. C’est alors que l’on va rencontrer, avec une étonnante fréquence et non sans bonheur, le topos du manuscrit trouvé. On s’interrogera sur sa fonction de seuil, dans plusieurs romans contemporains, puis sur la vision double qu’il permet d’avoir sur le manuscrit, objet extérieur pour un premier narrateur, et objet intime pour un second, dans tous les cas lié au travestissement emblématique de l’écriture et sur la difficulté du sujet à y figurer.
Seuils
Il apparaît tout d’abord que ce procédé d’introduction au roman mime les conditions de réception historique de l’écrit occitan : littérature en lambeaux, a-t-on dit, dilapidée au cours des siècles par négligence, incompétence, mépris. Combien d’œuvres qui n’ont pas accédé à l’imprimerie, ou qui, même imprimées, ont été perdues corps et biens, ou sauvées par hasard ? La transmission d’un manuscrit prend dans ces conditions le sens d’un acte de foi. C’est bien le sens des différentes fables inventées par Fabre d’Olivet pour authentifier son roman-troubadour3 : celle du manuscrit arraché aux décombres d’un château détruit sous la Révolution, puis celle de l’envoi d’un mystérieux Rescondut.
C’est encore ainsi que le présente Joseph d’Arbaud dans l’« Avertimen » de La Bestio dóu Vacarés (1926), roman fondateur à bien des égards de la prose occitane moderne. Les circonstances du legs sont infiniment détaillées. Le narrateur, manadier en Camargue, évoque ses relations de travail avec le milieu de la bouvine, et ses liens amicaux avec Long-Tòni, son baile gardian qui lui parle un jour d’un livre escri tout à la man et qui s’est transmis dans sa famille de génération en génération... À sa mort, il en hérite. La description du manuscrit révèle une attention fébrile :
Lou manuscri proumié es un cartabèu espés, doubla de cuer e de pergamin, rousiga sus lou dessu, à rode, pèr lis argno e lou ratun. L’escrituro es jaunasso, de bescaire e, pèr la legi, proun embouiouso. De pajo que i’a, embugado antan o tengudo, belèu, de tèms, à l’umide e atacado dóu mousi, se soun, en li manejant, espóussado coume un cèndre.(10)
Le manuscrit original est un épais registre blindé de cuir et de parchemin, extérieurement taraudé, en plus d’une place, par les mites et les rats. L’écriture en est jaune, informe, presque illisible. Certaines pages autrefois mouillées ou exposées, sans doute, à une trop longue humidité et attaquées par la moisissure, se sont, en le feuilletant, délitées comme une cendre4. (11)
Si le motif darbaudien du cartabèu est repris dans un récent roman de Max Rouquette, La Cèrca de Pendariès (1996), la découverte elle-même se trouve traitée en ellipse, et rejetée en postface. Le manuscrit, un livre de raison du XVIe siècle, se cachait dans la cheminée du mas d’Arnaud de Villeneuve, près de Montpellier dins aqueles traucs de la paret de la cheminièra ont metián la sau per que demorèsse seca (253) [Dans ces trous du mur de la cheminée où l’on mettait le sel pour qu’il reste bien sec]. Le temps est passé sur la capeleta ben clausa, [petite chapelle bien close] où le manuscrit a sommeillé quatre siècles, fins qu’au jour ont de mecanicas coma las auriá pas poscut imaginar an tot destapat e tornat a la lutz dau jorn l’òbra de las vespradas (253) [jusqu’au jour où des machines comme il n’aurait pas pu les imaginer ont tout descellé, livrant à la lumière du jour l’œuvre nocturne]. Il y a plus viol que trouvaille. Ce motif fait écho chez Max Rouquette, en contrepoint, au récit de Vèrd Paradís, « Lo reire qu’aguère en sòmi » (Rouquette 1987), où le narrateur cherche en vain dans un trou du mur du grenier le manuscrit absent d’un grand-père rêvé.
Jean Boudou dont les premiers écrits sont fondés sur la tradition orale rouergate et la mémoire familiale met en scène dans La Santa Estela del Centenari (Bodon 1973) un legs de manuscrit très peu sacralisé. Le narrateur, qui pourrait être Catòia, le personnage narrateur d’un précédent roman, soldat errant dans Rodez hanté par ses souvenirs, rencontre dans une auberge les aliénés de l’asile où fut enfermé Artaud. C’est alors que l’un deux, qu’il reconnaît comme un félibre rencontré autrefois à Avignon, s’approche furtivement pour lui mettre sur les genoux un paquet espés plegat de papièr negre (13) / [un paquet épais enveloppé dans du papier noir] dans lequel il y a trois cahiers, qui seront les trois chapitres du roman. La démarche n’est accompagnée d’aucun commentaire, mais d’une parole qui souligne la signification vitale du geste : Tenètz, tenètz, prenètz lo. Dempuèi que soi aicí lo portavi sus ieu. A dieu siatz.(13) / [Tenez, tenez, prenez-le. Depuis que je suis ici je le portais sur moi. Au revoir.] Le hasard donne naissance au roman, qui s’annonce comme une histoire de fou, en tout cas une histoire dont on connaît la triste fin.
Dans le roman plus récent de Jòrgi Gròs, Ieu, Bancel... (1989) la scène de la trouvaille a lieu dans un endroit hautement symbolique : le placard à double fond qui, dans les mas cévenols, servait à cacher les huguenots au temps des camisards, et le Livre interdit. Dans cette cachette qui l’a fasciné toute son enfance, le narrateur adulte trouve, en retirant du mur une pierre mal jointe, quicòm d’un pauc mofle, coma de cuèr, « une chose un peu souple, comme du cuir », qui n’était pas la Bible, mais una mena de sacòcha de cuèr abenat, estacada d’un correjon (51) / « une sorte de sacoche en cuir élimé, attachée par un cordon» (50), contenant une correspondance en occitan entre César Bancel et son ami L.R5, militaires et humanistes, entre 1864 et 1871. Le roman se construit comme un roman épistolaire à double entrée, puisque le narrateur choisit d’envoyer les lettres, par petits paquets, à mesure qu’il les copie, à son propre correspondant, à qui il livre également les commentaires qu’elles lui inspirent.
Le manuscrit fera entendre des voix d’outre-tombe, échappées à leur cercueil de pierre, d’ignorance ou de répression. Ce subterfuge éditorial réalise, selon Michel Picard (1995), une véritable « manipulation émotionnelle » du lecteur. La parole d’un mort impressionne et dérange. Le roman d’Alain Surre-Garcia, Antonio Vidal (1983), raconte le procès stalinien d’un intellectuel praguois suspect de dissidence, parce qu’il écrit un « dialecte décadent ». Le procès se déroule en l’absence de l’accusé, emprisonné et bientôt assassiné, en l’absence aussi de l’œuvre mutilée et dispersée. L’interprétation de l’œuvre revient au narrateur ambivalent, qui est à la fois admirateur secret et accusateur officiel d’Antonio Vidal. Le pathétique du roman tient à un double mouvement d’enlisement dans le mensonge, et de surgissement de la seule vérité humaine, celle des fragments de textes arrachés à l’autodafé.
Le point commun entre l’auteur du manuscrit et son découvreur-interprète est généralement leur rencontre en un point de l’espace, par-delà tout ce qui les sépare dans le temps ou la société. Et la lecture valorisera cet aspect d’enracinement géographique dans une région donnée, la Camargue, le Languedoc, le Rouergue, saisie à un moment significatif de son histoire et à travers la peinture de milieux emblématiques. C’est ainsi que fonctionne le roman régionaliste quand il fait parler les vieilles pierres. On peut penser au roman français de Jean-Pierre Chabrol, Les Fous de Dieu (1961), qui relate la découverte dans une « clède » cévenole du journal intime d’un jeune homme au temps des camisards : l’humilité du témoignage vécu authentifie la célébration des lieux6 et la reconstitution historique. Dans le roman occitan, il y a, en outre, un besoin de faire passer l’usage de la langue. La distance temporelle, lointaine ou proche, rendent vraisemblable, en un espace fermement repéré, la langue des personnages. Celle-ci joue même comme indice de réalité, comme chez Chabrol l’usage abondant du francitan. Le narrateur premier de la Bèstio dóu Vacarés (D’Arbaud 1926) pousse le scrupule d’authenticité jusqu’à nous expliquer qu’il a dû remanier la langue du manuscrit :
Aquèu tèste, l’ai remounta, tant just coume l’ai pouscu. M’a faugu proun souvènt l’adouba, lou revira quàsi, pèr rèndre clar un mesclun espetaclous de franchimand, de prouvençau e de pauro latinaio. (10)
J’ai rétabli ce texte aussi fidèlement que je l’ai pu. J’ai dû bien souvent l’adapter, presque le traduire, pour rendre intelligible le plus incroyable mélange de français, de provençal et de pauvre latin de sacristie7. (11)
À la fois donc on fait semblant de jouer le pur hasard, et on éprouve la nécessité de produire telle fiction en tel lieu à tel moment. Mais c’est un hasard auquel personne ne croit, simplement un jeu rhétorique, un moment de romanesque pur dont lecteur et auteur connaissent les plaisirs, même s’ils relèvent, comme dit Jòrgi Gròs, d’un marrit biais de fulheton. Ainsi Robert Lafont place-t-il dans La Festa (I, 1983) un récit de découverte de manuscrit qui traite avec jubilation tous les poncifs du genre, sans la froideur du pastiche. Le personnage narrateur de cette section du premier livre, Amielh, vient d’acheter une maison à Mars, en Cévennes, maison bourgeoise qu’il explore et s’approprie dans toute sa beauté. Notamment un petit théâtre envahi de ronces qu’il débroussaille. Et de sous la scène, dont le plancher pourri cède sous ses pas, il finit par extraire une cantine d’officier pleine de livres.
Mai laissatz-me contar lo moment romanesc dins son plen d’esmoguda. Amielh, brut de pòussa de sei mans a sei peus, se clina sus la besonha badiera. Pren lei libres un a un, legís lei títols, ritz, puèi ritz pas tant, decidís de tot recomençar metodicament, coma un furnaire de tomba. Un moment de vergonha : era a traire a la lutz lo secret d’un mòrt ben mòrt. Es qu’aviá lo drech ? (La Festa I, 62).
[Mais laissez-moi raconter le moment romanesque plein d’émotion. Amielh, sale, de la poussière des mains aux cheveux, se penche sur l’ouverture. Il prend les livres un à un, lit les titres, rit, puis il rit moins, décide de tout recommencer méthodiquement, comme un pilleur de tombes. Un moment de honte : il était en train de produire à la lumière le secret d’un mort bel et bien mort. En avait-il le droit ?]
La liste des trouvailles est savoureuse, ainsi que l’ordre de la découverte : des livres libertins, des éditions rares de livres occitans, un mot de Mistral accompagnant l’envoi de Calendau au propriétaire du XIXe, Auguste Pujol, félibre, puis, tout au fond, le plus précieux, dans une bourse de soie, les manuscrits d’un provençaliste distingué du XVIIIe qui avait aussi habité les lieux, Joan, Chevalier de Mars, auteur d’un Dom Quichotte occitanien dont il ne reste que la couverture.
Rien ne manque : le lieu unique et aimé, les écrits qui lui sont liés, à plusieurs étages dans le temps, l’héritage et la révélation, l’implication du découvreur, l’émotion d’au-delà des tombeaux, et le voisinage ironique des lettres d’oc avec les livres érotiques, figure de la langue désirée et refoulée. L’épisode de la découverte du manuscrit n’a pas fonction de seuil dans La Festa : l’ordre narratif ne suit pas la chronologie. Le narrateur second est déjà là, aux côtés du premier, fantôme familier, dès la première page du roman. Il est dans la chambre où Amielh se réveille, en train d’écrire dans l’exacte lumière de l’aube :
Lo Cavalier acaba sa frasa bela d’un trach abondós de tencha. Pausa la pluma blanca sus la taula. Lo vese d’esquina...(66)
[Le Cavalier finit sa belle phrase d’un trait d’encre généreux. Il pose la plume blanche sur la table. Je le vois de dos…]
Une belle scène d’ouverture qui associe à la jouissance de l’instant celle de l’écriture par délégation. L’explication de cette hantise matinale vienda plus tard. On comprendra alors combien le titre même du manuscrit a pu bouleverser Amielh, en lui rappelant des projets de jeunesse et son désir d’éditer Fabre d’Olivet. La situation est banale, traitée en tableau de genre, codée et décodée avec humour, mais c’est de ce lieu commun où le héros tombe par hasard, en jouant les explorateurs, que renaît l’impulsion d’écriture où le roman prend son élan.
Projections
Le moment de délégation de parole est l’instant de vérité du roman, le moment où s’opère pour le sujet de l’écriture, le « choix existentiel » dont parle Kundera dans L’art du roman (1986), réalisé dans la fiction à partir des postulations de l’être8. Si le narrateur premier reste souvent anonyme, le narrateur second fait l’objet d’une identification précise. Des liens manifestes unissent, dans La Santa Estela, le jeune facteur disciple de Fabié et de Mouly et l’écrivain Jean Boudou. De même l’attachement montpelliérain et la profession de Pendariès le rapprochent biographiquement de Max Rouquette. Il en va de même pour Lo darrièr das Lobaterras (Ganhaire 1987) dont Marie-Jeanne Verny fait l’étude dans ce numéro : le narrateur, médecin d’un village du Périgord, hante depuis l’enfance les lieux (forêt, abbaye, tombeau) où est découvert le sac de cuir contenant le manuscrit ancien9. Mais la structure d’emboîtement des récits interdit toute lecture platement autobiographique, et donne du champ à tous les processus de projections imaginaires et d’explorations langagières. Le gardian écrivain du cartabèu est certes, lui aussi, une des incarnations rêvées de Joseph d’Arbaud, parmi celles que lui inspire L’esperit de la terro10, c’est-à-dire la terre de Camargue dans son éternité. Son nom même, Jacques Roubaud, fait écho à celui de l’auteur. On a souvent noté la ressemblance. Mais il porte en lui un tout autre univers. Il est autre. Il est le regard insolite, l’angoisse lentement instillée, l’altérité même, qui loin d’empayser, dépayse. À la figure poétique un peu figée et nostalgique du poète-gardo-bèstio, le roman substitue l’aventure au jour le jour d’une âme simple saisie par l’ambiguïté du monde et laisse deviner, sous les masques, une identification dérivée, troublée et tremblée, qui va bien au-delà des clichés.
Le détour permet, par personne interposée, d’écrire à la première personne. Le sujet prend ses distances avec le genre autobiographique. Il s’autorise toutes les fantaisies romanesques sans s’interdire les délices du je. On entre plus aisément dans cette zone de vérité du moi dont Philippe Lejeune fait remarquer, dans Le Pacte autobiographique, qu’elle est d’autant plus émouvante qu’elle est inavouée11. Ce que le stratagème du manuscrit trouvé ajoute au procédé, c’est un rapport particulier au temps de l’écriture. Le passage de l’écrit fossile à l’écrit vivant, du manuscrit constitué en trouvaille, ou imaginé en bouteille à la mer, au journal en train de s’écrire, dans la précarité, l’incertitude, l’urgence, illustre le prix d’une écriture souvent associée aux moments forts d’une vie. Le gardian ou le médecin s’accrochent de façon vitale, moins à la régularité d’un livre de raison, qu’aux hésitations, remords, redites, d’une confession plusieurs fois abandonnée puis reprise… On voit sous la plume de Pendariès (Rouquette 1996) s’écrire ligne à ligne, secrètement, à la lueur d’une chandelle, ce qu’on avait vu exhumer au grand jour dans les premières pages. On voit l’idée naître du tracé des mots :
L’escriure, per lo qu’es sol, dins la patz, la lutz de la candela sul pergamin, es coma una posaraca qu’arrèsta pas de tirar l’aiga dau pensar e de ne sonar d’autra, de las fonsors ont s’amaga. Ont cada paraula muda ne sona una autra, sovent estranja e que res t’auriá permés d’endevinhar que dormissiá dins l’escur de ton èime.(26)
[L’écriture, pour celui qui est seul, dans la paisible lueur de la chandelle sur le parchemin, c’est comme une noria qui n’arrête pas de tirer l’eau de la pensée et d’en faire venir d’autre des profondeurs où elle se cache. Là où chaque parole muette en appelle une autre, étrange bien souvent, et dont rien ne t’aurait permis de deviner qu’elle dormait dans l’obscurité de ton être].
Écrire contre le temps, contre l’oubli ou la mort, pour témoigner ou se sentir encore en vie : le roman/manuscrit ou le manuscrit dans le roman signifient la nécessité existentielle de raconter, qui va au-delà de la tradition culturelle ou de la convention littéraire. De décoratif, le motif devient poétique. Le narrateur de L’Icòna dins l’iscla (Lafont 1971), survivant à l’apocalypse nucléaire, n’a rien de plus précieux qu’un morceau de crayon avec lequel il noircit des feuillets que la tempête éparpille. Il écrit pour ne pas sombrer, jusqu’à la fin : en chimarrant lo papirús, lo pergamin, lo papier (7) / « en couvrant de signes le papyrus, le parchemin, le papier12 ». S’il a l’idée de la bouteille à la mer, ce n’est pas sans sarcasme qu’il l’évoque, tant la mer autour de lui charrie de pourriture. Le motif sera repris par Robert Lafont dans une autre fable de l’île, Amficòlpòs (Lafont 1996) : l’écriture est aussi indispensable à la survie de Robinson que le grain de blé qui germe ou l’eau douce de la citerne.
C’est au milieu de la Lande pluvieuse, seul face au miroir où il voit sa mort, que le narrateur du Gojat de Noveme de Bernard Manciet (1964) écrit jusqu’à son dernier souffle. Aucun legs de manuscrit n’est envisagé, ni envisageable : la vie intime est dans ce monde clos le seul bien qui échappe à l’héritage. L’écrit prolonge la vie et la révèle ; on sent la main sur le papier et le souffle sur la bougie. À peine est-il fait mention, au début de La Pluja, le second livre de la trilogie (Manciet 1976), de la découverte de papèrs escriuts dans la chambre de Bernat. On n’écrit que pour soi, ou pour les morts, dans la solitude absolue et en fàcia de la nueit, comme dit Denisa, narratrice du Camin de terra (Manciet 1976) : escriver, end’esvitar de se méter au cunh de la pòrta, lo cap dens lo braç, a la mòda deus còches (153) / [écrire, pour éviter de se mettre au coin de la porte, la tête dans les bras, comme font les enfants].
Dans d’autres perspectives, le récit d’une vie confié à un manuscrit secret peut afficher un simple – mais ce n’est jamais simple ! – désir de témoignage. Le narrateur se trouve en possession de secrets historiques, a vécu une expérience incroyable mais vraie, connu des aventures extraordinaires, et veut en informer l’humanité. Dans le récit organisé a posteriori d’une vie bien remplie, ce n’est pas la palpitation de l’écriture qu’on saisira, mais sa capacité à « transformer la vie en destin » comme dit Sartre, citant Malraux. Dans la Quimèra (Bodon 1974), le narrateur est esclave en Algérie, au XVIIIe. Paria, exilé, il écrit dans sa langue que personne ne comprend une histoire que probablement personne ne lira. Ce Rouergat a participé au début du siècle à la tentative de soulèvement du Rouergue et raconte de son point de vue, qui n’est pas celui de Voltaire ni des historiens français, cet épisode malheureux et méconnu de l’histoire occitane. Le choix de la langue et la perspective partisane réduisent gravement l’espérance de vie du manuscrit, qui représente ici l’œuvre tout entière. Boudou désenchanté désigne son projet comme chimérique, doute, comme toujours, de toucher un public : « Qual me legirà ? / Qui me lira ? ». Mais ce dernier roman est le plus épais et le plus « romanesque » de tous ceux qu’il a écrit. La fiction du manuscrit confié aux hasards des flots sert de préambule lucide à une entreprise consciente de compensation sociolinguistique, sur le thème de la chimère construite et déconstruite.
Même valeur exemplaire, l’ironie en plus, dans le récit d’allure picaresque et de ton voltairien, La Reborsiera (Lafont 1991). Le personnage narrateur ici n’a que peu d’affinités avec l’auteur. C’est un baroudeur provençal du parti de la Ligue. Après avoir sillonné la Provence ravagée par la peste et les guerres religieuses, participé à la république marseillaise de Cazaulx, découvert l’Espagne de Philippe II, exploré le Nouveau Monde et fondé une colonie en Amazonie, se retrouvant au bout du monde, sans interprète ni confesseur et dans le secret espoir que son histoire reviendra un jour en Provence, il décide de :
consignar per escritura sus bèu pergamin de pèu de garri lo compendi o epitòme dei aventuras pus marcantas d’una existéncia…(122)
[consigner par écrit sur un beau parchemin de peau de rat le compendium ou l’épitomé des aventures les plus marquantes d’une existence…]
L’écriture est la trace du rêve, l’ultime compensation du roi dépossédé. Du brouillon de la vie plus ou moins ratée, le manuscrit laisse une trace pleine et signifiante : tout s’organise providentiellement autour d’une utopie de refondation provençale dans le pays d’en delà dau ceu [d’au-delà du ciel].
Dans tous les cas, que le manuscrit se veuille intimiste ou exemplaire, par définition il n’est pas publié. Il se présente comme écrit unique, sollicité par les circonstances. Son auteur n’est pas un professionnel de l’écriture, mais un novice, un écrivant occasionnel. Il n’a pas de visée esthétique, au contraire il multiplie les mises en garde contre les maladresses de la forme. « La libraio, fau que se sache, n’a pres eici ges de part / La littérature, qu’on le sache, n’a ici aucune part(13) » dit le narrateur de la Bèstio dou Vacarés. Le motif est connu dans la littérature occitane : cela ne va pas de soi d’avouer un projet éditorial ou une ambition littéraire. Traditionnellement, l’écrit a quelque chose de clandestin, d’intime, de marginal, et la publication est supposée tout devoir au hasard, comme le disent de nombreuses préfaces contrites. L’image de la bouteille à la mer exprime bien ces difficultés liées au statut de la langue. Elle les dramatise même, et loin d’entériner le topos de la littérature passe-temps, témoigne de son caractère intempestif. Le manuscrit n’est pas qu’un objet pittoresque, il a quelque chose à dire, mais il le dit par des moyens détournés.
Sous forme de fable, ou de conte inséré, dans plusieurs romans, il apparaît lié à l’absence de communication et à la perte de liberté. C’est, au début de La Quimèra, l’histoire du prince enlevé par des brigands et retenu prisonnier dans une grotte, qui se délivre en tissant son histoire sur un tapis. C’est le prince en exil qui noue aux fils de l’écheveau de la langue les mondes et les êtres dont il reprend ainsi possession, image du romancier Idoménée à la fin du second livre de La Festa. Dans Antonio Vidal, il n’y a aucun espoir : le prisonnier qui suspend ses derniers moments à un bout de crayon, et des lambeaux de papier perd le crayon et les feuillets écrits finissent dans les latrines. Cette issue dérisoirement scatologique hante l’écrit occitan depuis des siècles : combien de développements burlesques sur ce thème disent le sentiment d’inutilité, la peur, la frustration.
Mises en abyme
Le manuscrit légué ou trouvé ouvre un espace fictif qui représente le territoire de la langue. Rapporté à la géographie mentale du narrateur, ce territoire n’est pas nécessairement limité à ce que Robert Lafont a appelé Li Camins de la saba (1965), c’est-à-dire les reconstructions affectives et sensorielles de l’enfance, la voie proustienne en somme, qui reste d’une infinie fécondité. Des explorations plus intellectuelles sont tentées, géométries narratives ludiques, quasiment expérimentales, en tout cas très consciemment programmées.
Le roman de Jean-Claude Forêt La Pèira d’asard (1990) est à cet égard très significatif. Il est construit en prisme, par la juxtaposition de trois manuscrits que le hasard a rassemblés dans les mains du premier narrateur. Les topiques liminaires sont très explicitement empruntés au roman fantastique. Un journaliste se trouve dépositaire d’un texte en languedocien quand son auteur, Abel, est victime d’un accident de montagne. Il reçoit ensuite d’une jeune infirmière, Christine, rencontrée en Ethiopie, la veille de sa mort, une liasse de lettres en « dialecte ardéchois ». Puis il découvre dans le Fonds Vivarois de la bibliothèque d’Aubenas un parchemin du Moyen Âge, attribué à un certain Moine de Mazan. Or les trois textes, représentant trois stades de la langue et trois approches différentes de celle-ci, ont le même sujet, en abyme : le déchiffrement (fatal à tous ceux qui directement ou indirectement s’y sont laissé prendre) d’une pierre gravée en caractères étrusques et en langue basque. Le principe de coïncidence accepté, le lecteur accepte de mettre en relation les trois récits et de faire fonctionner ce curieux triptyque :
qu’aquò’s ben un roman que forman aqueles tres racontes que cadun d’els se poiriá ça que la legir sens los autres, embarrat dins sa lenga. (23)
Car c’est bien un roman que forment ces trois récits, dont chacun par ailleurs pourrait se lire sans les autres, enfermé dans sa langue. (22)
Roman de la langue si l’on veut, puisque la langue en est l’inspiratrice, mais sous une forme éclatée, kaléïdoscopique, modulée à l’infini des voix, des parlers, des accents qui se font écho dans une construction véritablement polyphonique.
Dans La Festa, l’effet de brouillage est créé dès le début par le croisement d’instances narratives instables. Comme dans La Mise à mort d’Aragon (1965), le miroir est la figure centrale de la construction romanesque. Mais avec cette différence qu’il multiplie le moi à l’infini, au lieu de l’absorber. Le manuscrit du Dom Quichotte occitanien est un des miroirs où convergent certains reflets de vie : il n’est qu’une forme du désir d’écrire, narcissique et chimérique, comme son nom l’indique. Une forme inspirante, puisqu’Amielh ne peut résister au plaisir du pastiche. Mais une forme vide. C’est une absence de livre qui est enfouie sous le théâtre. La cachette est illusoire aussi parce qu’elle annonce l’échec :
De ma tentative vaine à celle de Pujol et de celle de Pujol au Don Quichotte de 1776, me voici pris dans une cascade d’encre, qui est aussi une cascade de fiascos. Car ce Dom Quichotte occitanien n’a jamais été plus loin qu’un titre, semble-t-il. (Lafont I, 95)
La Festa joue de la séduction des mises en perspectives d’un monde foisonnant, pour en débusquer les failles et les points de fuite. Il en va ainsi des manuscrits auxquels les deux personnages narrateurs attachent les fils de leur vie, puis qu’ils sacrifient, sans les détruire toutefois, à leur théâtre intérieur. On voit Amielh expédier le manuscrit de son roman algérien, Djemila, au « néant perpétuel ». La bouteille à la mer prend ici la forme d’un paquet ficelé envoyé poste restante à Vienne à un faux nom et une fausse adresse. Joan fait don de son manuscrit, un texte autobiographique de deux mille pages, à une journaliste célèbre, sans se soucier de ce qu’il en adviendra. Le détachement volontaire est dans les deux cas un acte libératoire et secrètement héroïque, une fuite du narcissisme figé, un beau geste un peu adolescent de mutilation qui ne laisse pas de surprendre :
Mais le personnage fait, des années plus tard, l’expérience inverse. Dans le troisième livre de La Festa, Finisegle (Lafont 1996), Amielh travaille chez un grand éditeur parisien. Il est découvreur professionnel de manuscrits, intégré au monde des lettres et de l’édition internationales. Loin des mondanités, il se réserve un lieu secret d’écriture, une maison louée à cet unique usage, son île déserte. Les milliers de pages du manuscrit s’accumulent dans un coffret. C’est pour le coffret qu’il écrit, sans plan ni programme, la nuit, retrouvant sa vie dans sa langue d’enfance, protégé par elle, puisque personne autour de lui ne la parle ni ne la comprend. La langue lui sert de clé et de serrure. Écrire une œuvre intransmissible lui procure l’illusion de liberté souveraine. Mais on lui vole son manuscrit et c’est la vie qui lui échappe :
M’an raubat la vida. Escanar lo dire a quauqu’un que viu lo dire en mai de dire lo viure, es lo trencar a mitat. (211)
[Ils ont volé ma vie. Étrangler le dire à quelqu’un qui vit le dire en plus de dire le vivre, c’est le couper en deux].
Le voici qui se lance à la recherche des fantômes de l’enfance, où il se dissout littéralement, happé par le vide, avalé par le masque. Mais en même temps c’est le journal d’Amielh qu’on lit puisque dans Finisegle, comme dans le beau roman d’Antonio Muñoz-Molina Beatus ille (1986), par un effet troublant de trompe l’œil, le texte qu’on lit est celui du manuscrit perdu dont tout le roman raconte la quête.
Le roman occitan contemporain porte souvent la marque de la réflexivité, ce qui est un indice de modernité, dit Jean Arrouye (1987) à propos de l’œuvre de Boudou13. Il s’interroge en effet abondamment sur les conditions de son propre avènement. Philippe Gardy (1989) souligne le risque, inscrit dans les angoisses du sujet diglossique, de voir le roman dans la langue tourner au roman de la langue14. Risque de ratage par excès de motivation militante, mais aussi bien risque créateur quand la tension d’écriture est assez forte pour signifier par elle-même, au-delà des discours sur la langue. L’absence au monde se résout en « rhétorique de l’explicitation » chez Lafont, en figures de la circularité et du secret chez Manciet ou Rouquette, en parcours initiatiques d’espace chez Boudou. Le manuscrit a, dans les œuvres – on l’a vu – une fonction anecdotique : accessoire romanesque répertorié, il permet au roman d’exister dans la langue. Il prend aussi une fonction symbolique : lieu et support de l’écriture, il est le laboratoire du sujet qui se construit par la langue, sauvé ou perdu, mais lucide. Avec parfois le vague espoir inavoué que l’écrit accidentel survive à l’accident, et à son auteur même… Que ce gribouillage informe, cette procession de fourmis15, comme dit Max Rouquette, s’il ne tombe pas en poussière, devienne un monument de la langue, le dernier peut-être, ou le premier d’une nouvelle fondation… Mais alors c’est l’affaire du temps, de la prédestination, ou du hasard, comment savoir ? Écrire quand même.