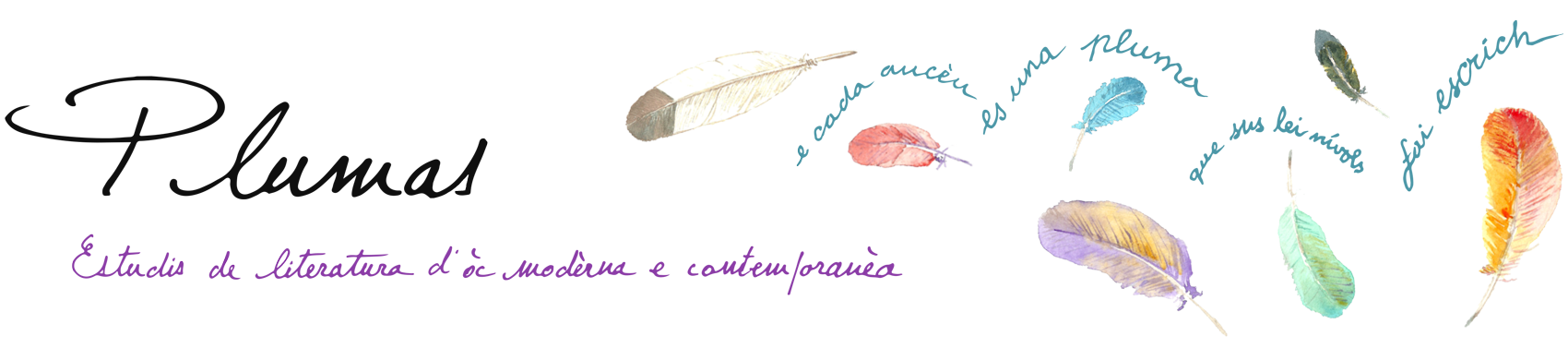Nous voilà au seuil du centenaire de la naissance de Bernard Lesfargues (1924-2018)1 ; cinq ans déjà qu’il nous a quittés. Un laps de temps peut-être suffisant, au-delà du deuil propice à de beaux hommages – l’article nécrologique du compagnon d’armes Jean-Francis Billion (Presse fédéraliste, Billion 2018), celui de son ancien élève lyonnais Jean-Philippe Catinchi dans Le Monde, du 18 février 2018 (Catinchi 2018), le dossier du numéro d’Oc de mars 2018 (Oc 2018), celui d’Europe de septembre-octobre 2019 (Europe 2019)2 –, pour tenter de dresser un début d’inventaire de ‘sa vie-son œuvre’3 qui voudrait, tout en respect, s’affranchir d’une approche hagiographique.4
Avant même de présenter ce numéro de Plumas qui lui est consacré, on abordera sous forme de questionnement quelques points que son contenu laisse en suspens. En premier lieu, la question des modalités de sa double culture de départ, et de savoir si Lesfargues doit être considéré comme un poète en français et/ou en occitan ; celle de son cheminement vers deux autres langues-cultures, l’espagnole et la catalane, et celle de l’évolution de son activité éditoriale. Enfin, la question de notre propre positionnement en tant que contributeurs et coordonnateur de ce dossier face à notre sujet/objet d’étude.
Ce n’est qu’ensuite, donc, qu’est abordé le contenu des travaux réunis ici, sous le quadruple éclairage de l’itinéraire de Bernard Lesfargues, de sa création poétique, de son œuvre de traducteur et de son activité éditoriale – puisqu’il était tout cela à la fois, en un tout indissociablement concaténé. En somme, nous proposons au lecteur, qu’on espère bienveillant, de baliser et pourquoi pas d’éclairer, un chemin de vie toujours autoréflexif, toujours inscrit dans le passage, ouvert et exigeant, toujours militant, malgré les doutes5.
Bernard Lesfargues, archives familiales
Quelques questionnements
Autour de la ‘quadriculture’ de Lesfargues
Fallait-il bien connaître Bernard Lesfargues, sa vie son œuvre, pour se lancer dans l’aventure de la coordination de ce numéro de Plumas ? Le lecteur sera seul juge du résultat. Il pourrait tout de même y avoir quelque avantage à une certaine distance : l’approche bio-bibliographique élaborée par François Pic et Vít Pokorný est, en toute logique, davantage factuelle qu’explicative. Et l’ensemble des articles réunis ici ne manque pas de laisser un certain nombre de zones d’ombre qu’il convient tout de même de pointer au nom de la rigueur et, précisément, de la position d’outsider.
Derrière la question non véritablement résolue, quoique abordée, de savoir si Lesfargues est poète en français, en occitan ou bilingue, se profile la nécessité de mettre en perspective ses années de formation et d’entrée en littérature. Abel-Bernard, ou Bernard-Abel, et finalement Bernard Lesfargues n’échappe pas à la constante repérée par Jean-Claude Forêt : « Tout auteur occitan, qu’il le veuille ou non, écrit dans l’ombre du français » (Forêt 2015). Il va de soi que, formé aux humanités classiques, d’abord dans un enseignement catholique censé mener à la prêtrise, puis dans la filière d’excellence des classes préparatoires – auxquelles il restera fidèle au long de son parcours d’enseignant –, Lesfargues a bénéficié de la meilleure initiation qui soit aux lettres françaises, et par la suite d’un réseau porteur d’opportunités à Paris. Il n’est donc pas aberrant que, d’une part, il ait écrit ses premiers poèmes dans l’idiome d’État, et d’autre part, qu’il ait intégré très tôt, grâce à son talent et sa capacité éprouvée de travail, l’univers clos des meilleures maisons d’éditions parisiennes. Lecteur chez Plon (et facilitateur, à l’occasion, de l’édition du Mistral ou l’Illusion de Lafont, en 1954 – Lafont 1954), puis chez Gallimard, où le contact de l’exilé antifranquiste Juan Goytisolo fera de lui un traducteur maison de l’espagnol puis du catalan, il occupe sans conteste au sein des acteurs de la littérature occitane d’après-guerre – en premier lieu, ses comparses Robert Lafont et Bernard Manciet, personnalités particulièrement fortes et complexes – une place originale.
Car c’est précisément de tels réseaux parisiens et de telles fonctions, qui le mettent en présence, d’une part, des modes et des goûts littéraires les plus novateurs de l’époque, et d’autre part, des littératures étrangères « Du monde entier » – comme le signe la collection éponyme de Gallimard –, qui forgent, pour partie sans doute, son écriture. Il sera ainsi, dans les années 1960 puis 1970, un des transmetteurs d’avant-garde en langue française du roman espagnol et catalan de « la post-guerre », de même que de ceux du « boom » latino-américain6. En cela également, il est privilégié et atypique parmi les pourvoyeurs-éditeurs de la collection Messatges7 de l’IEO, et il participe a fortiori de leur rupture avec les canons de la littérature félibréenne.
À l’instar de son passage du patois familial à la langue occitane héritée de son terroir périgourdin d’origine, on pourrait donc hasarder, sans commettre d’impair iconoclaste, que Bernard Lesfargues est devenu poète occitan après l’avoir été en français, et qu’il n’a dès lors eu de cesse que d’aller et venir de l’une de ses deux langues maternelles (celle de la rue Vidal, à Bergerac, et d’Église-Neuve d’Issac) à l’autre (celle des livres du petit séminaire, de l’hypokhâgne bordelaise, puis de la khâgne parisienne). Sans doute lui a-t-il fallu donner des gages à la position de rupture monolinguiste de l’état-major de l’IEO (jusqu’où, à l’image, par exemple, de René Nelli, y a-t-il vraiment adhéré ?) vis-à-vis des éditions bilingues en regard, dont Mirèio incarnait le modèle, et qu’il perpétuera lui-même, entre autres avec La brasa e lo fuòc brandal / La braise et les flammes (Lesfargues 2001). On constate en effet qu’il a mis lui-même en pratique à sa manière ce procédé, et ressorti tardivement de ses tiroirs, une fois le raidissement idéologique passé, une collection assez consistante de textes écrits en français, qu’accueillirent le volume Odes et autres poèmes (Lesfargues 2014) et les différentes plaquettes bergeracoises éditées par les Amis de la Poésie.
Comme le rapporte ici Marie-Claire Zimmermann, pour Lesfargues, « la question est résolue depuis fort longtemps », à savoir par une décision à double détente qu’il avait lui-même exprimée. D’abord, point d’exclusive : « je n’ai jamais cessé de dire que le français est une très belle langue » ; ensuite, assumer le devoir de sauvegarde pour la plus menacée : « Mais le français se portait bien. Il n’avait pas besoin de moi ni de mes poèmes pour le défendre et l’illustrer ». Peut-être pourrait-on, du reste, se hasarder à appliquer le même schéma au Bernard Lesfargues traducteur.
L’espagnol (le castillan) représente la première langue étrangère étudiée, quasiment obligatoire au long de la scolarité de Lesfargues comme, des décennies durant, dans toute académie du Sud-Ouest de la France. Il s’est ainsi imposé à lui, à la suite de quoi il en a fait, brillamment (agrégation et diplôme – dirigé par Jacques Soustelle – sur le conquistador Núñez Cabeza de Vaca, 1954), son gagne-pain d’enseignant, puis de traducteur – chapitre qu’il ouvre magistralement en 1953 avec Pedrito de Andía, de Rafael Sánchez Mazas, et qui ne comptera pas moins de 23 titres au total. Le catalan, quoiqu’à parts finalement égales, c’est une autre affaire : celle d’une révélation – dans les années 1940-41, comme il en a fait mention. Le catalan, à l’époque considéré, côté occitan, comme l’un de ses dialectes, est à tout le moins, aux yeux des occitanistes, dont Lesfargues, la langue-sœur qui, à la différence de l’oc, depuis la fin du XIXe siècle, a fini par se déprendre de l’emprise d’une domination que l’on qualifiera quelque temps plus tard de diglossique. Langue minorée, certes, mais littérature redevenue majeure : telle devrait être la voie tracée pour l’occitan, ravalé par ses propres locuteurs (et la complicité, parfois, de certains militants eux-mêmes) au rang de patois.
L’affaire débute, en fanfare mais non sans moult toussotements, une décennie après ses remarquables débuts à partir de l’espagnol, avec la traduction de l’ovni littéraire Incerta glòria de Joan Sales (1962). À compter des années 1980, on observe que, sans abandonner pour autant la traduction de l’espagnol (un chapelet de 10 titres encore), celle du catalan tend à prédominer (avec 19 titres sur un total global de 23), sans doute parce que le marché offre davantage d’exclusivité, mais là aussi sans doute, parce que celui de l’espagnol « se port[e] bien », et que celui du catalan est à promouvoir. L’aventure s’achève en 2011 avec la fin du cycle Rodoreda et surtout le renoncement à prendre en mains le Jo confesso, sa possible quatrième – et trop consistante au regard de son état de santé – traduction de Jaume Cabré, que réalisera en Confiteor, avec le succès que l’on sait, Edmond Raillard8.
Ajoutons à ces évolutions celle concernant le cadre éditorial. Les publications de poèmes et de recueils poétiques, quelle que soit la langue, se réalisent dans des revues, chez des petits éditeurs voire dans sa propre maison, Fédérop, à une échelle relativement confidentielle qu’il ne manquait pas de regretter. Les traductions, d’abord prises en charge chez Plon et surtout Gallimard, prennent en effet par la suite le chemin de maisons plus modestes quoique toujours de qualité (Jacqueline Chambon, Christian Bourgois, La Différence, Verdier, Autrement), parfois plus obscures, et ici aussi, ‘à domicile’ – sans doute en raison aussi bien d’un lectorat plus étroit que d’un parcours éditorial ainsi rendu moins tracassier. L’important, pour Bernard Lesfargues, est de continuer à témoigner, à faire reconnaître la valeur aussi bien de la création occitane que des lettres catalanes et bien au-delà. Il n’y aura pas manqué, presque jusqu’à son dernier souffle…
Réaliser un monographique d’hommage : la quadrature du cercle ?
Venons-en à présent à ce dossier, entre les mains du lecteur, en nous plaçant du point de vue du coordonnateur. On admettra volontiers que ce numéro de Plumas n’offre pas toutes les garanties de l’impartialité – sans doute n’est-ce là qu’un mythe – que l’exercice rendrait a priori désirable ; qui dirait (et surtout, écrirait) du mal de ses amis ?... Quand bien même aucun contributeur ne partage sa génération, pionnière dans la fondation avec l’Institut d’Études Occitanes (IEO) d’un occitanisme de gauche issu de la Libération et aux manettes de la collection Messatges, nous retrouvons ici, parmi les contributeurs, une partie de la jadis jeune équipe des Éditions Jorn à laquelle il prêtait son concours, en tant que co-fondateur, et à qui il dispensait sans surplomb des conseils littéraires avisés. Philippe Gardy, Jean-Yves Casanova, Jean-Claude Forêt et Marie-Jeanne Verny sont de ceux-là. Il y a bien aussi, au titre des relations transpyrénéennes, l’amie hispaniste et catalaniste Marie-Claire Zimmermann et, à celui du compagnonnage fédéraliste lyonnais, Jean-Francis Billion (Billion 2008).
Il y a également son fils aîné, Bruno Lesfargues, gestionnaire de sa mémoire et de ses archives, et son jeune exégète tchèque Vít Pokorný, auxquels ce monographique doit beaucoup ; Bernadette Paringaux, ‘héritière’ avec son époux Jean-Paul Blot, de la maison d’éditions Fédérop, fondée par Bernard. Mais viennent néanmoins s’y agglomérer, pour moitié et à distance affective démontrable, des universitaires occitans (Sylvan Chabaud et Christian Lagarde), catalans (Dolors Poch et Jordi Julià) ou nord-catalans (Miquela Vaills), et de jeunes chercheurs, les catalanes Marta Pasqual et Andrea Pereira Rueda, et le tchèque Vít Pokorný. On voudra donc nous accorder que, deux générations et des univers culturels différents, représentent déjà le gage d’une possible et souhaitable objectivation de l’analyse.
La question se pose en effet de la distance critique et de l’entre-soi (Apalategui 2000). Si le monde des Pays Catalans, fort de sa tradition littéraire, de politiques linguistiques – qui soutiennent, à des degrés divers, aussi bien les apprentissages que l’édition et la lecture –, de la taille de la place éditoriale barcelonaise, peine tout de même à affirmer son autonomie, que dire de celui des lettres occitanes, confiné, pour une part, dans l’exiguïté (Paré 1992 ; Paré & Carré 2021), le militantisme (voire, parfois, l’amateurisme) et pour l’autre, dans la dépendance à l’unilinguisme et au monopole parisien ? L’identité, l’environnement proche, sont des moteurs féconds ; l’exiguïté est susceptible de tuer, ou du moins conditionner l’esprit critique, cet aiguillon qui conduit à progresser, à tenter de se hisser du local vers l’universel. Elle n’empêche cependant pas, fort heureusement, de voir éclore ici ou là les bons auteurs, prix Nobel compris. Par ailleurs, la nécessité du bi- ou du plurilinguisme, de la bi- ou de la pluriculture, se révèlent au bout du compte, par la nécessité de se confronter à des ailleurs, des bienfaits salutaires, dont les traducteurs sont la parfaite incarnation.
Au filtre d’un double positionnement : témoigner et faire devoir de mémoire – « De segur, pòdi pas qu’acceptar ta proposicion. Aquò me donarà l’escasença de tornar legir l’òbra de nòstre vièlh amic » –, d’une part ; rendre compatible la critique et la fidélité à l’amitié de l’autre – « Siáu pas tròp content que m’avisi qu’es dificil d’escriure un article sus un amic, per mai d’una rason »9–, nul doute que l’intérêt de cette proximité d’engagement, d’échange et d’affectivité demeure. Car elle permet précisément, par le biais du partage, une interprétation au plus profond du texte et de sa sensibilité. Soumis à des cheminements et des questionnements plus ou moins semblables, analystes et créateurs – parfois les deux en un seul – se trouvent en effet d’autant mieux en situation de décoder les contraintes de l’écriture et la valeur de ses réalisations.
La deuxième ligne de crête me semble être la question de la nature polygraphique de l’œuvre de Bernard Lesfargues et des différents rôles qu’il a tenté de rendre compatibles dans son existence. Rien d’original à cela, sans doute : c’est le lot de tous les militants/activistes, dès lors qu’ils œuvrent en faveur d’un collectif minoritaire ou minoré. Or être polygraphe (« polyédrique », dit-on au Sud des Pyrénées) est a priori suspect chez les dominants : pour eux, on ne serait ‘performant’, crédible, qu’en tant que spécialiste. S’aventurer hors d’un périmètre balisé exposerait à l’imperfection, voire à l’amateurisme. Soit, mais c’est là sans compter que le militantisme ne dispose pas des infrastructures, de la logistique, des compétences et des bras qui seraient nécessaires pour que chacun demeure à sa place – pourquoi pas, dans son pré carré. Sans compter qu’il convient, pour parvenir à ses fins, de se mettre en danger, de s’improviser dans un rôle et de s’efforcer de parvenir à le maîtriser. Chez Bernard Lesfargues, sous la bannière de Fédérop, les rôles de libraire (en tant que « Maspero lyonnais ») puis d’éditeur, relèvent d’une telle démarche, qui n’est en rien étrangère à l’esprit de mai 68.
***
Notre dossier s’ouvre sur la présentation bio-bibliographique élaborée conjointement par François Pic et Vít Pokorný. C’est un exercice de synthèse périlleux et, disons-le, réussi, qui introduira valablement le lecteur néophyte et rappellera certains points moins connus aux initiés. Si ce numéro monographique a délibérément choisi de ne pas aborder l’engagement politique fédéraliste européen de Bernard Lesfargues et celui de l’enseignant d’occitan ‘extraterritorial’ à Lyon, il n’en devait pas moins prendre en charge les trois autres aspects majeurs de la vie et de l’œuvre de notre protagoniste : l’auteur, le traducteur et l’éditeur.
Les deux contributions dont nous sommes redevables à Vít Pokorný mettent en regard et contrastent, d’une part, le discours maîtrisé de l’occitaniste propagandiste, recueilli à la faveur d’un entretien réalisé en 2012 auprès de Bernard Lesfargues accompagné de son épouse Michèle, dans la retraite tutélaire d’Église-Neuve-d’Issac : « C’est toujours une question : l’occitan va-t-il finalement l’emporter dans son pays naturel ? », avec, d’autre part, une analyse bienveillante mais distanciée : « Bernard Lesfargues et “sonˮ occitan : portrait d’une militance culturelle, politique et linguistique », où l’activisme dans la sphère privée se révèle en décalage avec la parole et l’action publiques. En cela, faut-il le dire, Lesfargues se révèle représentatif de ce que furent les félibres, auxquels on en fit vivement procès, et de la plupart des occitanistes ‘historiques’ de la seconde moitié du XXe siècle.
Vient ensuite un ensemble tripartite proposé par Jean-Francis Billion, regroupant des extraits inédits du Journal tenu par le jeune Lesfargues de 1943 à 1953, et « deux textes plus récents revenant sur le rapport de Bernard avec la traduction » : un extrait d’interview de 2009 et le discours d’inauguration de la salle portant son nom à la Biblioteca d’humanitats de l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) en 2015. L’occasion pour le lecteur de découvrir, par petites touches émanant d’un connaisseur fin et intime,10 un long cheminement, des tâtonnements idéologiques, de l’Occupation à la consécration barcelonaise, en passant par les premiers pas en tant que traducteur. Le tout placé sous le signe de la quête de soi et d’une modestie sincère.
Nous revenons à l’époque de rédaction du Journal, avec l’article « Bernard Lesfargues – Robert Lafont : regards sur une correspondance » élaboré par Marie-Jeanne Verny, qui explore avec minutie la correspondance – conservée au CIRDOC et comprenant 203 lettres rédigées entre 1946 et 1980 – adressée à Robert Lafont par Bernard Lesfargues. Ces échanges épistolaires éclairent tout à la fois les conditions de co-réalisation de l’anthologie « La jeune Poésie occitane » éditée à Paris par la revue Le Triton bleu (1946), et l’attelage dissemblable ainsi formé, aux bénéfices partagés et surtout uni par la détermination, dans l’immédiat après-guerre, à impulser un ambitieux renouveau de la culture occitane. Ainsi se clôt, encore que très provisoirement on l’imagine sans peine, cette approche biographique de Bernard Lesfargues, pour en venir à l’écrivain-traducteur.
Une « poétique du traduire »
Un poète, traducteur du monde, entre deux langues
Et si, tout bien considéré, la polygraphie lesfarguésienne dont nous faisions état, n’était qu’une variation perçue comme telle, de manière trompeusement superficielle ? Et si, pour la résoudre, il suffisait de suivre les indices que nous livre ici même avec perspicacité Philippe Gardy ? Car si, selon lui, « L’acte poétique, comme celui de traduire littérairement, revient à transformer un texte en un autre texte, donc à faire apparaître ce qui n’était pas auparavant », alors, être poète, traducteur d’autrui et de soi-même ne font qu’un. Qui plus est, éditer, c’est bien faire paraître – et donc « apparaître » – « ce qui n’était pas [public, dans ce cas] auparavant »… S’il va de soi que le langage poétique est interprétation du réel perçu par le commun des hommes, il en est de même, à l’évidence, de la traduction. Et il n’en va guère différemment, au fond, du travail éditorial, dans la mesure où celui-ci transforme un texte (manuscrit ou tapuscrit) d’ordre privé ou semi-privé, en un texte ouvert à des lectorats multiformes et multidimensionnels : c’est alors son statut qui s’en trouve modifié. Si bien que l’on pourrait en conclure, non sans fondement, que Lesfargues s’est continuellement appliqué, tout au long de sa vie, à jouer de ces trois registres11 qui ne font qu’un instrument, tels les claviers d’un orgue doté en outre de quatre tirettes linguistiques.
Si nous laissons de côté ses écrits critiques, nous observons que la production littéraire de Bernard Lesfargues s’est cantonnée à la poésie, sur une longue période de pas moins de trois-quarts de siècle : de sa « Poésie potache » bergeracoise (1942) jusqu’à « Poèmas del temps mesurat » (Lesfargues 2017), en passant par les sommes plus ou moins anthologiques : la bilingue occitan-français, La brasa e lo fuòc brandal (2001), et la française : Odes et autres poèmes (2014). Yves Rouquette en a brillamment mis en valeur la singularité, l’importance et l’exemplarité (Roqueta 2002)12. Il s’agit là par ailleurs d’une production « en archipel » – pour reprendre, comme le fait aussi Lesfargues (alors, son éditeur), la belle expression de Philippe Gardy (Gardy 1992) –, réalisée dans les interstices d’une vie (multi)professionnelle bien remplie, éditée dans les revues littéraires occitanistes ou périgourdines, par ses ‘protégés’ de Jorn, ou bien par lui-même et ses continuateurs, à Fédérop. Le genre poétique, par nature fragmentaire, exprime ces instants d’intimité introspective, sans doute brefs eux aussi.
Il donne lieu à une section nourrie de notre dossier. Elle s’ouvre sur deux contributions centrées sur une thématique majeure : celle de l’eau. Dans « Passejada al Cap de l’aiga / Promenade chez La mère de l’eau », Jean-Claude Forêt, cabotant d’un poème à l’autre, se focalise sur le recueil éponyme – publié dans la collection Messatges de l’IEO en 1952 – qu’il envisage tout à la fois « empreint d’une double mélancolie », « cahier d’un exil du pays natal » et « chanson du mal aimé ». Forêt se plaît à en souligner la facture, à la fois humble et cultivée, qui selon lui repose sur « formes simples et populaires […] inspir[ées] des romances », compris(es) tout à la fois comme ritournelles et poésie narrative ‘traditionnelle’. Avec « Bernard Lesfargues, une poétique de l’eau », Sylvan Chabaud envisage la thématique selon la focale plus large de l’œuvre poétique dans son entier, traversée, selon les lieux et les époques, par la récurrence aquatique, quelle qu’en soit la forme : « Des rives de la Dordogne aux quais des bords du Rhône à Lyon, des berges de l’Eresma en Espagne aux lavoirs de Siurana en Catalogne, des reflets de surfaces aux profondeurs des puits ». Depuis les sources, par le jeu chatoyant des reflets, les abysses troubles et sous l’effet d’une musique enchanteresse, se tisse donc cette poétique au long cours, que l’on interprétera, en ce début de nouveau siècle, au filtre d’une géo- et d’une écopoétique.
C’est à un autre aspect de la poésie de Lesfargues que s’attaque Jean-Yves Casanova avec « Bernard Lesfargues : une poésie du “temps mesuréˮ », dont il emprunte le titre à l’une des dernières publications, parue en 2017 dans la revue Reclams. Il y développe, dans un exercice qui s’efforce de mettre à distance le compagnonnage vécu, les différents paradoxes qu’il décèle dans cette œuvre, et la manière dont Lesfargues est parvenu à les subsumer : il en va ainsi aussi bien de l’espace que du temps. L’espace, de Bergerac au monde, du dialectal à la langue qui réconcilie le standard moderne avec les troubadours précurseurs. Le temps, aussi : celui d’un flux poétique jamais tari, mais fait d’instants dérobés aux multiples contraintes des engagements ; et celui, suspendu, du détail du quotidien qui ramène sans y paraître vers l’intemporel et l’universel.
Avec le texte suivant, Marie-Claire Zimmermann aborde ce qui peut être considéré comme une anthologie de l’expression poétique de Lesfargues en langue française, qu’il a assidûment pratiquée en marge d’une écriture liée à des collectifs militants en occitan, comme il s’en explique (justifie ?) auprès de ses lecteurs dans une note finale de deux pages, dépourvue de titre. Odes et autres poèmes date de 2014 et rassemble des poésies pour la plupart inédites, selon un ordre indépendant de la chronologie de leur écriture. Ce qui rend ses lecteurs, selon Zimmermann, « totalement libres face à ce contexte […] sans avoir à [se] servir de circonstances biographiques qu[’ils] pourr[aient] être tentés de plaquer sur l’écriture poétique afin de mieux l’expliquer ». Et cela, avance-t-elle, afin d’autant mieux en « effectuer une lecture rigoureuse [et s’]attacher[…] au déchiffrage des enjeux poétiques » : c’est bien ainsi que procède l’exégète, qui entend montrer ici « l’inventivité » toujours en éveil du poète.
Ouvrir vers d’autres mondes : traduire d’une langue à l’autre
Si l’on imaginait une solution de continuité dans les activités et les réalisations de Lesfargues, on en sera pour ses frais – comme annoncé – en découvrant la contribution de Philippe Gardy : « Bernard Lesfargues poète entre deux langues : doublement poète et son propre traducteur »13. Comment, en effet, si ce n’est de manière purement artificielle, séparer la création poétique d’une pratique traductive conçue comme une recréation dans laquelle le maniement de la langue d’arrivée est considéré par l’intéressé comme devant l’emporter sur celui de la source textuelle ? Réécrire et s’autotraduire relèvent fondamentalement de l’écriture. Pour Gardy, aucun doute : cette permanence du passage d’une langue (et d’une culture) à l’autre, chez Lesfargues, est bien consubstantielle, à la fois de l’écrivain occitan – pris entre dialecte et référentiel, entre sa langue d’origine et sa culture française –, d’un itinéraire de découverte et de contact des langues-sœurs que sont le castillan et le catalan, et tout simplement celui-là même de la création littéraire – qui ne le devient qu’au prix du dépassement-traduction de la banalité de son objet de départ.
Bernard Lesfargues a 28 ans lorsque paraît sa première traduction. C’est de l’espagnol au français, comme pour les 22 autres publications qui se succèdent de 1953 à 2009, en un beau catalogue d’auteurs hispaniques majeurs du XXe siècle : Dámaso Alonso, Juan Goytisolo (qui lui a mis le pied à l’étrier), Rubén Darío, Vicente Blasco Ibáñez, Camilo José Cela, Ramón J. Sender, Jesús Fernández Santos, Mario Vargas Llosa, José Luis Borges et quelques autres. Il se trouve que cette pratique n’est pas abordée dans notre dossier, qui s’est concentré sans propos délibéré sur les traductions du catalan – sans doute eu égard à la symbolique qui s’attache à ces dernières. Il serait néanmoins intéressant de vérifier si le changement de langue source induit des options traductives identiques ou non chez Lesfargues, et si elles évoluent sur la durée.
On peut considérer qu’avec l’anthologie du Pont de l’épée, Bernard Lesfargues fait ses gammes en catalan. La contribution de Jordi Julià, « Les traduccions poètiques de Bernard Lesfargues a Le Pont de l’épée. Poésie catalane contemporaine (1960) » se consacre à une étude soignée des options retenues par Lesfargues, aussi bien des auteurs que des poèmes et des versions qu’il en donne. La date n’est pas innocente : les poèmes sont le fruit d’une époque où le franquisme ne tolère, au prix d’une censure plutôt aléatoire, que la diffusion publique du discours poétique en langue catalane. La pléiade d’auteurs (rien moins que Joan Argenté, Blai Bonet, Josep Caner, Jordi Pere Cerdà, Salvador Espriu, Josep Vicenç Foix, Carles Riba, Jordi Sarsanedas et Màrius Torres) révèle de la part de Lesfargues une connaissance fine, exigeante et actualisée de ces productions. Jordi Julià se livre à une analyse traductologique transversale de ce corpus, qui permet de mettre en évidence certains tropismes chez notre traducteur, adepte, dans la mesure du possible, de la littéralité. S’agissant de poésie, Julià souligne le renoncement au rendu du rythme au profit de l’intelligibilité, ainsi que le jeu des équivalences, tant pour ce qui relève du lexique que de la rime, tout en pointant, à côté de véritables réussites, les porte-à-faux et approximations imputables à une connaissance sans doute relative de la langue source.
Quand bien même il reviendra ponctuellement vers la poésie, avec des traductions d’œuvres de Salvador Espriu, Jep Gouzy et Àlex Susanna, Bernard Lesfargues se consacrera désormais bien davantage à la prose, avec l’entrée magistrale que lui procure l’Incerta glòria de Joan Sales (1962, voir infra). Mais il faut attendre 1971, avec La Plaça del diamant, de Mercè Rodoreda (ici même analysée) pour que se forge puis se confirme, avec ses versions françaises, la position déterminante de Lesfargues dans le rayonnement international de la littérature catalane contemporaine. Pendant quatre décennies, au-delà des neuf traductions des romans de Rodoreda, il donne ainsi à connaître Jesús Moncada, Quim Monzó, Maria Antònia Oliver, Pere Calders et Jaume Cabré (trois traductions).
Deux contributions nous plongent dans les coulisses de la traduction – elle aussi incertaine – de Incerta glòria / Gloire incertaine, prose emblématique de la littérature catalane d’après-guerre civile. Avec « Apropant Catalunya i Occitània. Una lectura de l’epistolari Sales-Lesfargues », Marta Pasqual s’en tient, à travers les échanges entre le romancier-éditeur et son premier traducteur, à une approche externe de la genèse, non seulement de la traduction, mais également, par contrecoup, de l’original ; un chantier sans cesse remanié, la publication de certains passages, bienvenus à Paris, étant inenvisageable dans l’Espagne de l’époque, où la dictature franquiste est encore particulièrement sourcilleuse. On y voit bien l’intelligence réciproque des deux protagonistes. Dans « Bernard Lesfargues traductor de Incerta glòria, de Joan Sales », Dolors Poch renoue dans un premier temps avec les données contextualisées, pour se livrer ensuite à une étude centrée sur le texte, selon une approche relevant de la génétique textuelle. Elle met en évidence une véritable « aventure traductologique » à laquelle Sales, qui improvise et se pique de bien connaître la langue française, a soumis son traducteur (Lesfargues), à la fois fidèle, patient, souple et inventif : une rude épreuve pour celui-ci, certes, mais aussi un excellent tremplin professionnel à l’international.
Miquela Vaills nous entraîne ensuite dans le processus d’élaboration de l’autre roman – tout aussi emblématique de la prose catalane de l’après-guerre –, La Plaça del diamant / La Place du diamant, chef d’œuvre qui intronise Mercè Rodoreda. Comme dans le cas d’Incerta glòria, rien n’est simple, mais ici non pas entre l’auteur et son traducteur, mais entre ses deux co-traducteurs. Avec « La traducció francesa de La Plaça del diamant : una col·laboració Bernard Lesfargues-Pere Verdaguer », Miquela Vaills tente de dissiper l’imbroglio que cache d’un voile pudique la mention « avec la collaboration de Pierre Verdaguer » portée par l’édition Gallimard de 1971. Les deux ‘partenaires’ ont-ils véritablement coécrit la version française, ou Verdaguer n’a-t-il traduit que certains passages de l’œuvre, ou bien encore, comme le prétendait le Nord-catalan, Lesfargues a-t-il pillé sa propre traduction ? Vaills démontre, sur la base de l’examen minutieux des carnets manuscrits de son ami Pere, que toutes ces conjectures sont certes en partie recevables, mais que nous avons surtout affaire à une traduction notablement enrichie par Lesfargues à partir d’un manuscrit complet de Verdaguer, et donc à une véritable co-traduction plutôt qu’à une simple « collaboration ».
C’est également sur l’examen précis de l’écriture – le plus gros chapitre de Mirall trencat / Miroir brisé, de Mercè Rodoreda, roman de la maturité aussi bien pour l’écrivaine que pour son traducteur – que se base Christian Lagarde dans « Bernard Lesfargues, traducteur de Mercè Rodoreda : “Els nensˮ, chapitre de Mirall trencat », pour tenter de percer à jour le travail de traduction de Bernard Lesfargues. L’observation de « Els nens » le montre tour à tour fidèle, innovant, mais aussi parfois en réelle difficulté par rapport à l’original catalan, comme on a pu l’observer par ailleurs. En réalité, il y atteint une certaine symbiose avec l’écriture précise, alerte et créative de Rodoreda, dont il a déjà traduit sept titres, en quatre décennies, depuis 1971. Traduire est un métier – même si c’est un emploi secondaire pour Lesfargues – et traduire de ‘bons auteurs’, c’est, en définitive, s’inscrire en pionnier tout en marchant sans cesse sur la corde raide, avec de réels bonheurs et quelques petits trous d’air.
Éditer, une interface active et militante
Nous abordons ensuite le dernier volet des multiples activités créatives de Bernard Lesfargues : son métier d’éditeur. En son nom propre et celui de son époux Jean-Paul Blot, Bernadette Paringaux, dans « Fédérop, l’“héritage éditorialˮ de Bernard Lesfargues », porte témoignage de la passation de témoin des éditions Fédérop. Elle fait le récit des conditions de cette relève réalisée en 1999, des affinités entre les contractants, de la prise de risque d’une telle entreprise, de la délicate gestion de la continuité et d’une ouverture à des perspectives plus en accord avec les compétences et les goûts du couple – entre autres, la collection « Troubadours » et l’élargissement de la perspective mondialisée de la ‘diversité’. Ce texte constitue également un bilan, puisque, après avoir tenu Fédérop presque autant de temps que son fondateur, le couple Paringaux-Blot, la mort dans l’âme, passe aujourd’hui lui aussi la main.
Sous l’intitulé « Bernat Lesfargas, l’editor occità a favor de la Weltliteratur », l’article d’Andrea Pereira revient pour partie sur cet historique de la maison d’édition. Au-delà, il nous invite à boucler en quelque sorte la boucle de l’itinéraire de vie de Lesfargues, au prisme de l’expérience et de la revendication de l’altérité, aussi bien pour sa propre voix que celle des minoritaires du monde entier. C’est bien là ce qui fut le moteur de l’engagement politique et culturel de Bernard Lesfargues, dans une synthèse souvent mal comprise entre occitanisme et fédéralisme qu’il avait, qui sait, fini par inoculer à son grand ami Lafont. Dans le monde à la fois ouvert et clos de la traduction, avec la librairie Fédérop, épicentre lyonnais d’agit-prop co-créée à Lyon au lendemain de mai 1968, puis les éditions éponymes qui lui succèdent en 1975, on voit bien comment, à l’arrivée, Bernard Lesfargues fait feu de tout bois – un « fuòc brandal » ? – pour imprimer autour de lui sa marque personnelle et idéologique, contribuer à produire et mettre en circulation des œuvres d’esprit original, alternatif, dans un cadre où les niveaux local, panoccitan, français, européen et planétaire se juxtaposent et se fécondent.
Pour ne (surtout) pas conclure
Notre publication bénéficie enfin de la « Bibliographie de l’œuvre publiée de Bernard Lesfargues », due à François Pic (dont l’expertise en la matière bibliographique est largement reconnue), complétée et mise à jour par Vít Pokorný (dont la recherche sur l’occitanisme contemporain privilégie la figure et l’œuvre de Bernard Lesfargues) et par le fils aîné de Bernard, Bruno Lesfargues, qui dispose d’une grande partie des archives personnelles de son père – et parmi cette documentation, d’écrits à ce jour inédits.
La constitution de ce dossier monographique, à la fois puzzle et kaléidoscope, riche mais nécessairement incomplet, tout en apportant des éclairages appréciables (novateurs ou dans l’approfondissement de l’acquis), révèle également, en effet, bon nombre de lacunes que d’autres recherches tenteront, on l’espère, de combler. En la matière, on sait bien que rien n’est définitivement acquis, à l’image de la vie même de Bernard Lesfargues, tel qu’il nous apparaît fondamentalement aujourd’hui : un inlassable militant, créateur, passeur et diffuseur entre quatre domaines linguistiques et culturels, et bien au-delà.