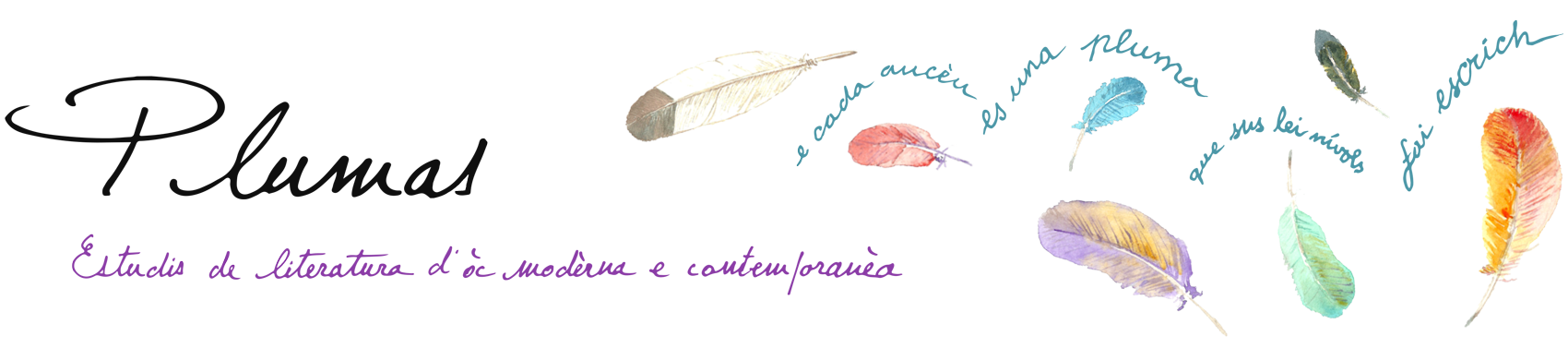Ça n’est pas ici le lieu de redire l’importance de l’œuvre de Bernard Lesfargues en tant que traducteur de la littérature catalane contemporaine vers le français, mais bien plutôt de tenter de se colleter au texte lui-même tel qu’il l’a livré au public francophone. Et ce faisant, tenter de découvrir comment procède le traducteur, face à son auteure de prédilection, Mercè Rodoreda (1908-1983)1, et dans le cas précis d’une des productions romanesques majeures de celle-ci, Mirall trencat (édition originale : 1974 ; version française : 2011).
Au-delà des éléments indispensables de contextualisation, aussi bien de l’original que de sa version française, on privilégiera une approche de type traductologique du texte d’un des chapitres du roman, intitulé « Els nens », considéré ici comme une métonymie de l’œuvre. Loin de toute érudition, cet essai ne nourrit d’autre ambition que celle de dévoiler comment fonctionne la traduction, de repérer, à côté d’une littéralité fluide que permet a priori la proximité linguistique entre catalan et français, les différentes sortes d’aspérités du texte, de ses référents explicites et implicites, comme autant d’obstacles au passage d’une langue-culture à l’autre, et les éventuels tropismes du traducteur qui s’y révèlent. Et l’on tentera in fine de dresser un bilan, nécessairement ouvert, de cette plongée au cœur des textes Mirall trencat et Miroir brisé, ainsi mis en regard.
Mirall trencat, édition originale en catalan, Club Editor, 1974 ; et traduction française, éditions Autrement Littératures, 2011.
Un triangle vertueux : Sales – Rodoreda - Lesfargues
Des dix-huit volumes écrits par Rodoreda, Lesfargues en aura traduit huit, soit à lui seul près de la moitié. Dont les trois grands classiques, à savoir La plaça del diamant (1962) – qui installe définitivement Rodoreda parmi les plus grands narrateurs catalans du siècle –, puis El carrer de les camèlies (1966) et Mirall trencat (1974). La rencontre de Lesfargues avec Rodoreda est tout ce qu’il y a de plus indirect. Elle date de 1962, presque une décennie avant la sortie chez Gallimard de La Place du diamant (1971). On en connaît les circonstances, et surtout le médiateur : l’éditeur et auteur Joan Sales, dont Lesfargues traduit le seul véritable roman, Gloire incertaine, précisément en 1962, au moment même où Sales, éditeur-fondateur de Club Editor, publie le texte original de La plaça. Víctor Labrado en rend compte ainsi :
Un dia de mitjan agost del 1962 en una llibreria de Ginebra, on vivia aleshores, Mercè Rodoreda no s’acabava la sorpresa d’haver-s’hi trobat, enmig de molts altres, aquell llibre que ja tenia entre les mans. El va pagar i se’l va endur a casa. Ja de camí, la sorpresa cedia a la curiositat. I l’admiració: fer-se traduir un llibre al francès era un luxe a l’abast de pocs escriptors en català, l’any 1962. El volum li feia respecte. No s’hi decidia. El va tastar : una pàgina per ací, una altra més allà. Sabem que pocs dies després escrivia a l’autor, el novel·lista i editor Joan Sales, que justament li acabava de publicar La plaça del Diamant a Barcelona. (Labrado 2021).
Et c’est en ces termes que Mercè Rodoreda écrit à Sales :
En una de les millors llibreries de Ginebra vaig veure un llibre molt gruixut, Incertaine gloire, el vaig comprar i el vaig fullejar. Em va semblar, a primer cop d’ull, un llibre brillantíssim. Vaig ensopegar amb un dels trossos més bonics que mai hagi llegit: una collita o una tria de safrà. Meravellós, com no n’havia llegit mai cap. Un tros de gran literatura o digne d’una gran literatura. No us puc donar una impressió de lectura total perquè me l’han pres de les mans. (Casals 2021).
On peut observer que, signe des temps, Mercè Rodoreda exilée à Genève est amenée à découvrir l’une des œuvres les plus marquantes de la littérature catalane de l’après-guerre, non pas dans sa langue d’écriture, mais en langue étrangère. C’est donc à travers la traduction française qu’il a réalisée non sans difficultés à partir d’un original sans cesse remanié par Joan Sales (Pla 2006)2, que Lesfargues est lu pour la première fois par Rodoreda. Et c’est par l’intermédiaire de ce dernier que Bernard Lesfargues deviendra par la suite le principal traducteur de l’œuvre de Mercè Rodoreda.
Mais revenons à Mirall trencat. Dans sa trajectoire d’écriture, Mercè Rodoreda montre que ce roman la confronte à une complexité de distribution des personnages, d’une envergure jusque-là sans précédent, qui la laisse déconcertée3, frisant la panne d’écriture :
Tota aquesta teranyina que se m’anava filant m’empresonava. Fatigada, vaig perdre tota mena de comunicació amb les meves criatures. Em fugien dels dits. Em calgué oblidar-l[e]s per tornar-l[e]s a trobar. (Rodoreda 2018, 18).
Avec, au bout de l’incertitude, un titre, et un chemin d’écriture :
[…] si la novel·la […] és un mirall que l’autor passeja tot al llarg d’un camí, aquest mirall reflecteix la vida. Jo, en tot el que tenia escrit de la novel·la d’una família, només en reflectia trossos. El meu mirall al llarg del camí era, doncs, un mirall trencat. En trobar el títol vaig poder reprendre la novel·la. Havia passat molt de temps. (Rodoreda 2018, 19).
Sans doute pourrait-on en dire de même du côté du traducteur. Mirall trencat est l’avant-dernière traduction de Rodoreda par Lesfargues4. Et elle est assez tardive, puisque publiée pas moins de 37 ans (1974-2011) après l’original. Entre temps, certes, Lesfargues a beaucoup traduit : pas moins de 25 titres – dont 17, du catalan, 5 d’entre eux étant, de surcroît, de Rodoreda. Serait-ce, dans le cas qui nous occupe, une « commande » de l’éditeur de Tinta blava, Llibert Aragó (Silber 2006), qui a republié les traductions de El carrer de les camèlies, de Rodoreda (2005), d’Incerta glòria, de Joan Sales (2007) et de Camí de sirga, de Jesús Moncada (2010), réalisées par Lesfargues, ou bien un souhait de ce dernier, en quelque sorte, de boucler la boucle initiée quarante ans auparavant avec La place du Diamant, traduction réalisée « en collaboration » avec le Nord-Catalan Pere Verdaguer ?5
« Els nens » comme métonymie de Mirall trencat
Le chapitre « Els nens »6 est l’avant-dernier de la première partie du roman ; le suivant constituant l’épilogue à la fois de la première partie et celui du chapitre 1.XVII, objet de cette étude. Il est par ailleurs, et de loin, le plus long du roman. Qu’on en juge : 24 p. dans l’édition catalane de 2018 (21 p. dans la version française de 2011), sachant que les chapitres comptent respectivement une moyenne de 10 p. (7,2 p.) pour la première partie, de 5 p. (4,5 p.) pour la deuxième et de 6,5 p. (5,5 p.) pour la troisième.
Sans doute une telle disproportion est-elle imputable à la construction même du roman, comme s’il s’agissait d’une pièce rapportée. Mercè Rodoreda nous dit avoir disposé de deux chapitres entiers avant d’être en mesure de se relancer dans une rédaction désormais fluide, où « des del meu reialme d’autor explicava els meus personatges, sabia què pensaven, els feia parlar amb la meva veu » (Rodoreda 2008, 13). Il s’agit, chronologiquement, de :
“Eladi Farriols de cos presentˮ, que […] no es deia [així…]. Eladi Farriols, mort i estirat al mig d’una biblioteca de casa de senyors, em donava de la manera més impensada el primer capítol de Mirall trencat, que es convertiria en el dinovè de la segona part. (Rodoreda 2018, 10)
Entre temps, escrivia contes […] el recull de La meva Cristina […]. La infantesa de la Cecília, no sé perquè, em va inspirar un altre capítol de la novel·la d’una família on el jardí ja prengué vida : “Els nensˮ. Ja tenia dos capítols de Mirall trencat, que s’anava construint sense que a penes me’n adonés. I amb un estil que no era el meu. (Rodoreda 2018, 13).
« Els nens », déclencheur d’une écriture incertaine7, joue également un rôle important dans le déroulement de l’intrigue – ce qui justifie son positionnement en fin de première partie – comme l’indique à nouveau la romancière :
L’assassinat del petit Jaume pels seus germans (gelosies infantils complicades amb gelosies dels grans) és una de les claus –la clau– de la novel·la. Complex de culpabilitat de Maria –suïcidi– i de Ramon –fracàs– que repercuteix indirectament en els altres : Eladi, Sofia, etc. (Rodoreda 2018, 20)
L’évocation des jeux enfantins, faits tout à la fois d’innocence, de connivence, de « jalousies » et de cruauté, se déroule pour l’essentiel dans le parc de la demeure des Valldaura, dans le quartier encore en devenir de Sant Gervasi, à Barcelone, « un jardí desolat, idea pura del jardí de tots els jardins » (2018 : 9) que Mercè Rodoreda a imaginé à partir de souvenirs à la fois concrets et mythifiés, dit-elle, de son enfance8. Il s’en dégage une impression faite de mystère et de sensualité, dans le droit fil du chapitre précédent (1.XVI), « Les minyones a l’estiu », où l’on voit le groupe des servantes de la maison se rafraichir nues et se taquiner dans la torpeur de l’été.
Mais la pénombre du jardin, et la vasque à l’abandon, constituent un espace hors du temps, clos et romantique propice à la survenue du drame, auquel Rodoreda prépare son lecteur en semant des indices, en particulier le façonnage effectué par Ramon, le frère aîné, de ce branchage en forme de fourche qui sera l’arme du crime. Une issue que suggère presque comme une évidence la fin de l’épilogue (« L’aigua no fa això, senyora Teresa », « Una tòrtora a la finestra », chap. 1.XVII, p. 1839), quand bien même la version officielle sera que le petit Jaume, si délicat et empoté, s’est noyé. Dans « Els nens », le dénouement, plus ou moins pressenti, tient néanmoins, au bout du suspense, en une seule page : le cafard paie, depuis son impuissance, pour ses délations réitérées des transgressions de ses aînés.
Une des caractéristiques majeures de l’écriture de Rodoreda est de combiner le très classique point de vue du narrateur omniscient avec une vision à hauteur de personnage(s). C’était déjà sa marque dans La plaça del diamant, où elle intégrait la vision du monde, toute populaire et innocente, de Colometa. Ici, tout particulièrement dans le chapitre qui nous occupe, c’est l’innocence des enfants – tout comme dans la scène sensuelle des servantes sous le jet. Le point commun est sans nul doute celui souligné par la romancière dans la préface : « Però sóc una persona com les altres i potser la més marcada de les meves múltiples personalitats10 és una mena d’innocència […] » (Rodoreda 2018, 33). Raison pour laquelle on ne peut donc que la retrouver sans surprise dans ses fictions :
[…] la innocència, perquè s’adiu amb una part important del meu temperament, em desarma i m’enamora. Els personatges literaris innocents desvetllen tota la meva tendresa, em fan sentir bé al seu costat, són els meus grans amics. (Rodoreda 2018, 34)
L’intérêt manifesté pour la psychologie enfantine dans « Els nens » et l’indifférence de la plupart des adultes, surtout des mères (aussi bien Teresa que sa fille Sofia11) à leur égard, contraste, tout en lui faisant écho, avec l’approche personnelle pour le moins complexe et déroutante de la maternité dans la vie même de Mercè Rodoreda : comme celles de la fiction, elle fut, semble-t-il, une mère à tout le moins indifférente pour son fils unique Jordi12. De quoi donner matière à illustrer le propos de la romancière : « En tots els meus personatges hi ha característiques meves, però cap dels personatges no és jo », au motif que « no he nascut per limitar-me a parlar de fets concrets » (Rodoreda 2018, 11).
L’art subtil du traducteur
On sait quel a été le cheminement de Bernard Lesfargues vers la langue et la culture catalanes : une rencontre assez inopinée avec la langue sœur de celle qu’on avait évité de lui enseigner mais qui l’entourait dans son enfance bergeracoise : l’occitan13. Lesfargues, contrairement à l’espagnol pour lequel il a bénéficié d’une longue formation scolaire et universitaire pour en faire son métier d’enseignant, est un autodidacte tardif en catalan, handicap qu’il palliera par son bagage intellectuel et une vraie passion. Cela étant, quelle est la position de Lesfargues en tant que traducteur ? Il y a d’abord cette tâche solitaire d’ascèse, faite de longues heures de labeur : « Il est seul, tout seul à se battre avec les pages qu’il doit translater dans sa propre langue. C’est l’évidence même qu’il lui faut posséder la langue “sourceˮ, mais il doit connaître infiniment mieux la langue “cibleˮ qui, normalement, est la sienne » (Lesfargues 2022, 139, n. 2). Le Bernard Lesfargues agrégé d’espagnol et professeur en classes préparatoires ne connaît en effet que trop bien l’exercice de la « version » – ici, universitaire –, cet autre terme par lequel on désigne la traduction.
Reste la question de la littéralité. Selon Lesfargues, l’affirmation « “Traduire c’est écrireˮ […] ne déroute que celui qui estime que “servirˮ un texte est le propre d’un serviteur », car, dit-il, faisant sienne la célèbre devise des Rois catholiques « Tanto monta, monta tanto », « [l]’auteur et son traducteur sont écrivains à part entière » (Lesfargues [2015] 2022, 140). Sans prétention, Lesfargues remplit ce dernier prérequis, tel que posé par le grand correcteur de traduction vers le catalan que fut (entre autres mérites) Francesc Vallverdú – et sans doute échappe-t-il à l’objection adressée par celui-ci aux traducteurs français :
La fidelitat a l’original s’ha anat imposant, però la segona manera, la tradicional, en què el traductor tenia molta més llibertat que no pas ara, encara és la prioritària o més celebrada a França, on els traductors considerats bons, en afrontar un text literari, pensen que l’original pot estar bé, però troben que en francès ells mateixos l’haurien escrit millor i miren d’arreglar l’obra segons el seu gust. No entenc aquesta actitud, perquè una obra agrada o no agrada, i prou. Penso que el traductor ha de treballar com a torsimany de l’autor traduït ; si no, que no es dediqui a traduir, que faci una altra cosa. A banda d’això, hi ha un axioma de la traducció, que sempre he compartit, segons el qual, si bé has de conèixer molt la llengua de partida, cal dominar sobretot la d’arribada. El traductor que no acaba d’entendre la llengua de partida sempre té el recurs de consultar els dubtes, però el que no domina la d’arribada no pot traduir : hi ha moments que no sap què ha de fer, perquè li costa molt de discernir les solucions que funcionen de les que no. (Llobet 2011, 402)
Doit-on pour autant considérer que notre traducteur pratique la réécriture ? Étudier sa version française du chapitre « Els nens », revient à travailler sur des points de détail : une centaine, soit 4 à 5 par page dans le texte choisi. Doit-on dire ‘seulement’, ou ‘tout de même’ ? voilà qui paraît difficile à élucider.
La traduction littéraire professionnelle de centaines de pages, vraisemblablement dans des délais éditoriaux contraints, peut conduire à quelques scories : des écarts surprenants, comme, hors de notre extrait, le contresens manifeste (chap. 1.XII (126) : « i ell se’n adonava » rendu par « et lui […] ne s’en rendait pas compte », (87), ou, dans le chapitre 1.XVII qui nous occupe, la coquille par omission (« començaren els crits de l’Armanda […] i li aixecava la faldilla », (175), qui devient « alors commencèrent les cris […] Et elle lui relevait sa jupe » (131), où le « elle » devrait, pour éclairer le lecteur, renvoyer à une identité explicite, comme dans l’original), mais ils sont extrêmement rares14. Parfois, comme dans « les mans li tremolaven » chap. 1.XIV (137), qui devient « elle avait les jambes qui tremblaient » (97-98), on pourrait penser que l’écart est gratuit, voire injustifié. Mais à y bien réfléchir, si les mains tremblent, c’est, dans la culture française, davantage en raison d’une nervosité mal contrôlée, alors que les jambes qui se dérobent nous renvoient, comme c’est le cas dans le passage, à la frayeur ou à la peur.
Le souci de littéralité conduit Lesfargues, par petites touches presque imperceptibles qui rompent avec l’usage lexical, à une certaine créativité qui est tout sauf « servile ». Il en est ainsi de « com si hagués sortit de sota terra » (175) traduit par « comme si elle était sortie de dessous la terre » (132), ou de cette coupe « de color de la rosa » (157), qui devient « de la couleur de la rose » (116). Dès lors, on comprend mieux la liberté traductive d’un « prenaient la couleur du feu » (126), qui rend « es tornaven color de foc » (p.168). En revanche, Lesfargues laisse son lecteur francophone dans une certaine ambiguïté, lorsqu’à partir de « En Jaume tenia l’orella molt calenta i el darrera li coïa » (171), il écrit : « Il avait son oreille très chaude et le derrière lui démangeait » (128) S’agit-il de la face arrière du lobe ou du postérieur de l’enfant ?
Une course d’obstacles
La traduction des interjections est un domaine particulièrement lié à l’usage où la littéralité est souvent mise à mal. C’est pourtant ce que tente Lesfargues avec « Maca, maca ! » (161), qui devient « Jolie, jolie ! » (119) et non pas un « Ma jolie ! » plus attendu, et ce, alors même qu’il innove à juste titre pour rendre les ordres « Quiet ! » et « Ara !» (179), respectivement en « Du calme ! » et « Vas-y ! » (135). Plus largement, c’est le rendu des formes d’oralité, qui font problème et sont diversement résolues. Si « muts i a la gàbia » (p. 168) trouve un excellent pendant dans « motus et bouche cousue » (126), il faut davantage innover pour faire de « sí que em fa quedar parada » (178) « vraiment, vous m’étonnez beaucoup » (134), ou de « ja tens la cua » (d’âne – 160), « Et te voilà la queue » (118). Quant à la familiarité de « s’il ne cafardait pas » (131), elle est l’équivalent parfait de « si ell no ho xerrava » (175).
Dans le même ordre d’idées, la traduction des onomatopées présente elle aussi toujours une difficulté, celles-ci répondant à des contraintes à la fois phonético-phonologiques et culturelles différentes d’une langue-culture à l’autre. Doit-on en appeler au poncif de l’opposition ‘matérialité du catalan’ vs.‘intellectualité du français’ pour commenter les deux exemples présents dans notre chapitre ? Avec « escoltava el zum-zum que feien les abelles » (170) et la toupie qui « anava banzim-banzam » (176), nous voyons Lesfargues se détourner de l’exercice littéral en ayant recours tantôt au substantif abstrait « écoutait le bourdonnement des abeilles » (128), tantôt au verbe « elle se ballottait » (133). On n’en est pas si loin lorsque l’abeille qui « xuclava suc de flors » (171) est vue « en train de butiner une fleur » (128). Sans doute pourrait-on voir la même stratégie d’évitement lorsque, face à la redondance sonore délibérée de Rodoreda avec « clavi’m un clau » (163), on lit un ordinaire « plante-moi un clou » (121) ; mais on hésite davantage face à l’équivalence de « fent-li pom-i-pipa » (p. 160) en « lui faisant des pieds de nez » (118). En revanche, il convient de saluer le rendu de la formule chantée enfantine « Arri, arri, osque, osque » (160), par son équivalent français presque parfait, « Arri, arri, mon poulain » (118), qui fleure bon la comptine occitane « arri, arri, mon chivau… ».
La question sous-jacente est celle des registres de langue. Le passage d’une langue à l’autre suppose un choix dans le texte cible dont pouvait éventuellement se départir la source. Ainsi, les ordres négatifs proférés par les enfants : « No feu soroll » (156) ou « No comencis a dir » (157) ne sont pas marqués en catalan, alors qu’en français, l’omission de la négation « ne » (« Faites pas de bruit » [115] et « Commence pas à dire » [116]) marque à juste titre la langue familière des échanges enfantins. À l’inverse, si Lesfargues rend régulièrement les prétérits catalans par des passés simples français, caractéristiques du récit au passé, aussi bien dans la tradition orale que dans l’écrit, il est un peu surprenant que la concordance des temps soit pratiquée systématiquement pour ce même passé : les imparfaits du subjonctif français donnent au texte une patine emphatique dont l’original catalan est dépourvu15.
Le plus souvent en effet, le texte de Miroir brisé se signale par des équivalences ou des amplifications qui réhaussent sans crier gare le registre – c’est là précisément que Lesfargues affirme son autorité. On passe ainsi de « només per a ells tres » (156) à « qui n’appartenait qu’à eux trois » (115), ou bien de « anà més enllà » (164) à « il s’aventura au-delà » (122), ou encore de « A banda i banda de la porta, hi havia » (169) à « De chaque côté de la porte on avait peint » (127). C’est d’autant plus vrai lorsque l’évocation acquiert un lyrisme pictural, comme dans le passage de « s’havien ruixat al bat del sol » (168) rendu par « avaient fait leurs ablutions en plein soleil » (125) ; qu’elle masque les trivialités (« aquella olor tan bona d’àvia que sortia de la butaca » [168], devenu « ce si bon parfum d’aïeule qu’exhalait le fauteuil [125]) ; ou qu’elle s’applique à des civilités (« ara ja se’n pot anar» [162], qui devient « maintenant vous pouvez vous retirer » [120]).
Si la tournure consécutive assortie du subjonctif « perquè callés » (175) se voit rendue par l’expression de la contrainte dans « pour l’obliger à se taire » (131), ce n’est pas qu’elle n’ait pas d’équivalent – mot à mot, ‘pour qu’il se taise’ –, mais par choix de l’emphase dramatique. Or le traducteur doit aussi faire face à des tournures qui n’ont pas d’équivalent morphosyntaxique dans le français langue cible. Ainsi, aux mêmes pages 164 et 122, nous trouvons la forme progressive anar + gérondif dans « com en Ramon anava pelant la branca », puis « en Ramon l’anava empenyent », rendue respectivement en « Ramon occupé à peler la branche » et « Ramon l’obligeait à reculer », où Lesfargues se voit contraint d’expliciter l’attitude ou l’intention, faute d’inscrire les actions dans la progressivité temporelle. On en dirait autant, au sujet des oreilles de Jaume, de l’expression du devenir de « per fer-se-les rosades » (158), rendu par « pour leur donner de la couleur » (117), ou que ces mêmes oreilles « se li fan massa grosses » (162) que le texte cible limite au constat « qu’il les a trop grosses » (120), ou bien encore, à partir de « el barquet s’anava podrint » (169), à celui de « la petite barque [qui] pourrissait » (126). Quand ce n’est pas « es tornaven una truita negra » (160), devenu « n’étaient plus qu’un tas noir » (119), où l’image originale de la forme – caractérisée par l’ambiguïté sémantique en catalan de ‘truite’ ou, par analogie, d’‘omelette’ – est réduite, vraisemblablement en tant que ‘non-décidable’ si ce n’est par l’hyperonyme, à un simple « tas ».
Pour ce qui est des formes lexicales figées, comment rendre la directionnalité de amunt dans l’expression « alguna fugia cel amunt » (165), relativement bien traduite par « quelque papillon s’envolait dans le ciel » (122), si ce n’est au cas par cas, comme avec « soca amunt » (164 et 160) ? Lesfargues en fait, tel quel, « sur un tronc » (122) et, pour « les ombres s’enfilaven soques amunt », « l’ombre gagnait les troncs » (119). Comment dire « a tocar de l’aigua » (164), si ce n’est par un « au bord de l’eau » (122) bien moins suggestif ? Comment rendre l’effet réitératif en forme de parcours, de « de ximeneia a ximeneia » (177), si ce n’est par un « d’une cheminée à l’autre » (134), là aussi plus faible ? Parfois cependant, le défi est relevé, comme quand « veure com es feia de dia » (178) devient « voir comment naissait le jour » (134). Et d’autres fois, aussi, c’est le français qui impose son propre figement : traduire « per mirar la pluja » (167) débouche nécessairement sur l’explicitation « pour regarder tomber la pluie » (124).
Quant au lexique proprement dit, il peut laisser Bernard Lesfargues dans l’embarras, comme pour rendre « un llampec travessà el cel com una xurriacada » (177) : « un éclair fendit l’air, de haut en bas » (133), où l’on perd l’effet sonore, n’est qu’un moindre mal, quand « quedà mig de bocaterrosa » (179) le contraint piètrement à la glose en se privant de l’onomatopée, avec « il resta à mi-chemin de la position à plat ventre » (135). Ailleurs, il perd en mouvement ce qu’il gagne en précision avec « l’escalier en colimaçon » (133) pour « l’escala que feia voltes » (177), ou ce « qui venait d’entendre la messe » (130), où est évoqué l’office, pour « que sortia de missa » (173), où seul s’exprime le mouvement.
Lesfargues s’en sort bien mieux, par ailleurs, en condensant dans le verbe « il lui arrachait son sac » (130), l’action mouvementée en deux temps de l’énoncé « li prenia el portamonedes d’una revolada » (173). Il joue habilement aux limites du faux-sens lorsqu’il traduit « la forca l’havia acostat a l’aigua », qui relève du mouvement constaté et « tot semblava que fos molt lluny » (179), respectivement, par « la fourche l’avait poussé près de l’eau », qui explique le mouvement, et « on aurait dit qu’elles étaient très loin », moins imprécis (135). En traduisant balcó par porte-fenêtre, il lève l’ambiguïté sémantique (le balcon par lui-même ne s’ouvre pas), tout comme il trouve une équivalence appréciable en faisant de « Perquè no li donessin empentes » (170) « De peur qu’ils le bousculent » (128) où s’exprime le sentiment récurrent chez Jaume, ou encore de « hi havia tres cosetes seves » (167) « il y avait trois choses qui lui appartenaient » (125), plus expansif, quoiqu’au détriment du diminutif affectif. Mais, alors que « il s’enveloppa dans les draps » (133) est sans nul doute préférable à l’original (« s’embolicà amb la roba », 177), comment justifier l’écart lexico-sémantique entre « se li arraconà a les faldilles » (166), c’est-à-dire l’acte de se réfugier, et « il lui chiffonna la jupe » (124), qui n’en est que la conséquence, si ce n’est, qui sait, par une sorte d’écho en assonance en « on[n]a » ?
La rupture syntaxique, ou comment faire sien le texte
Reste en effet à trouver des éléments d’explication à un autre phénomène majeur identifiable dans le chapitre « Els nens » : les ruptures syntaxiques, par inversion (tableau 1) ou par restructuration (tableau 2).
|
n° |
p. (2018) |
Texte source |
Texte cible |
p. (2011) |
|
1 |
157 |
¿ Què vols que s’hi posi, burro ? |
Imbécile, qu’est-ce que tu veux […] ? |
116 |
|
2 |
163 |
L’Armanda al cap d’un moment |
Au bout d’un moment, Armanda |
121 |
|
3 |
163 |
En Jaume estava dret davant dels seus germans |
Debout devant son frère et sa sœur, Jaume |
121 |
|
4 |
169 |
Al camp hi anaven |
Ils allaient dans les champs |
126 |
|
5 |
169 |
En Jaume, si no queien, s’adormia |
Si les feuilles se faisaient attendre, Jaume |
126 |
|
6 |
170 |
En Jaume s’agenollava amb les mans juntes |
Jaume, les mains jointes, s’agenouillait |
127 |
|
7 |
171 |
Les minyones, a la cuina, cantaven |
A la cuisine, les filles chantaient |
128 |
|
8 |
173 |
La senyoreta Rosa, en haver dinat, anava a dalt |
Dès qu’elle avait déjeuné, Mademoiselle Rosa montait à l’étage |
130 |
Des huit énoncés réunis dans le tableau 1 se dégage un trait stylistique récurrent chez Rodoreda, la mise en évidence, par antéposition, du sujet, qui se réfère à la/aux personne(s) : Armanda (2), Jaume (3, 5, 6), les servantes (7), Mademoiselle Rosa (8). On trouve dans les exemples 5, 7 et 8 une structure récurrente, qui enchâsse une incise entre le sujet et le verbe, créant un effet prosodique de scansion que paradoxalement, comme en contrepoint, Lesfargues reproduit à l’exemple 6 (« Jaume, les mains jointes, s’agenouillait »), quand il est absent chez Rodoreda. Et ce, alors même qu’il s’était semble-t-il évertué à le rompre dans les trois énoncés mentionnés, privilégiant l’expression, tantôt de la condition (« Si les feuilles… », 5), tantôt celle du lieu (« A la cuisine », 7) ou du temps (« Dès qu’elle avait déjeuné », 8), comme il l’introduit par ailleurs à son initiative (dans 2, pour le temps : « « Au bout d’un moment » ; dans 3, pour la manière « Debout devant… »).
L’effet prosodique, scandé par les virgules, n’a à l’évidence pas échappé au traducteur ; il en use à sa guise, en le rejetant dans l’exemple 4 où son énoncé suit un cours banal (« Ils allaient dans les champs »), ou bien en l’imposant dans l’exemple 1, où Rodoreda a, pour une fois, opté pour une postposition de l’adresse (« ¿Què vols que s’hi posi, burro? »). Par ailleurs, dans l’énoncé 3, le rejet inhabituel du sujet peut trouver sa justification dans la volonté de souligner, de manière quasi héroïque, la résistance du plus faible face à ses tourmenteurs, « Debout devant son frère et sa sœur ». Quant à l’énoncé 5, le même procédé vise peut-être, en lieu et place du balancement récurrent, à accentuer l’effet de durée de l’attente (« Si les feuilles se faisaient attendre »), avant que Jaume ne finisse par sombrer dans le sommeil.
On voit donc à travers ces huit écarts de traduction par déplacements, l’illustration de l’affirmation par Bernard Lesfargues que le traducteur n’est pas un serviteur, du texte ou de l’auteur, mais qu’il est bien lui-même auteur, écrivain. Les énoncés qui suivent confirment pareille détermination, dans la mesure où c’est la syntaxe même de la phrase qui est repensée voire chamboulée par un traducteur en liberté, comme en témoigne le tableau 2 qui suit.
|
n° |
p. (2018) |
Texte source |
Texte cible |
p. (2011) |
|
9 |
162 |
Pegà a en Ramon, que li donà |
Il tapa Ramon, et celui-ci lui flanqua |
120 |
|
10 |
162 |
La trompa cargolada en l’aire |
La trompe, dressée, en spirale |
120 |
|
11 |
166 |
I triaven les torrades més maques |
En choisissant les plus grosses rôties |
123 |
|
12 |
167 |
Un dia l’àvia li feu beure […] i ell li explicà… |
Un jour où la grand-mère lui avait fait boire […], il lui expliqua… |
125 |
|
13 |
175 |
I la Maria, mentre en Ramon tenia el nas clavat al vidre […] feia veure que […] i l’Armanda entrà al menjador |
Tandis que Ramon restait le nez collé à la vitre […] et que Maria faisait semblant de […], Armanda entra |
131 |
Parmi les cinq exemples réunis, les énoncés 9, 11, 12, et davantage encore, 13, rebattent les cartes des rapports syntaxiques. On peut dire que tout se joue autour de la coordination, soit que le ‘i’/’et’ est réinterprété (11, 12, 13), soit qu’il est introduit par substitution (9, 13).
Dans l’énoncé 11, la coordination qui marque la succession d’actions exprimées par les verbes, fait place à l’expression, grâce au gérondif « en choisissant », de la modalité simultanée. Dans l’exemple 12, à partir de la même base, c’est du fait de l’introduction de la caractérisation du jour par « où », qui ouvre une subordonnée circonstancielle de temps (« où la grand-mère lui avait fait boire »), que la coordination n’a plus lieu d’être, la virgule marquant le retour à la principale (« un jour, il lui expliqua »). On constate que Lesfargues opère en sens inverse dans l’énoncé 9, où la coordination (relation égalitaire « et ») remplace la relative (relation de dépendance « que ») de l’original : les « modèles » rodorediens laisseraient-ils des traces ?...
Quant à la phrase 13, elle cumule les réaménagements. Il y a dans le texte source deux principales coordonnées : « I la Maria […] feia veure » et « i l’Armanda entrà al menjador », ainsi que deux subordonnées : la première, en forme d’incise est une temporelle (« mentre en Ramon tenia el nas clavat al vidre »), la seconde, une conjonctive (« feia veure que… ») qui n’a pas été développée ici. Au lieu de cela, le texte cible nous propose une seule principale, « Armanda entra… », précédée de deux temporelles coordonnées « tandis que Ramon restait le nez collé à la vitre […] » et « que Maria faisait semblant de […] ». Au bilan, on peut donc avancer une volonté du traducteur de simplifier une construction syntaxique du texte source qu’il juge par trop complexe.
Reste l’exemple 10, tout à fait en marge de ces manipulations, mais on va le voir, tout empreint de subtilité. L’énoncé fait apparaître une sorte de chiasme où la traduction innove également par le rythme syncopé (« La trompe, dressée, en spirale »), déjà analysé précédemment comme récurrent dans le texte de Rodoreda, qui ici, précisément, y déroge (« La trompa cargolada en l’aire »). De plus, si la construction conserve, du point de vue syntaxique, l’ordre initial : substantif, participe passé adjectivé et modalité (y compris avec reprise du ‘en’), on observe que sémantiquement l’ordre s’inverse : « en spirale » (position 3) reprend « cargolada » (position 2), alors que « dressée » (position 2) reprend « en l’aire » (position 3). La traduction se fait ici, délibérément, en tant qu’exercice de style, que recréation.
Pour tenter de conclure
Avec Mirall trencat, Bernard Lesfargues, traducteur littéraire aguerri, doit faire face à l’œuvre d’une romancière en pleine maturité créative, depuis qu’elle peut enfin se consacrer à l’écriture. La proximité linguistique relative du français avec le catalan favorise sans conteste une possible littéralité de la traduction. Or, dans la vingtaine de pages que compte le chapitre le plus long de la fiction, pas moins d’une centaine d’occurrences s’écartent plus ou moins de l’original, ce qui est loin d’être négligeable. Car la proximité des langues romanes se révèle plus illusoire qu’il y paraît : c’est sans compter différents facteurs, qui tiennent à la richesse morphosyntaxique et lexico-sémantique de la langue de la romancière, bagage qui lui ouvre les portes d’une expression littéraire tout en maîtrise, prête à envoûter son lecteur et mettre son traducteur au défi. La palette des registres linguistiques employés ne doit pas être étrangère à celui-ci, pas plus qu’une culture qui possède ses propres codes, souvent moins policés. Au traducteur d’en venir à bout.
C’est bien ce que tente avec succès Lesfargues, que le chapitre analysé ici, « Els nens », métonymie du roman, nous montre, toujours sur le fil, tour à tour à la peine – comme « mig de bocaterrosa » –, dans une gestion raisonnée et équilibrée des difficultés – par exemple, dans la même page, allégeant le double diminutif de « donant-li copets amb un branquilló » (163) en « de petits coups avec une branche » (121) ou révisant la syntaxe de « aguantant el barquet com si el presentés » en « tenait son bateau : on aurait dit qu’il le présentait » –, et si pénétré du matériau langagier du texte source qu’il le module à sa manière, avec bonheur, comme on vient de le constater tout récemment.
Avec cette part d’inventivité, Bernard Lesfargues sert le texte de Mercè Rodoreda, au sens où il le respecte dans son ensemble sans se priver de lui insuffler ce qu’il considère des « bonus ». Non pour être servilement dans ses pas, au pied de la lettre, mais bien plutôt pour se pénétrer de son esprit, quitte à déborder le texte, parce que, dans une certaine mesure, il s’accorde le droit d’être lui aussi un auteur. Le défi est celui de n’être pas en reste par rapport à l’original, sans pour autant se vouloir ou se prétendre meilleur – ce qui serait à la vérité une forme d’usurpation, et conforterait l’aphorisme du traditore, dont aucun truchement ne souhaite se voir affubler. Au fond, quelle version, l’originale – « Dels penjolls de glicines anaven caient flor s» (171) –, ou bien celle résultant du « transport de l’image d’une langue à l’autre »16 –, « Les grappes de glycines perdaient leurs fleurs » (128) – le lecteur bilingue doit-il préférer ?...