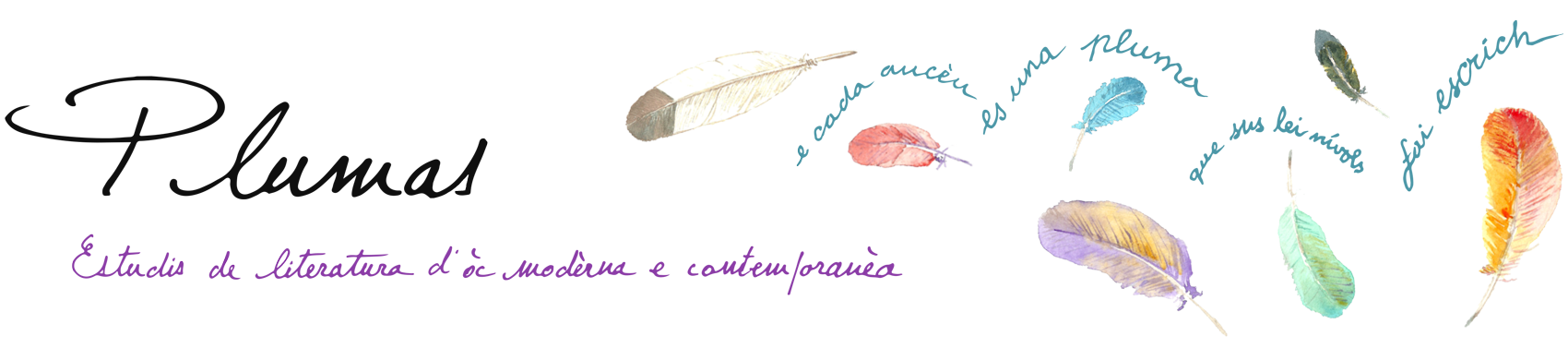L’exercice est difficile, mais il faut le mener. Il est périlleux, car on ne peut jamais s’y livrer avec des certitudes critiques, surtout quand il concerne un homme, un poète, qui fut pour nous un ami cher, et à qui l’on doit beaucoup. J’ai souvent dit et écrit que Bernard Lesfargues était un « passeur », un être qui a su, souvent avec tact et délicatesse, nous faire comprendre qu’ici ou là résidait une partie de notre ignorance qu’il entendait combler en nous indiquant des lectures, en nous dirigeant sans impériosité dans une voie dont on sortait toujours ressourcé par l’amitié. Écrire sur la poésie de Bernard Lesfargues est donc l’un de ces travaux malaisés, mais que l’on fait non pas par nécessité ou dévouement, mais par l’amitié grande et la reconnaissance qui, face à la disparition des êtres chers, demeurent en place, comme défi de ce temps qui passe, nous broie, nous gibla, mais ne nous éteint pas.
Il est notoire de constater que l’œuvre poétique de Bernard Lesfargues a été éclipsée par ses travaux de traduction et son activité d’éditeur. Pour ceux qui ne le fréquentaient pas, Lesfargues était avant tout ce grand traducteur du castillan et du catalan, et l’éditeur scrupuleux de Fédérop. Je n’en parlerai pas, d’autres pourront le faire mieux que moi1. Disons simplement que, dans cette caractéristique de « passeur » qu’il partageait avec son ami Jean-Marie Auzias, Lesfargues fut, avec Robert Lafont, celui qui nous montra le chemin catalan, celui qui nous révéla tout un pan d’une littérature méconnu, de Tirant lo blanc qu’il aimait tant, aux poètes les plus récents, parmi lesquels figure Àlex Susanna dont nous avons partagé et partageons encore l’amitié. D’emblée, pourtant, nous savions Bernard poète, car il était évident que ce grand érudit écrivait lui aussi, de ses premiers livres, Cap de l’aiga (Lesfargues 1952) et Còr prendre (Lesfargues 1965)2 jusqu’au recueil de poésie « [in]complète » à Jorn en 2001 (Lesfargues 2001), une œuvre poétique nécessairement inachevée de par le nombre pléthorique de poèmes épars et une création de plus en plus présente, jamais épuisée ; poésie incomplète comme celle de notre ami Jep Gouzy qui, le soir même de la publication de sa Poesia oberta chez Columna en 1990 (Gouzy 1990), se fit un malin plaisir à écrire un poème pour que l’incomplétude soit de mise. Chez Bernard Lesfargues, la poésie était discrète, elle ne s’étalait pas en proclamations, en postures, en revendications tonitruantes ; elle se réfugiait dans le raffinement intime des choses quotidiennes, dans le frémissement des sentiments et des sensations les plus ténues, elle se lovait au creux des mots d’une langue qui était tout à fait sienne et qui, charnellement, a accompagné son existence, sans pour cela repousser les autres langues, mais toujours au cœur d’une « nuit close » où l’on attend patiemment que la lumière nous rejoigne.
Bernard Lesfargues dans son jardin à Église-Neuve-d’Issac, archives familiales
Né en 1924, Bernard Lesfargues fait partie de cette génération qui arrive à l’écriture pendant la guerre et plus sûrement à la Libération. Son parcours retracé par Philippe Gardy (Gardy 2019) n’est pas en soi singulier ; il ressemble à s’y méprendre aux intellectuels occitans qui accèdent aux fonctions universitaires ou diplomatiques comme Robert Lafont, Bernard Manciet et bien d’autres et qui se réunissent après la création de l’Institut d’Études Occitanes dans l’anthologie du Triton bleu dont Lesfargues fut l’un des initiateurs. Sur ce parcours dont la seule originalité est de mêler très vite deux activités, celle de la traduction et celle de la création poétique, on peut penser qu’il y a encore certaines choses à découvrir, à préciser, certaines influences à définir, notamment celles qu’il reçut de ses professeurs en khâgne à Bordeaux puis à Paris, ainsi que ses fréquentations à la fin de la guerre et dans les premières années de la Libération. Poète en français et en occitan, et ce jusqu’à la fin de son existence, il semble dès son séjour parisien et ses années d’études se diriger vers l’espagnol, chemin roman que l’on peut comprendre comme un substitut de l’occitan ou du moins son accompagnement majeur. Glissant ainsi de l’espagnol vers le catalan, cet itinéraire de traducteur et de poète révèle le paradoxe d’une permanence : celle de la langue source, cet occitan de Bergerac que Lesfargues fait sien au-delà des particularités locales, célébrant toujours ce qui est de l’ordre de la langue vernaculaire et ce qui est de la littérature la plus exigeante dans un seul creuset linguistique où il puise matière et forme. Il est en ce point semblable aux poètes de sa génération, Manciet surtout qui cultive au plus haut point sa différence gasconne – et même negue à l’intérieur du système gascon – en haussant son parler à la hauteur d’une langue littéraire originale. Contrairement à Lafont qui évolue très vite vers l’élaboration d’un provençal commun sur des bases « nîmoises », Lesfargues ne se préoccupe que très peu de normalisation, sans pour autant en méconnaître l’intérêt et les ressorts, mais il semble articuler naturellement son parler maternel avec les formes les plus communes du languedocien, parler hybride, car aux limites du limousin et du nord-occitan. Ce fait devient éminemment poétique, car très tôt, et une analyse linguistique fine de ses poèmes le montrerait, la langue qu’utilise Lesfargues se pare d’une naturalité sans qu’elle soit surfaite, encore moins surjouée, mais considérée à l’aune d’une exemplarité naturelle qu’on ne peut ni on ne doit contester. C’est un fait qu’il faut remarquer : face aux tentatives de Lafont, de Manciet – qui se débat avec la constitution d’une langue littéraire beaucoup plus que Lafont qui, en ces premiers temps, a à sa disposition la langue félibréenne – ou même de Félix Castan, beaucoup plus « centralisateur », Lesfargues ne se pose pas les mêmes problèmes, du moins en apparence, car il apparaît les avoir résolus par cet aller-retour permanent entre la tradition et la langue « haute », celle des troubadours, des grands classiques catalans, puis la variété vernaculaire locale, bergeracoise, qu’il inclut dans ses premiers poèmes comme un élément de plus, de telle sorte que l’un ne semble pas aller sans l’autre, dans une dialectique de ce que nous nommons, à la suite du titre d’un de ses poèmes, « le temps mesuré ».
Autre remarque préliminaire, celle de la forme et de l’ampleur poétique. Si Delpastre, Lafont, Manciet et Delavouët évoluent de plus en plus vers une forme poétique constituée de grands ensembles, de grands recueils thématiques incluant le souci d’une organisation souvent recherchée et d’une cohérence intérieure, la poésie de Bernard Lesfargues ne suit pas ce chemin. Aux premiers poèmes courts et disparates de Manciet, Lafont, Delpastre et Delavouët, apparaît bien vite la structuration d’une œuvre dont le sommet organisationnel semble être atteint par L’Enterrament a Sabres de Manciet ou les cinq volumes des Pouèmo de Delavouët. Lafont semble y arriver quelques années plus tard, bien que La Cantata de la misèria dins Arle (Lafont 1957) 3constitue déjà une approche significative qui sera par la suite confirmée par Lausa per un soleu mòrt e reviudat (Lafont 1984) ou La Gacha a la Cistèrna (Lafont 1998). Bernard Lesfargues à qui je faisais remarquer ce fait m’avait donné une réponse elliptique, en partie véridique, invoquant son manque de temps pour se lancer dans une respiration poétique de longue haleine. En partie vraie, car il me semble aujourd’hui que cette réponse était toute prête, comme un prétexte nécessaire à fournir, afin qu’il n’eût pas à livrer d’autres explications. Risquons une hypothèse : si Lesfargues n’a pas œuvré dans le poème long ou l’organisation structurelle ample, c’est qu’il n’y destinait pas sa poésie qui était faite de mouvements courts, convulsifs, pulsionnels, de fragmentations d’un temps qui ne manque pas de l’obséder mais qu’il restitue par bribes et ne recompose pas dans l’amplitude du souffle. En ce sens, il semble plus proche de certains poètes français, Supervielle, quelques surréalistes ou même Char, de certains Espagnols ou Grecs qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans la longue coulée poétique. Il n’est pas dans sa génération une exception, loin de là, mais il demeure d’entre les plus doués l’un de ceux qui ne se sont pas projetés dans un fleuve poétique ininterrompu. Une simple remarque, mais qui nous entraîne à considérer ce qui est une originalité et plus encore ce qui ressort des mécanismes inconscients de la création poétique.
Cette œuvre poétique est donc constituée de trois recueils publiés de 1952 à 1970 (Lesfargues 1952 ; 1965 ; 1970), de quelques plaquettes reprenant des poèmes antérieurs, y ajoutant parfois des inédits4, d’interventions poétiques diverses5, de l’édition de 2001 qui reprend l’essentiel des poésies déjà publiées, puis de deux autres recueils postérieurs (Lesfargues 2006 ; 2014). La dispersion de sa création poétique permet d’espérer que seule une partie des poèmes écrits ait été publiée et que l’on puisse ainsi retrouver d’autres inédits, car Lesfargues, tout au long de son existence, ne s’est jamais vraiment soucié de colliger tous ses poèmes et de veiller à leur publication. L’avancée que constitue l’édition de 2001 qui reprend les recueils antérieurs et où figurent des inédits a été remarquée, de telle sorte que certains lecteurs ont semblé découvrir un poète qui avait déjà publié depuis près de cinquante ans. La quantité considérable d’interventions de Bernard Lesfargues, que ce soit en Occitanie ou en Catalogne où, à la fin de son existence il était également questionné au sujet de son œuvre poétique, doit nous interroger, car il semble que se trouve là une forme de retour inévitable vers le centre d’une création littéraire dont il faut bien poser le rapport qu’elle a entretenu avec ses autres activités, notamment la traduction6. Nous sommes donc en présence d’une œuvre dispersée, comme cela est souvent le cas dans la littérature occitane, et une véritable bibliographie, qui devrait également prendre en compte les publications en revue, est un travail des plus urgents mais aussi des plus difficiles7.
Bernard Lesfargues a choisi de placer en en-tête de la somme poétique de 2001 un poème qui avait déjà trouvé place dans Cap de l’aiga en 1952 et qui s’intitule Brageirac, retour aux sources d’un centre perdu :
Brageirac sus la Dordonha,
Brageirac del mes de mai,
te perdèri per jamai
amb l’amor e la vergonha.
Tot me causa marriment,
quela lutz que m’emperleja,
quel remembre que trepeja
al còr tèbie del printemps (Lesfargues 2001, 13)8
Bergerac, sur la Dordogne,
Bergerac du mois de mai,
Je te perdis à jamais
avec l’amour, avec la honte.
Tout me blesse :
cette lumière de perle,
ce souvenir qui trépigne
au cœur tiède du printemps.
Ce qui pourrait être interprété comme une évocation nostalgique du pays natal est plus complexe. Dans l’introduction à la plaquette Brageirac e autres luòcs (Lesfargues 1993), Lesfargues précise sa pensée :
J’aime la nommer. Et, la nommant, je l’exalte, je la façonne à ma guise, je la rêve et la recrée. Et ainsi je me l’approprie. (Lesfargues 1993, 8)9
Cette dérive au fil du Nom, tout comme le fleuve et son cours maintes fois évoqués, provoquent l’irruption d’une confrontation entre la réalité du souvenir et la transposition, la recomposition nécessaire, de telle sorte que l’invocation du Nom nourrit une impression poétique dont Lesfargues n’est pas dupe et qu’il fait sienne : les verbes « façonne », « rêve » et « recrée » soulignent cette distance indispensable qui se noue dans l’appropriation. Nous sommes ici loin de la nostalgie vécue du pays natal et de l’exaltation du terraire, mais plus proche d’une poétique du Nom telle que Proust l’a illustrée ; pour ces raisons, il convient de parler de dérive, car le poème s’établit sur la comparaison entre la perte et le cours du fleuve, symbolisation classique du temps qui passe, toute une œuvre s’appuyant donc sur l’origine recréée et nécessairement fantasmée du lieu. Cette acceptation du phénomène poétique de la recréation de l’espace natal consentie et même revendiquée par Lesfargues lui permet de fuir les poncifs félibréens de la relation à la terre conduite par une exaltation maternelle ; pour cette poésie, l’essentiel est ailleurs, justement dans l’écart que le souvenir tisse avec une réalité que le poète ne tente pas de reconstruire entièrement, mais dont il accepte la distance ainsi affirmée malgré lui, et s’il ne peut pas tout à fait s’en assurer le contrôle, il se l’approprie afin de jouer de façon permanente avec cet intervalle spatial et temporel. Ainsi, de nombreux poèmes écrits à Lyon, dont le célèbre Diga-li Ròse (Lesfargues 2001,110-113), établissent cette poétique de la distance permettant au poète de jouer sur un espace qui tend, sous l’action de la force de la pensée, du souvenir et de l’incantation, de soudainement se réduire et au temps de se suspendre, le verbe se transportant en quelque sorte et devenant lui-même telle la parole d’un démiurge qui entendrait se soumettre à sa seule incantation. Ainsi, les fonctions multiples du fleuve et les pérégrinations d’Ulysse et de Don Quichotte dont Philippe Gardy relève avec pertinence les récurrences (Gardy 2019), peuvent être comprises comme des errances multiples, le Grec retrouvant finalement après de nombreuses péripéties ses rivages, le chevalier à la triste figure se complaisant dans une course folle en poursuivant ses propres chimères, le poète revenant ici, métaphoriquement, dans les lieux d’enfance et de jeunesse qu’il recompose à loisir. Toute la poésie de Bernard Lesfargues s’initie donc sur ce qui pourrait sembler un paradoxe, mais qui ne l’est pas : elle se dégage au contraire des contraintes d’une tradition liant la langue au terroir, et afin de pouvoir s’en échapper, elle établit fantasmatiquement – au sens étymologique d’image – une relation avec l’espace et le temps qui lui permet de loger le poème dans un temps autre où prennent place les notations intimes d’une réalité vécue, mais nécessairement transfigurée. De ce point de vue, ce que nous évoquions au sujet de l’utilisation de la langue dans ces poèmes, cette liaison libératrice entre les formes d’une variété locale et la norme, institue une puissance qui rappelle l’inscription dans le lieu sans qu’elle y soit enfermée. Dans ce court extrait de Brageirac, l’élision du a initial dans « quela » et « quel » caractéristique de ce parler et redevable aux franges limousines où il est également présent, ne produit pas un effet purement local, mais se coule dans l’évocation de la fragmentation du souvenir en images, comme si la langue elle-même hésitait entre ce qui est établi dans la phonétique d’un parler, ce qui est noté et reviendrait à la mémoire comme miettes d’un passé révolu mais transfiguré.
En d’autres poèmes, cette transfiguration semble achevée et produire elle-même les formes d’une poétique du souvenir acceptée comme présence d’un passé révolu, mais que la seule évocation peut faire renaître dans la douceur de l’image :
Tota la patz del ser
rota per vent sadol
que pòt pas eissicar
l’aiga mòrta del cel.
E çò qu’en ieu demòra
coma un rebat de sòmni
es la votz d’un mainatge
votz tan pura que fai
timidament tinlar
lo cristal sorne un pauc
de desjà vièlhs remembres. (Lesfargues 2001, 44-45)
Toute la paix du soir
brisée par le vent ivre
qui ne peut pas déchirer
l’eau morte du ciel.
Et ce qui demeure en moi
comme un reflet de rêve
c’est la voix d’un enfant
voix si pure qui fait
timidement tinter
le cristal un peu dépoli
de souvenirs déjà vieillis.
Cette distance invoquée et réduite par l’existence du poème se noue singulièrement aux évocations catalanes qui constituent l’essentiel de la suite Siuranencas publiée dans Còr prendre en 1965 et qui se réfèrent à Siurana, le village où résidait Joan Sales, l’auteur d’Incerta glòria que Lesfargues avait traduit en 196210. La lettre adressée à son ami romancier et à son épouse figure comme une tentative de rapprochement où l’espace et le temps s’effaceraient afin de transporter le lecteur d’un lieu à l’autre par la seule présence de la parole poétique :
Aquí las teuladas son blancas de nevèia.
E vos, Núria e Joan, digatz-me
lo temps que fai a Siurana la nauta.
Digatz-me se s’encapucha lo Montsant
o se, de l’un a l’autre asuelh, espelís
una vasta flor de cèl.
Digatz-me se fai freg dins los carrierons,
se bufa un vent borrut d’agulhas,
se fai clar dins los carrierons a ran de cèl.
Es lo silenci coma una granda tor mastada sus la ròca,
una eisubida tor de cristal e de gial ? (Lesfargues 2001,74-75)
Ici, les toits sont blancs de neige.
Et vous, Núria et Joan, dites-moi
le temps qu’il fait à Siurana la haute.
Dites-moi si le Montsant s’encapuchonne
ou si, de l’un à l’autre horizon, s’épanouit
une vaste fleur de ciel.
Dites-moi s’il fait froids dans les ruelles,
si souffle un vent hérissé d’aiguilles,
s’il fait clair dans les ruelles au ras du ciel.
Le silence est-il une grande tour dressée sur la roche,
une impalpable tour de cristal et de gel ?
Cette fonction du double sur laquelle insiste Philippe Gardy est ici présente dans les « asuèlhs » découpant l’espace, échos de différents horizons, tout aussi bien ceux de Siurana que ceux du lieu de la création du poème, transposition de l’un vers l’autre, et fusion des temps et des espaces. Le poème est ainsi transport, mais plus largement vecteur de fusion souhaitée et organisée par le poète, de telle façon que cette appréhension de l’espace s’organise comme menée par une perpétuelle ductilité, invoquant les lieux pour mieux les configurer, ne les confondant pas tout à fait, mais élaborant dans le creuset du poème un méta-espace poétique dans lequel se réduisent les distances pour par la suite s’établir à nouveau, force d’institution d’une brisure du temps et de l’espace par lequel le poème s’est glissé et où le lecteur fut emporté.
On pourrait gloser sur cette poétique et essayer d’en dégager les lignes de forces et surtout d’en mesurer les effets pour ensuite en déterminer les raisons fondamentales. Il serait indispensable de s’y aventurer, mais cela n’est pas de notre propos11 et demanderait beaucoup plus de place et d’ampleur. Quelques remarques cependant. Il serait intéressant de repérer, dans les œuvres que Bernard Lesfargues a traduites, des fonctionnements similaires et tâcher de montrer comment, d’une langue dans l’autre, le traducteur a pu les restituer. Il serait également important de repérer dans ces mêmes traductions des poétiques proches, notamment sur l’espace ressenti et sur le temps suspendu, comme chez Àlex Susanna où l’attention aux choses « minuscules » ou « sans importance » de la banalité des jours produit un effet de suspension temporelle. D’autre part, il faut bien, de façon théorique, rapprocher cette poésie de ce que Bachelard a maintes fois évoqué dans bon nombre de ses ouvrages : rêveries sur l’eau, les songes, le feu – évoqué chez Lesfargues par la braise et les flammes donnant le titre à l’édition de 2001– ; on pourrait ainsi définir un Bernard Lesfargues attentif aux théories bachelardiennes – nous ne doutons pas qu’il les connaissait – et plus largement aux évocations poétiques d’un post-romantisme qui se serait débarrassé des clichés du genre. On pourrait ainsi, dans la littérature occitane, repérer ce qui serait de l’ordre de cette « commune présence » entre tous ces poètes, et ce hors de toutes contingences, Lesfargues se trouvant ainsi parfois proche de son ami Bernard Manciet ou de Mas-Felipe Delavouët qu’il avait lu mais qu’il n’a jamais fréquenté. Eau, celles du fleuve et des aigas mòrtas des étangs, ciels découverts, bruissement du temps, présence entêtante du souvenir constituent donc la première nature des éléments de cette poésie qui, tout en se référant au lieu, l’inscrit dans un imaginaire poétique singulier, toujours lié à la réappropriation et à la réécriture de soi et de ses souvenirs.
Brageirac ouvre l’œuvre en 2001 et la Cançon de Bernat lo marrit la clôt. Ce poème, qui avait fait l’objet de plusieurs traductions lors d’un exercice dédié au poète (Fauthoux 2007)12, s’inspire d’une poétique troubadouresque où l’on retrouve des termes et des images médiévales – le planh, l’oiseau, le vautour, le cœur désespéré… –, mais où le lieu ici nommé, la ville d’Ujué en Navarre, est le réceptacle, le reliquaire serions-nous tenté de comprendre13, d’un amour enfui et d’un cœur abandonné. Les éléments extérieurs, vents, tempêtes, détruisent les arbres et sont à l’unisson du désespoir qui saisit le poète quand, son cœur délaissé, il sombre dans le désespoir :
Ai daissat mon còr
mon còr de palomba
ai daissat mon còr
alai en Navarra
dins uno vilòta
que dison Ujué.
Dins aquela vila
bufa lo vent fòl
i ai daissat mon còr
mon còr de tortora
alai dins la glèisa
al ras de l’autar.
Dins la glèisa udola
un vent fèr e fòl
ai daissat mon còr
dins un reliquari
de coire e d’argent
mon còr de colomb.
Mon còr mon ametla
veusa de ma sang
mon còr de tortora
que jamai rocola
ai perdut ta pena
oblidat ton planh.
T’a pres l’auselaire
e barrat amb clau
dins un reliquari
còr meu un auvari
colomb sens rocó
còr sens baticòr.
Polida la gàbia
e bèla la glèisa
defòra lo vent
bassaca l’aubrum
e la cossa plana
dins lo revolum.
La cossa que fai
paur a l’auceliha
e vòl t’emportar
mon còr ma tortora
mon ametla eissucha
ma vida marcida.
Que vòl te gafar
pura meravilha. (Lesfargues 2001, 222-225)
J’ai laissé mon cœur
mon cœur de palombe
j’ai laissé mon cœur
là-bas en Navarre
dans cette petite ville
qu’on appelle Ujué.
Dans cette ville
souffle le vent fou
j’y ai laissé mon cœur
mon cœur de tourterelle
là-bas dans l’église
auprès de l’autel.
Dans l’église hulule
un vent sauvage et fou
j’ai laissé mon cœur
dans un reliquaire
de cuivre et d’argent
mon cœur de pigeon.
Mon cœur mon amande
veuve de ton sang
mon cœur de tourterelle
qui plus ne roucoule
j’ai perdu ta peine
oublié ta plainte.
L’oiseleur t’a pris
et t’a enfermé dans un reliquaire
mon cœur quel désastre
pigeon silencieux
cœur qui ne bat plus.
Jolie est la cage
et vaste l’église
dehors la tempête
matraque les arbres
et le vautour plane
dans les tourbillons.
Le vautour qui fait
peur aux passereaux
et veut t’emporter
mon cœur ma tourterelle
mon amande sèche
et ma vie flétrie.
Qui veut t’emporter
ô pure merveille.
Ujué, Navarre
Adbar, CC BY-SA 3.0
Cette présence du corpus du trobar ne s’inscrit pas dans un jeu de contrefaçons, mais nature le poème de telle façon que les allusions reconnaissables sont incluses dans un propos pérenne, celui du cœur égaré, et dans des formes rappelant parfois, par les procédés anaphoriques, l’insistance médiévale à la sanction et l’affirmation. Des vers entiers, répétés, parfois en totalité, des mots revenant sans cesse et la séquence où le poète affirme qu’il a laissé son cœur produisent un effet répétitif qui jamais ne lasse, comme dans une sextine, cette cançon devenant emblématiquement, car elle se situe à la fin du recueil, le reliquaire où le livre et le cœur se confondent. Bernard Lesfargues semble ainsi déposer une parole sous les auspices des troubadours qu’il convoque plusieurs fois en d’autres lieux, comme dans ce Poèma de pas res qu’accompagne la citation de Guilhem de Peitieu, « Farai un vers de dreit nien » dont on sait qu’elle est fondatrice du Trobar, mais aussi d’un savoir endopsychique sur l’acte et les mécanismes de la création. Ici, le temps est brièveté, réduit à quelques pieds du vers, temps rétréci qui n’est pas de longue haleine, mais se brise à la fin de chaque séquence pour revenir inlassablement jusqu’à la forme de l’envoi des deux derniers vers. Entre espace et temps, se joue donc dans cette poésie un jeu subtil qui entend dénouer les fils d’une contradiction et d’un dilemme posé à l’Être : les contingences physiques et biologiques ne semblent pas effleurer la parole poétique ou plutôt, enfermée dans le reliquaire, elle semble défier les pouvoirs réducteurs et sectaires de l’espace et l’ineffable pression du temps. La seule façon d’en limiter les effets est de se séparer, au moins mentalement, par le jeu de l’épiphanie poétique, des contraintes subies ou de croire que l’on peut le faire à l’aide de la permanence du poème, de sa conjonction d’éternité, de la transcendance que la langue hausse vers le silence.
C’est dans trois courts poèmes, ensemble intitulé Poèmas del temps mesurat, que s’exprime peut-être avec plus de force cette inéluctable lutte que le poème entend livrer (Lesfargues 2004, 8-13). Toujours en inspiration troubadouresque le premier poème sonne comme un terrible constat :
Lo temps vai e ven e vira
e ieu veni e ieu m’en vau
tras las ròsas de la prima.
Es plan mòrt lo temps de prima
mai l’estiu. Cresetz que vau
cantar çò que me desvira ?
Mas la tarda encara vira,
vai e ven, e lèu lèu vau
m’entraupar dins quela prima
qu’en invern sempre se vira. (Lesfargues 2004, 8-9)
Le temps va et vient et vire
et moi je viens et je m’en vais
après les roses du printemps.
Il est bien mort le printemps,
l’été de même. Croyez-vous que je vais
Chanter ce qui me ravage ?
Mais le soir encore vire,
va et vient, vite je vais
m’empêtrer dans ce printemps
qui en hiver toujours chavire.
Le second, reprenant la même forme strophique, revient sur le thème de l’effondrement dans le temps, approche de la vieillesse et des heures qui ne sont accordées que parcimonieusement :
Canta que cantaràs, lo temps
deminga, demesís, la resta
es rosigada : un an o dos…
Te pòdes repausar sul doç
coissin d’un còs aimat, la fèsta
es per tu clavada. Content
que siás o pas, te cal, prudent,
apasimar tas malonestas
fèbres. Estima-te urós
d’aver lo còr nafrat, malgrat lo temps. (Lesfargues 2004, 10-11)
Tu as beau chanter, le temps
diminue, s’amenuise, ce qu’il en reste
est grignoté : un an ou deux…
Tu peux te reposer sur le doux
coussin d’un corps aimé, la fête
est bien finie pour toi. Que tu sois
content ou pas, prudence,
Calme tes malhonnêtes
fièvres, estime-toi heureux
d’avoir, malgré le temps, le cœur blessé.
Quant au troisième, il réédite les formes de la douleur du départ, le manque de ce temps qui justement nous broie, mais octroie encore quelques instants de calme pour que le poème puisse reprendre son envol :
A pena ai agut lo temps de viure,
la mòrt s’engulha dins ma clòsca.
Lo temps me manca per morir.
Bela vita, ailàs ! bel morir,
a degun donarai ma clòsca,
dieu e diable me daissen viure !
Per morir ai trop aimat viure
e per viure asirat morir.
Qu’es aquò que bul dins ma clòsca ?
Tròp me manca lo temps de viure ! (Lesfargues 2004, 12-13)
À peine ai-je eu le temps de vivre,
la mort s’invite dans ma tête.
Le temps me manque pour mourir.
Belle vie, hélas ! beau mourir,
je ne donne ma tête à personne,
dieu et diable me laissent vivre !
Pour mourir, j’ai trop aimé vivre,
pour vivre, trop haï la mort.
C’est quoi, ce qui bout dans mon crâne ?
Qu’il me manque le temps de vivre !
Deux lectures peuvent être invoquées : la première, immédiate, est celle de l’écoulement du temps qui conforme le poète aux regrets d’une vieillesse redoutée et néanmoins présente – Lesfargues a près de quatre-vingts ans quand il écrit ce poème – ; la seconde institue un dialogue avec le temps qui devient de plus en plus « mesuré », non seulement parce qu’il serait compté, mais également parce qu’il convient d’en repérer les strates et les sanctions. Ainsi, le fil des jours qui déterminent le temps devient ce chemin qu’il est nécessaire d’emprunter tout en scandant le temps, en lui donnant la mesure dont il a besoin afin que l’on puisse le nommer. Les saisons se succèdent dans un rythme effréné où seuls le printemps et l’hiver prennent place ; le temps qui reste, s’il semble se rétrécir, est aussi celui du poème qui s’écrit, comme si l’œuvre appartenait déjà au passé. L’œuvre, peut-être, mais par le fait même de la création retrouvée et par l’incantation adressée au temps, la force de la parole poétique reprend ses droits pour dire finalement que si « la fèsta / es per tu clavada » il faut s’estimer heureux d’avoir « lo còr nafrat ». Cette blessure du cœur, celui abandonné à Ujué, celui des troubadours et des poètes espagnols, Cernuda et Machado notamment, celui déposé aux rives des fleuves est de surcroît celui de la poésie, de tous les poèmes. Paradoxalement, c’est par cette souffrance que le poème se fait jour, s’établit et que la parole prend enfin son envol. Nul dolorisme ostentatoire, mais une évidence que l’on ne peut nier : la parole poétique est un corollaire de la douleur d’être des « còrs nafrats » et par l’effet du dire, si nul apaisement est pérenne, l’énonciation vient à point afin d’exister. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à la première lecture, ces trois poèmes regroupés sous un même titre ne sont pas des vers trahissant un désespoir ; s’ils expriment une douleur face au temps qui désormais devient plus court, ils sont les témoins, par l’établissement et la force de l’affirmation, du souffle primordial de la poésie qui se love dans une éternité retrouvée.
Ces quelques éléments de réflexion sur la poésie de Bernard Lesfargues ne sont que peu de choses et il conviendrait qu’ils soient poursuivis par d’autres analyses, bien plus profondes. Relevons toutefois que certains motifs, certains thèmes reviennent constamment dans cette œuvre. Philippe Gardy en a relevé quelques-uns ; ils concordent avec nos intuitions, car ce ne sont que des intuitions que nous entendons livrer ici. Aller plus loin, cela serait se confronter avec un texte poétique qui pour nous est indissociable de l’homme qui en fut le créateur. Nous pouvons douter de notre capacité à mener une telle critique. Mais ce dont nous ne doutons pas, c’est de l’intérêt et de la valeur de cette poésie qui, sans bruit, sans effets tonitruants, s’est installée patiemment dans la littérature d’oc et nul doute que ce sera pour très longtemps.