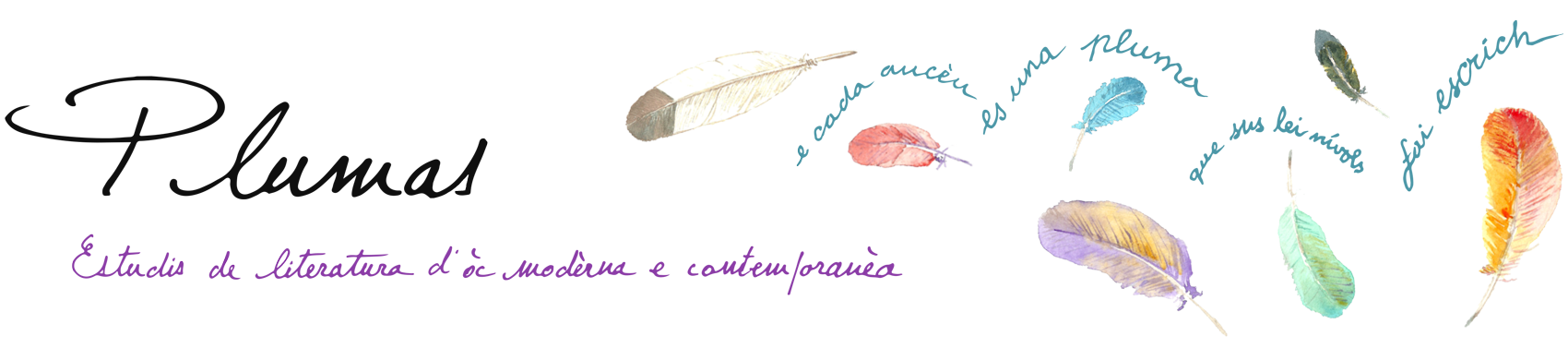Dans une partie intitulée « Le corps et les sens, modalités premières d’être au monde » de son étude Joan Ganhaire. Entre rire et désespoir, un regard occitan sur l’humaine condition, Fabienne Garnerin a noté :
C’est par le corps et les sens que l’auteur fait entrer le lecteur dans son espace imaginaire, dans un monde de l’action lié à l’immédiateté des sensations. Plutôt que de procéder à des explorations psychologiques complexes, l’auteur choisit de donner à lire des signes perceptibles, matériels, dont l’ensemble fait sens (Garnerin 2022, 62).
Cette invitation à prendre conscience de la démarche de l'écrivain incite à une lecture ou relecture attentive du monde dans l'œuvre publiée de Ganhaire. Depuis Lo libre dau reirlutz (1979) jusqu'à Enquestas a la lesta (2023) et tout récemment Lo Pacient espanhòu et Meschant temps Maraval ! (2024), il a exploré de nombreux genres littéraires : chroniques, nouvelles et romans fantastiques, récits de cape et d’épée, romans policiers. Aux paysages naturels et bâtis inclus dans l’espace linguistique du nord de la Dordogne se sont ajoutés dans cette œuvre divers lieux d’Aquitaine, du sud de la France et des incursions dans le pays d’oïl et dans divers pays d'Europe, d'Afrique ou d'Asie... Ses narrateurs prennent parfois part à l’intrigue comme dans les premières nouvelles du libre dau reirlutz (1979) et celles du Viatge aquitan (2000) ou, plus longuement, dans Lo Darríer daus Lobaterras (1987) avec Joan de l’Arribiera, dans Dau vent dins las plumas et Las islas jos lo sang (1992 et 2006) avec Joan Francesc Barnabèu Segur de Malacomba ou avec Júlian Vernhanegre des Enquestas de pas creire de Gaëtan Caüsac daus Ombradors (2021) et du dernier Meschant temps Maraval ! (2025)... Mais le narrateur est parfois absent de l’action racontée, si bien que de brefs commentaires directs ou indirects s’immiscent pour éclairer le caractère des personnages en focalisation interne. C'est le cas pour le commissaire Darnaudguilhem des romans policiers de Sorne Trasluc (2004) jusqu’aux Enquestas a la lesta (2023). Certains noms de personnes dépassent le cadre d’un ouvrage : Darnaudguilhem peut à la fois faire écho à Arnaud (Lo darrier daus Lobaterras) et à l’adolescent Guilhem Mercat de la famille des Malvernha (« Lo Sendareu daus genebres » [Le sentier des génévriers], nouvelle du Viatge aquitan). Finalement, dans Enquestas a la lesta publiées en 2023, le narrateur rejoint le créateur des deux Cronicas de Vent-l'i-Bufa [Chroniques de Vent-y-Souffle] de 1995 et 1999 et des nouvelles du Viatge aquitan de 2000. Ce labyrinthe narratif nous entraîne dans une aventure unique à travers les espaces construits par l'écrivain Ganhaire, entre variations et constantes. Nous proposons ici quelques incursions dans ce paysage littéraire qui se révèle grâce aux noms réels de nations, métropoles ou fleuves mais aussi grâce à des toponymes plausibles de petites villes, villages ou hameaux inventés... Notre contribution à l’analyse de cette œuvre qui associe souvent violence et douceur, regard critique et bienveillance nous a été suggérée par la lecture de la thèse de Fabienne Garnerin et celle de l’ouvrage de Lionel Dupuy, L’imaginaire géographique. Essai de géographie littéraire (2018) où le chercheur invite à essayer de « comprendre comment l’espace est au cœur des différentes stratégies de saisie de la réalité par le biais de la littérature » (Dupuy 2018, 48). Au fil des romans et nouvelles de Ganhaire, l'imaginaire tantôt tourmenté et tantôt ébouriffant de Vent-l'i-Bufa va accompagner des personnages parcourant de nombreuses zones urbaines et rurales. Tous les paysages traversés aux rythmes des heures et des saisons sont riches en mentions de la végétation et parfois du monde animal. En périphérie des villes et villages, Ganhaire nous guide aussi régulièrement dans des cimetières à la recherche de clés de ses énigmes policières au-delà de la mort individuelle. Et, contrebalançant une atmosphère qui pourrait être morbide, nous remarquerons finalement le plaisir de l'écrivain évoquant des langues comme autant de traces d'histoire de vies confrontées à la dépréciation et à l'oubli.
Imaginaire de Vent-l'i-Bufa
Le vent est un élément qui rend l'immobilité impossible : il suscite ou parfois freine le désir et l'action de voyager. Présent dans tous les livres publiés par Ganhaire, il apporte l'idée générale d'un mouvement, d'une vitalité mais aussi d'un désordre difficile à maîtriser et la perspective d'une lutte face à d'imprévisibles déchaînements.
Le vent : titres et dénominations
Le narrateur des Cronicas de Vent-l'i Bufa et des derniers récits d'Enquèstas a la lesta demeure dans une maison en haut d'une colline de haute-Dordogne exposée aux quatre vents : Vent-l'i-Bufa. Les titres rappellent régulièrement son influence : Cronicas de Vent-l'i-Bufa I et II héritées du genre des nhòrlas parues dans le bulletin intercommunal Ventador de 1978 à 1983. Le titre du roman Dau vent dins las plumas qui fait allusion aux plumes des chapeaux des mousquetaires et peut aussi être une métonymie désignant les écrivains, notamment les écrivains occitans, qui n'ont pas opté pour le dynamisme de l'écriture de romans d'action comme l'a fait Ganhaire. Et au niveau des intrigues, on note que le vent est tout particulièrement incarné par les gens du voyage qui sont les principaux protagonistes de La Mòrt que va mai redge que lo vent (2018).
On le croise aussi au fil des déplacements des personnages. L'hôtel du Vent de Mar est le dernier séjour de Barnabeu revenant chez lui après une jeunesse aventureuse dans Las Islas jos lo sang. Avant d'en finir avec leur enquête, le commissaire Darnaudguilhem et son auxiliaire Diagana Traoré logent à l'hôtel du Vent de sable (2020) à Osma Bendar, capitale d'une ancienne colonie occitane du Mali. Enfin, le frileux comte Gaëtan Caüsac, ancien commissaire devenu détective privé, habite au château des Ombradors, que ennaut de lor terme, son virats aux quatre vents [le château des Ombrages, qui en haut de leur tertre sont exposés aux quatre vents]1.
L’omniprésence du vent : quelques interprétations
Le vent peut être un élément fécond et libérateur. C’est le cas dans les Cronicas de-Vent-l'i-Bufa2 où il incarne les opinions versatiles des électeurs du village de Chantagreu et un rôle de messager dès les premières lignes de « Soletat », une nouvelle extraite du Libre dau reirlutz. La nuit, le vent transporte les quatre hululements d'hommes depuis le nord (Giraudon), depuis l'est (Puei Negre), depuis l'ouest (Mironcelas) et depuis le sud (Puei Jobert) où se situe la maison d'un narrateur aussi solitaire que les trois autres personnages. Ils se mettent à échanger malgré leur différence d'instruction et de position sociale (paysan, intellectuel...). La créativité de l'écrivain Ganhaire semble avoir été stimulée par les voix nocturnes d'hommes-chouettes qui échangent sans se reconnaître quand ils se croisent à la lumière du jour. L'imaginaire de l'écrivain d'une langue occitane en danger n'a cessé d'envoyer ses personnages dans les différentes directions des vents majeurs (le pluiau venant de l'ouest ou du ponent, l'áutan venant de l'est ou du levant, le matachabra, du nord-ouest, le vent negre du sud-ouest). C'est ainsi qu'il leur a fait accomplir leur destinée, qu'elle se révèle heureuse ou malheureuse.
La colère des vents contraires du mois de février bouleverse le hameau de Perdilhòta des Braves jorns de Perdilhòta (2013) qui est situé entre Vent-l'i-Bufa et Puegpeirós. Le paysan Maxime et sa mère Zélia se protègent des éléments en s'enfermant dans leur cuisine. Silencieux, ils écoutent les sifflements du vent sous les portes, les gémissements des tilleuls et les gifles de la pluie3. Un jour, une rafale emporte le béret du fils dévoué, étouffé par sa mère et sa sœur. C'est qu'il commence à s'intéresser à l'infirmière qui vient soigner sa mère malade. Libre enfin, le béret de Maxime entame une course folle vers la rivière de la Claraiga. Mais alors qu’il arrive au milieu d'une bande de corneilles, celles-ci vont le trouer à coups de becs. Maxime va donc être obligé de porter le béret des grandes occasions que sa mère conservait soigneusement dans un tiroir, celui qui serre sa tête et l'empêche d'être lui-même.
Dans Las Islas jos la sang, le vent du large régénère. Comme les aventures dans les déserts, les bois et les cavernes, la navigation en mer offre un grand potentiel d'investissement de l'imaginaire : le vent tiède et léger siffle agréablement dans les cordages et gonfle les voiles du bateau. À la fois symboliquement et réellement, le vent peut nettoyer le ciel brumeux et balayer l'horrible puanteur des cadavres (d'une esclave noire et de son enfant) sur le pont d'un bateau négrier4.
Le vent et le bouillonnement créatif
Complice de l'artiste, source de bouillonnement créatif, le vent exige de la sincérité de la part de l'artiste. Dans le roman Rendetz-vos au cementeri (2022), le commissaire Darnaudguilhem adopte la pose du poète avec une écharpe blanche pour donner le change et se promène le nez au vent en faisant mine de chercher l'inspiration. Il résoudra son enquête mais lui, qui aurait pourtant tellement à raconter, n'écrit pas une seule ligne pendant sa mission à Beauséjour, village de bungalows au bord d'un lac. L'enquêteur se protège d'ailleurs des rafales du vent avec un épais gilet tricoté par sa mère adoptive, une parka doublée et une casquette5. Il n'est pas un poète romantique et il apprécie peu le village de Mandelon où, en ce mois de mars en principe printanier, il est réduit à l'inaction. Cette inaction est marquée par un vent qui n'arrive pas à balayer les brumes du fond de la vallée où se situe une vieille fonderie, autrefois active et aujourd'hui à l'arrêt.
Le vent est donc moteur de recherche et d'action. Quand un vent se lève à Maraval, la ville où le commissaire Darnauguilhèm vit et exerce son métier, c'est le vent de l'excitation : ceux du commissariat s'affairent quand de nouveaux éléments permettent de faire avancer une enquête. Pour Ganhaire, le contact avec le vent est une véritable expérience sensorielle. On sait si le vent tourne quand il porte le son des cloches de tel village plutôt que de tel autre. Le vent n'est pas seulement une force extérieure, on le retrouve, tantôt violent, tantôt apaisé, dans le corps des hommes toujours plus ou moins tourmentés. Dans le Viatge aquitan, la poitrine de l'adolescent Guilhem du « Sendareu daus genebres », qui cherche à se rapprocher d'un jeune médecin, nous parle à la fois du malade dont l'avenir est sans espoir et de celui qui va être interpellé et perturbé par lui au point de se laisser finalement séduire puis happer par sa fragilité :
Mai sens mos estruments, auviá los bruchs desordonats, los bufes rauches e piulants que fasián de ta peitrina una cava estranja onte de las ressacas luchavan contra daus vents furiós6.
[Mais sans mes instruments, j'entendais les bruits désordonnés, les souffles rauques et sifflants qui faisaient de ta poitrine une grotte étrange où des ressacs luttaient contre des vents furieux.]
Le vent et l'impossibilité d'oublier
Le vent apparaît comme une force de résistance à l’oubli quand Joan, le narrateur et ami du violent Arnaud du Darrier daus Lobaterras, veut gommer le traumatisme d'un événement du passé. Alors qu'il vient de déchirer le parchemin où est représentée la naissance de son ami – une sorte de double de lui-même –, et qu'il veut enterrer ce parchemin dans le désert, un souffle intervient :
Davant ieu, liberat de mas mans mòrtas, lo perjamin ignòble fremissiá jos lo bufe leugier de l'aura, coma si, non content de las orrors que portava, lor aguès enquera vougut donar un semblant de vita7.
[Devant moi, libéré de mes mains mortes, le parchemin ignoble frémissait sous le souffle léger de la brise, comme si, non content des horreurs qu'il portait, il eût encore voulu leur donner un semblant de vie.]
Enfin, Ganhaire évoque l’absence du vent dans le monde moderne. Pendant les grosses chaleurs estivales, le vent est remplacé par le souffle de l'air conditionné des voitures ou par la rotation des ventilateurs dans les bureaux8. Il ne reste vraiment que le Pòble dau vent [Le Peuple du vent] pour vivre avec le vent et s'estimer vaincu quand il se voit proposé des aires avec d'agréables plantations pour encourager son enracinement et sa sédentarisation9.
Ainsi, dans les récits de Ganhaire, l'élément « vent » domine la vie des personnages, il les stimule et les inquiète à la fois. Se pensant libres alors qu'ils lui sont soumis, peuvent-ils trouver d'autres alliés dans l'espace où ils évoluent ?
La marque de l’homme sur l’espace
Les hommes pensent aussi maîtriser l'espace, cependant l’espace tel qu’ils le perçoivent est le résultat d’une interaction entre eux et la nature. Aussi n’ont-ils pas intérêt à observer et même ressentir avec tous leurs sens leur environnement pour mieux connaître cette nature dont ils sont issus et faire le bilan de ce qu'ils en font ?
L'espace transformé par les hommes
D’ouvrage en ouvrage, les récits guident le lecteur, depuis la nuit des temps (temps suggéré d'avant les premiers villages d'agriculteurs dans Lo darrier daus Lobatèrras) jusqu’à nos jours, dans un espace reconfiguré entre réel et imaginaire. Il n’y a pas d’environnement sans noms de lieux, sans évocations d’événements historiques, sociologiques ou linguistiques qui le transforment. Aux temps des premières abbayes, dans Lo darrier daus Lobaterras, les amis Arnaud et Joan naissaient dans une clairière gagnée sur la forêt. Arnaud, de statut social supérieur, vivait dans une maison fòrta [une maison fortifiée] alors que le second, d’humble extraction, demeurait dans la chabanòta d’un buschairon10 [petite cabane de bûcheron]. La riba dau bòsc [l’orée du bois] des temps anciens demeure dans ce roman de Ganhaire un poste d’observation critique de l’entre-deux : obscurité et mystère vs clarté et rationnel.
Dans les récits qui évoquent notre univers contemporain, l’organisation de l’espace par l’homme reste révélatrice des rapports sociaux. Au fil des siècles, les maisons isolées se sont ainsi regroupées pour devenir des hameaux, bourgs, petites villes capitales régionales et nationales. Dans le paysage des fictions de Ganhaire, on repère presque immanquablement certains bâtiments : château, église ou cathédrale, auberge devenue hôtel, hôpital, orphelinat ou hospice que l’on retrouve aux XXe et XXIe siècles sous les appellations diverses de clinique, hôpital psychiatrique, maison d’accueil spécialisé, lieu ou foyer de vie, maison de repos, maison de retraite…
Le roman Dau vent dins las plumas dont la diégèse se situe au XVIIe siècle, montre la prison aux épaisses murailles, aux cellules sombres et humides du fort du Hâ bordelais où Barnabeu de Malacomba sera enfermé pour un temps11. Et on retrouve dans nos villes modernes une préfecture, un tribunal, une gendarmerie, un commissariat avec quelques cellules, une prison. Les bâtiments sont peu décrits extérieurement mais on peut voir le personnel médical s’affairer dans les hôpitaux ou les cliniques et les policiers s’agiter dans les commissariats. Depuis ces QG, ces derniers vont se déplacer pour le besoin de leurs enquêtes, faisant ainsi un lien entre un monde urbain dorénavant composé de vieux quartiers promis à la démolition12 et de nouveaux quartiers où sont réunis des familles de maghrébins, des roms ou d'autres immigrés plus ou moins récents. Les habitants de strates sociales différentes ne se côtoient plus : les paysans restent dans des fermes souvent en ruine, les nobles vivent dans des châteaux plus ou moins sur le déclin tandis que des bourgeois notables demeurent reclus dans des villas aux noms de fleurs et que des travailleurs manuels, ouvriers et employés modestes ou chômeurs se retranchent dans les petits jardins de leur lotissement. Les autres, saisonniers de passage, mendiants devenus des sans-domicile fixe, hors la loi, délinquants ou carrément mafieux, sont en errance.
La nostalgie du temps de l'enfance
Parmi les bâtiments rarement évoqués, il y a l'école dont la place est loin d'être négligeable dans l'œuvre. Le commissaire Darnaudguilhem ne se sent apaisé que lorsqu’il peut entendre depuis son bureau des enfants qui jouent dans un square. On apprend, au fil des intrigues policières, que le commissaire a aimé l’école par dessus tout quand il était encore cet enfant bastard [bâtard] qu'avait recueilli une famille aimante. Assis dans son vieux fauteuil qu’il fait régulièrement gémir sous son poids, il craint la venue de l’hiver quand sous la fenêtre de son bureau, les grandes feuilles des platanes du square couvrent le bac à sable et que pas un seul enfant ne vient jouer13.
Le souvenir d'une ancienne convivialité est souvent convoqué dans les récits. Ainsi, dans « Lo pes dau sovenir » [Le poids du souvenir], nouvelle du Libre dau reirlutz, le personnage–narrateur sensible au paysage revient dans sa ville après avoir rompu avec sa famille bourgeoise pendant plusieurs d’années :
Qu’era lo prumier còp que ió ávia lo coratge de tornar afrontar la ribiera suausa, las charrieras e los escaliers que monten vers l’eigleija, las plaças claras, que áviam emplidas de nòstras badadas, mos camaradas mai ió, quante nos disputàvem en jugar a las bolas o en tustar dins quauqua pauma. […] La Plaça de l’Ostau de vila era totjorn tant aculhenta, end sos bancs verds ante de las pitas vielhas se pausaven de lur cabàs trop pesant14.
[C’était la première fois que j’avais le courage d’affronter à nouveau la douce rivière, les rues et les escaliers qui montent vers l’église, les places claires, que nous avions emplies de nos criailleries, mes camarades et moi aussi, quand nous nous disputions en jouant aux billes et en frappant quelque ballon. […] La place de la mairie était toujours aussi accueillante, avec ses bancs verts où des petites vieilles se reposaient à cause de leur cabas trop lourd.]
Il est comme un marin qui revient au port où il sait que personne ne l’attend. C’est le mois de mai et il s’immobilise un instant sur un pont pour regarder les quais ensoleillés, la gorge serrée de retrouver les noms familiers de son enfance. Après un sentiment de profonde nostalgie, il va devoir assumer la rupture définitive avec les siens. Ganhaire en profite pour exposer l’écart entre un monde ancien où chacun connaissait chacun et un monde nouveau où la solitude est devenue le lot de tous. On note que les mairies sont peu présentes dans les romans, comme si elles avaient pris une place secondaire dans la vie des bourgs et villes modernes. Dans « Lo pes dau sovenir », en signe de résignation face à l'abolition du passé, la rivière qui emporte tout est personnifiée : Laissí tombar dins l’aiga verda ma cigarreta meitat fumada, que la ribiera acceptet end un pitit chuchetament15. [Je laissai tomber dans l’eau verte ma cigarette à moitié fumée, que la rivière accepta avec un petit chuchotement.]
Les paysages, entre harmonie et traduction de l’angoissante vision de la nature humaine
Dans le roman policier Vautres que m’avetz tuada (2013), un personnage d’institutrice donne à Ganhaire l’occasion de dépeindre un espace harmonieux. Resté du bon côté de la loi, un hiver, le narrateur rend visite à une vieille institutrice dont l’univers contraste avec celui des notables dont les grandes maisons ont des entrées glaciales et des salons meublés d’antiquités. Chez la vieille mademoiselle Ròca, désignée comme un amor de regenta, amor de pita vielha16 [amour d'institutrice, amour de petite vieille], tout est inversé. On passe de la glaciale extériorité du jardin au mois de janvier à la douceur d’un salon où il y a du feu dans une petite cheminée et des aquarelles de jardins fleuris qui éclairent les murs tendus d’un tissu un peu sombre17. Rien à voir avec les villas derrière des grilles de fer forgé au fond de parcs profonds où en bordure de mer qui n’ont de fleuri que leurs noms :
Las Ròsas , Los Tamarís, Los Mimòsas, tota la botanica de luxe i passava. Troberen la villà Lo Mascaret, entre Agapanta e Terebinta18.
[Les Roses, Les Tamaris, Les Mimosas, toute la botanique de luxe y passait. Nous avons trouvé la villa Le Mascaret, entre Agapante et Térébinthe.]
En guise de clôture à son enquête, le commissaire va revenir voir cette mademoiselle Ròca à la fin d’un après-midi d’octobre. Elle est en train de couper des roses fanées et ils parlent de fleurs, du temps si doux pour la saison et de la nécessité de penser aux petits oiseaux en suspendant des mangeoires aux arbres19. Le caractère bucolique de la scène contraste avec la révélation de l’intransigeance de l'institutrice qui avoue n'avoir pas dénoncé une ancienne élève devenue meurtrière après avoir été la victime d’une stérilisation forcée.
Outre ce jardin soigné et paisible, un des paysages les plus harmonieux de l'œuvre se situe à la fin de la nouvelle du « Viatge aquitan »20. Un vagabond transporte depuis le Pays basque jusqu’à Bordeaux son ami Juli, alcoolique et mourant sur un fauteuil roulant attelé à sa bicyclette. Le soleil cogne sans pitié sur la longue route goudronnée, entre les rangées de pins. Juli meurt à Bordeaux mais son ami le ramène tout de même jusqu’au cimetière de leur village où il va l’enterrer pour respecter ses dernières volontés. Il parle alors au mort :
Sabes, Juli, la fin dau viatge vau gaire la pena d’èsser contada. Me fauguet dos jorns per laissar las ribas larjas de Garona e de Dordonha. Puei, los boscs se son barrats sus n’autres : las pitas rotas vironejantas, los termes blus, las combas verdas, lo país daus mila rius, nòstre país21.
[Tu sais, Jules, la fin du voyage ne vaut pas vraiment la peine d’être racontée. Il m’a fallu deux journées pour laisser les larges rivages de la Garonne et de la Dordogne. Puis les bois se sont refermés sur nous : les petites routes zigzagantes, les tertres bleus, les combes vertes, le pays des mille rivières, notre pays.]
Mais l’harmonie est loin d’être majoritaire dans l’œuvre de Ganhaire. Depuis les premiers textes, la violence ne cesse de métaphoriquement couler comme un fleuve. Le narrateur du roman Lo darrier daus Lobaterras, Joan de L'Arribiera qui a suivi son frère de lait, le terrible Arnaud, sous les murs de Saint-Jean d'Acre au temps des croisades, déplorait déjà : Ai sovent purat de quela violéncia colant coma un fluvi que res podiá pas arrestar22. [J'ai souvent pleuré à cause de cette violence coulant comme un fleuve que rien ne pouvait arrêter.]
Les rivières ne sont pas des éléments d'idylles traversant des paysages champêtres. Il leur arrive de transporter des cadavres comme dans « Un brave boiradís de legendas »23 [Un bon florilège de légendes] ou « Quo era pertant un tan brave matin »24, [C'était pourtant un si beau matin]. La désolation a gagné la campagne mais aussi les villes moyennes :
La vielha bela maison semblava presta de s'abasir e faliá pas s'estonar si la municipalitat aviá lançat contra ela un avis de perilh, valent a dire que valiá mielhs la chabar d'esbolhar 'vancès qu'ela tombesse a sa plasença dins lo vergier dau 2325.
[La grande et vieille maison semblait sur le point de s'effondrer et il ne fallait pas s'étonner si la municipalité avait lancé contre elle une procédure de péril, c'est-à-dire qu'il valait mieux achever le processus d'éboulement avant qu’elle ne tombe d’elle-même dans le verger du 23.]
Et peu à peu les fermes se sont, elles aussi, mises à exhiber des murs fendus tout en se recouvrant de lierre, d'orties et des vieux outils rouillés comme au Pitit Maine de Çò ditz la Pès-Nuts (2013). Ces nombreuses maisons, fermes et jardins sont devenus le refuge de personnages isolés, souvent mystérieux et parfois inquiétants26.
Lo darrier daus Lobaterras est introduit par un narrateur appartenant au siècle de l'écrivain. Il précise pourquoi il a décidé de rendre public le récit rédigé sur un parchemin par Joan de l’Arribiera. Il s’agit de regarder les ruines de Merlanda d’une autre façon, non pas avec le regard distrait du touriste mais avec tous les sens et toute la sensibilité qu’exige ce vallon, ces collines, ce prieuré. L’avertissement semble être une demande d’attention bien réelle adressée au futur lecteur27. Selon Ganhaire, il faut adopter un regard d'observateur sans préjugés quand on voyage.
L’ambivalence des espaces naturels
Dans le monde moderne selon Ganhaire, seuls les éphémères vols d’oiseaux font parfois lever la tête du narrateur : volada ponchuda daus martelets28 [vol en pointe de martinets], las gruas passavan… [les grues passaient…]. La Pès-Nuts observe lors longs triangles movents que se torcián coma de las serps29 [leurs longs triangles mouvants qui se tordaient comme des serpents].
Les évocations de l'espace naturel sont mêlées aux actions des personnages et peuvent remplacer des descriptions physiques ou psychologiques. C'est l'art de Ganhaire de narrer en suggérant. Son monde est plausible car il est fait de paysages aquitains ou d'autres régions et pays et est surtout ressenti par les personnages de l'intrigue. Les sensations fugitives, sensations saisonnières et quotidiennes permettent de donner des colorations variées de la peinture des lieux.
La nature, souvent plus forte que les humains dans les récits de Ganhaire, n’est pas toujours harmonieuse ou sereine. Elle peut certes apaiser les traumatismes des victimes, mais elle peut aussi être dévorante et recouvrir à jamais ce que les hommes ont construit. Dès Lo Darrièr daus Lobaterras, la forêt où proliféraient les loups était un lieu de violence qu’il fallait soumettre pour permettre aux gens de survivre. Attaquée, la forêt ne se laisse pas faire30 et l'influence des végétaux et des animaux n'est pas négligeable. Voyons quelques-unes de ces ambivalences.
Une nature compensatrice ou curative
La magique Pès-Nuts et le narrateur de çò ditz la Pès-nuts se sont rencontrés pour la première fois au bas de la maison du Pitit Maine, à La Font de la Baissa où une femme s’est noyée. L’enfant malheureux dont on comprend que la mère s'est suicidée est un Joan-femna de dròlle, un enfant efféminé. Il a beaucoup lu et, de ce fait, il a pu échapper au chemin qui aurait pu le mener vers la délinquance et la violence. Le personnage ayant vaincu ses propres pulsions, le lieu naturel qui aurait pu le rejeter est devenu un lieu tendrement maternel et sacré où il se sent en accord avec lui-même :
Boissí de la man quauquas fuelhas mòrtas, penchení las erbas coma un fai de longs piaus. Puei me passí de quela aiga freja sus los braç, m’esparsiguí la chara e lo còu, e los braç en crotz, m’endurmí dins lo mintrate, demest las fuelhas d’aubar e de saücau. Lo solelh era enquera naut quante torní montar lo sendareu. Entrava per un calustron dins la sorniera de la maison e son rai unic tombava drech sur lo disque lusent dau grand relòtge, que lançava a las parets, dins son lent ninament, secondas de solelh, eslusiadas de temps31.
[J’ai écarté de la main quelques feuilles mortes, j'ai peigné les herbes comme on fait pour de longs cheveux. Puis je me suis passé de cette eau froide sur les bras, j’ai aspergé mon visage et mon cou, et les bras en croix, je me suis endormi dans la menthe, parmi les feuilles de saule et de sureau. Le soleil était encore haut quand j'ai remonté le petit sentier. Il entrait par une lucarne dans l’obscurité de la maison et son rayon unique tombait directement sur le disque brillant de la grande horloge, qui lançait vers les murs, dans son lent mouvement de berceuse, des secondes de soleil, des éclairs de temps.]
Dans son dernier récit du Pacient espanhòu, Ganhaire révèle tout particulièrement le médecin qu'il a été. Les plantes et leur pouvoir curatif y sont mis en exergue dans le journal commencé en janvier 1823 par un jeune médecin. Déodat Passalaiga, proche de l'écrivain qui a étudié et exercé la médecine à Bordeaux et en Dordogne, est un fin connaisseur des plantes qu'il a proposées à des patients dans cette ville dont Ganhaire renomme minutieusement les rues existantes en occitan.
Les végétaux et les animaux apparaissent à l'occasion dans l'espace occitanisé où vivent des personnages des XXe et XXIe siècles. Quelle que soit l'époque, les animaux ne participent pas seulement à un décor, ils animent l'espace et sont des intermédiaires dont Ganhaire se sert pour accentuer sa vision critique de l'humanité et des temps modernes.
Une nature où se côtoient le loup et l'agneau
Le commissaire Darnaudguilhem apprécie Les Fables de la Fontaine – dont « Le Loup et l’Agneau » – , où des animaux anthropomorphisés s’opposent. L'humanité constituée de bourreaux et de victimes vulnérables physiquement et mentalement est au cœur de l'œuvre de Ganhaire avec cette question lancinante : mais qu'est-ce que cet être qu'on dit « humain » ? L'imaginaire bascule parfois dans un fantastique terrifiant marqué par la métamorphose de l’homme en animal. Dans le darrier daus Lobaterras, le jeune Joan voit son frère de lait Arnaud se transformer en loup pour tuer un lièvre :
Tu, la teniàs entre tas dents. Auve enquera lo crasenament que botet fin au bolegadís de la lebre32.
[Toi, tu le tenais entre tes dents. J'entends encore le craquement qui mit fin à l'agitation du lièvre.]
L’imaginaire est associé au magique, qu'il soit horrible ou sensuel : La Pès-Nuts la coneis bien quela terra, que s'i pòt trobar la pus fina marjorana qu'un puesche raibar33. [La Pès-Nuts, elle connaît bien cette terre, car on peut y trouver la plus fine marjolaine dont on puisse rêver]. Le lièvre conteur et confident de l'orphelin de l’assistance publique de Çò ditz la Pès-Nus échappe aux tirs d'un chasseur qui, comble d’ironie, tue son propre chien.
Dans les romans de cape et d'épée et les romans policiers, les animaux occupent souvent une fonction métaphorique ou symbolique : ici, c’est un après-midi qui s’est traîné comme un serpent malade34, là, c’est une ancienne blonde reconnaissable à son manteau de bête35... Et si les animaux sauvages qui vivaient autrefois dans la forêt profonde reprenaient leurs droits ? Dans les campagnes, des animaux domestiques vivent encore mais, dans les villes, ils se font plus rares. Il n'y a que quelques chiens comme celui au pelage roux toujours couché au milieu de la Grand ruá du village de Brusac qui interrompt sa sieste et se lève dédaigneusement quand une voiture arrive puis se recouche au même endroit dès qu’elle est passée36. Il sera finalement adopté par un vieillard ancien orphelin aussi solitaire que lui. Et la vieille Ginette, au tout début de Meschant temps Maraval ! est assassinée dans un parc où elle allait chaque jour promener son petit Gribolha.
Quand on se tourne vers le Causse, la nature devient terriblement hostile. La limite de la nature hospitalière se trouve au hameau de la Negrariá [La Noirceur]. Vient ensuite un paysage qui mène jusqu’à l’enfer de La Talhada [« Le Taillis » mais aussi « La Coupure »] où vit une famille de schizophrènes. On n'en revient pas, surtout aux temps des fortes chaleurs. Là, il n’y a que calhaus pertot, rochiers, fendassas, tot plen de cavas, de cròsas, de ginèbres, de pinhièrs mingrolets, de jarrics ranquenits… [des gros cailloux partout, des rochers, des grosses fentes, des caves en nombre, des creux, des genévriers, des pins maigrelets, des chênes ratatinés] et au plafond d’une grotte, des milliers de pissaratas [chauves-souris] en grappes mouvantes37.
Quelle différence, dans le roman Las islas jos la sang, entre les visions de folie ou de massacres comme ceux des conflits religieux qui ont pour résultat des cordeladas de testas sagnosas que pendilhan au dessús de l’aiga de la Thames [des kyrielles de têtes suspendues qui se balancent au-dessus des eaux] de la Thames38 et la perception première de nòstre país [notre pays] ou de queu país miraudiós [ce pays merveilleux], cette Irlande qui ressemble tant au pays de Haute-Dordogne du narrateur :
Per èsser verd, quo es verd… De chasque costat de nòstra novela rota, de las pradas d’erba grassa fan los delicis de miliers d’auvelhas e l’aiga monta a la gòrja de mai d’un. […] L’aer i es pur e perfumat, e si i aviá pas quela pita plòia fina que se foita sus n’autres sens dire fava avant de laissar plaça a un solelh tèbie e pas tròp sechaire, cujariam marchar en paradís39.
[Pour être vert, c’est vert… De chaque côté de notre nouvelle route, des prairies d’herbe grasse font le délice de milliers de moutons et l’eau monte dans la gorge de plus d’un. […] L’air y est pur et parfumé, et s’il n’y avait pas cette bruine fine qui nous assaille sans interruption avant d’être suivie par un soleil tiède qui ne peut nous sécher, nous aurions l’impression de marcher dans un paradis.]
Or, au fur et à mesure que la troupe à laquelle appartient Barnabèu de Malacomba avance et semble humer un vent d'espérance, elle passe devant un cimetière qui fait frémir40. Le jeune soldat s'apprête alors à être le témoin d’une journée d’horreur : la citadelle de Drogheda en haut d’une petite colline ne sera plus qu’un tas de ruines fumantes et ensanglantées en fin de journée.
Le signe inévitable de la présence du mal apparaît subrepticement là où on ne l’attend pas… Les anciens jardins ouvriers de Maraval le long de la Fonladosa, maintenant entretenus pour la plupart par des vieux en bleus et chemises à carreaux, ont un air rassurant pour Darnaudguilhem et pour le lecteur de l’œuvre de Ganhaire qui donne à voir des êtres humains tantôt terriblement cruels, tantôt particulièrement fragiles :
…passavan lor restant de vita a amistonar daus rengs de monjetas, de cotelons, d’artrichaus, d’inhons, de gòuça, de pompiras, de porradas e tanben de ròsas, de leris, de margaritas…41
[…ils passaient le reste de leur vie à cajoler des rangées de flageolets, de haricots verts, d’artichauts, d’oignons, d’ail, de pommes-de-terre, de poireaux et aussi de roses, de lys, de marguerites…]
Voilà bien un paradis, mais l'homme risque d'en être banni car les tuyaux qui y coulent doucement pour rafraîchir les légumes sont comme autant de serpents de caoutchouc ou de plastique42.
Et la nature risque fort de reprendre ses droits. C’est le cas de l’ortie, un végétal qui semble avoir envahi le paysage et qui apparaît comme un signe du dépeuplement de la Dordogne où certains lieux (maisons, espaces inhabités…) ne semblent plus viables économiquement. Dans le Chamin de Copagòrja [Chemin de Coupe-Gorge], une maison est à l'abandon :
… la maison de mestres d’en debàs dau vilatge, ente aviá trabalhat dins lo parc e lo vergier, era rebonduda jos l’ortruja, lo pudís, e lo liedre qu’aviá quitament fait tombar de la muralha la pancarta « a vendre »43.
[… la maison de maîtres au bas du village où il avait travaillé à l’entretien du parc et du jardin, était ensevelie sous l’ortie, le nerprun et le lierre qui avait même fait tomber de la muraille la pancarte « à vendre ».]
Vécu de l'espace au rythme du quotidien et des saisons
L’environnement n'est pas une image sur papier glacé, il est vu, touché, entendu, senti, goûté au quotidien en fonction de l’heure de la montre ou du soleil, du mois ou de la saison.
Le déroulement des heures
Aucun paysage n’est évoqué sans que le lecteur sache à quel moment de la journée les personnages se trouvent. Et suspens oblige, les journées ne sont pas toutes tranquilles. Le jeune médecin enthousiasmé par son rôle va devoir affronter sa propre nature quand il rencontrera l'adolescent malade qui va l'obséder : E mai ai après, dempuei, que los matins los mai luminós fan dau còps los sers los mai sornes44. [Et puis j'ai appris, depuis, que les matins les plus lumineux font parfois les soirs les plus sombres.]
Ganhaire précise presque immanquablement le moment précis du déroulement des scènes et révèle ainsi sa volonté de rendre le quotidien familier au lecteur. Le moment de la journée peut être perçu en fonction du relief de manière à faire vivre les personnages dans un monde où l'espace est perçu en fonction du temps et le temps en fonction de l'espace :
Lo jorn s’era levat e lo solelh, mai si aviá pas enquera atengut las ribas dau Corbariu, començava de careçar las cimas dau planetge45.
[Le jour pointait et le soleil, même s’il n’avait pas encore atteint les rivages du Corbariu, commençait à caresser les hauteurs du plateau.]
Le déroulement des heures est régulièrement rythmé par des cloches d’églises ou de cathédrales diverses (Senta Aulàia ou Sent Basili près du commissariat de Maraval, Sent Michel à Bordeaux et dans divers villages). Le temps est ainsi vécu collectivement et il est bien précisé par le narrateur de Sorne Trasluc que les cloches ne sont plus secouées par un curé mais électriquement46. Les après-midi et soirées à Maraval peuvent aussi être introduits par un passage où il est fait allusion à un repas (dinnar ou sopar [déjeuner ou dîner]) dans une brasserie, un restaurant ou bien un repas nocturne chez le commissaire ou le médecin légiste. La fin de la journée de travail et le repas du soir sont alors signalés par le trempa-sopa [l'heure de tremper la soupe] carillonné à quelque clocher d'Un tant doç fogier47.
La vie nocturne
La perception du temps individuelle est rythmée par de fréquentes allusions à la mystérieuse nuit où le cerveau voudrait bien se défaire des griffes du temps qui passe. Le personnage de la nouvelle « La Pòrta dau reirlutz », par exemple, entend une vieille horloge à l'intérieur de la maison sonner et provoquer des vibrations dans son corps que le narrateur désigne comme la lava sonòra de cada còp [la lave sonore de chaque coup]. Évoquée en focalisation interne, cette sensation est suivie d’une crise de détresse et d’angoisse comme celle que peut ressentir un oiseau fasciné par un serpent. Ce sentiment est maîtrisé car le personnage peut remonter le mécanisme avec la petite manivelle et pousser la pòrta dau reirlutz48 [la porte de la pénombre]. Il faut bien affronter la nuit quand rien n’est visible et que survient la montée des loups-garous. Le tourmenté accueille alors les visions nocturnes, mais attention :
La nuech es lo mai crueu daus miralhs, e dins quilhs moments daus uelhs grands duberts, la lucha a braça-còrs emb la vertat se pòt pus eschivar49.
[La nuit est le plus cruel des miroirs, et dans ces moments des yeux grands-ouverts, la lutte à bras-le-corps avec la vérité ne peut plus être évitée.]
La nouvelle Lo Bibliotecari se concentre sur l’ouvrage recherché par le vieux conservateur de la bibliothèque de la Font Prigonda [La Fontaine Profonde], comparé à un gardien de cimetière. Dans l'obscurité de son lieu de travail, sa vie s'est résumée à tuer les nuisibles qui menaçaient les ouvrages anciens. Finalement, le livre original et unique qu'il va aller chercher pour un fugace lecteur arrivé de l'extérieur est Lo Libre de la nuech de Jaufre de Bordelha50, un livre que le bibliothécaire va garder pour lui afin qu'il accompagne ses nuits. On peut supposer que Lo Libre de la nuech incarne le passage de la conservation de livres anciens à l'écriture active d'ouvrages que l'imaginaire nocturne alimente.
Les oppositions obscurité vs lumière et extérieur vs intérieur sont des éléments qui balisent les récits. La dépression de quatre mois de Darnaudguilhem dans son commissariat et son petit appartement après la mort de l’inspectrice dont il était amoureux a été l’équivalent d’une nuit noire51. Mais quand il entrevoit soudain la vérité qui va lui permettre de résoudre une enquête, c’est comme si quelqu’un avait ouvert d’un coup les volets sur un matin lumineux et que la chambre obscure se trouvait inondée de soleil52.
Les variations saisonnières
Le monde moderne semble estimer dérisoire le lien entre les humains et leur environnement naturel. Les personnages (plus de cent cinquante) villageois ou urbains des ouvrages de Ganhaire utilisent, ou au pire, découvrent les médias et objets modernes : téléphones fixes ou portables aux musiques d’appel avec des airs de la tradition occitane, ordinateurs, distributeurs de produits sucrés, voitures de toutes marques… Cependant, l’emprise des outils modernes n’empêche pas une extrême sensibilité des narrateurs à l’impact des saisons, qui ont une influence sur les humeurs des protagonistes. La nuit chaude d’été à Bordeaux est caractérisée par des milliers d’insectes virevoltant autour des lampadaires53. Pour le jeune médecin obsédé par le jeune malade du domaine des Malavernha du « Sendareu dau genebres », l’automne est éclatant. Puis tout va finir et la nature automnale personnifiée devient hivernale :
Los ormes de l’alèia me saluderen de quauquas fuelhas d’aur. Sabián de segur qual era lo que passava jos lur nauta vòuta : era la vita, era l’esperança, era lo Medecin Charmant54.
[Les ormes de l’allée me saluèrent de quelques feuilles d’or. Ils savaient, c’est certain, qui était celui qui passait sous leur haute voûte : c’était la vie, c’était l’espérance, c’était le Médecin Charmant.]
E venguèt lo moment que la larja alèia me saludet pus nonmàs de longs marns nuds sus fons de ceu gris e doç, e que lo doble arrodau produch per las ròdas de ma veitura se marquet pus nonmàs dins un liech de fuelhas trapadas a se puirir55.
[Et vint le moment où la large allée ne me salua plus que de longues branches nues sur un fond de ciel gris et doux, et que les deux traces des roues de ma voiture ne se remarquèrent plus que dans un lit de feuilles en train de pourrir.]
Meschant temps Maraval ! s'ouvre également sur la vision d'un tapis de feuilles mortes que le soleil oblique d'octobre fait flamboyer... et le cadavre d'une vieille femme. En contrepoint, le roman Las Tòrnas de Giraudon s'ouvrait sur une belle matinée du mois de juin tandis qu’un jeune berger bientôt victime d’un mauvais coup allait rejoindre le Bòsc Espinós [Le Bois Épineux] où il avait assisté à l’exécution d’allemands pendant la guerre : Son pas, pertant leugier, esbolhava lo mentraste enquera molhat de rosada56 [Son pas, pourtant léger, écrasait la menthe sauvage encore trempée de rosée]. Puis toute l’enquête va se dérouler dans une ambiance de forte chaleur à tel point que le soleil faisait fumer la route. Darnaudguilhem est contraint de sans cesse rechercher la fraîcheur de l’air conditionné dans sa voiture et sous l'ombre d'un arbre. Dans ce cas, au moment de la résolution du mystère, un orage sera sur le point d'éclater57.
Le froid hivernal est aussi présent dans les récits. La neige apparaît dans une histoire rapportée par la Pès-Nuts qui évoque les traces d’un loup venu des forêts profondes du Limousin. Ce loup rappelle les apparitions fantastiques qui caractérisent Lo darrier daus Lobaterras. La Pès-Nuts raconte que le loup vient pour s’emparer de l’âme d’un homme :
Lo solelh se fasiá bas. La sorniera començava de se raletar entre los grands chastanhs, que la névia ne’n veniá blúia dins lor ombra eslonjada. […] La lum oblica, las ombras de mai en mai sornas, lo luquetament de la névia los fasián pilhonar e pas creire çò que vesián58.
[Le soleil baissait. L’obscurité commençait à glisser entre les grands châtaigniers, si bien que la neige bleuissait dans leur ombre allongée. […] La lumière oblique, les ombres de plus en plus sombres, le scintillement de la neige faisaient cligner leurs yeux et ils n'arrivaient pas à croire ce qu’ils voyaient.]
À Maraval, dans Vautres que m'avètz tuada, le mois de janvier se caractérise par un froid nhacaire [mordant]. Comme lorsque le vent ne souffle plus, les brumes glacées, les trottoirs glissants et les arbres nus sont associés avec une enquête qui n'avance pas. Quand le printemps s’annonce dans ce roman, Darnauguilhem et son assistant Le Goff peuvent reprendre leur enquête. Par dérision et humour, le narrateur signale alors qu’ils n’ont malheureusement pas le temps de s’adonner à une appréciation poétique de la saison du renouveau qui ouvrait les chansons des troubadours : Se foten de las flors, de la campanha que comença de verdesir, daus pitits auseus59 [ils se moquent des fleurs, de la campagne qui commence à verdir, des petits oiseaux].
Un environnement perçu par les sens
Ainsi Gaetan Caüsac – personnage loufoque puisqu’il est à la fois un comte, un ancien commissaire et un détective entouré de serviteurs anciens brigands en réinsertion – est un très grand frileux, toujours collé à un radiateur. Il a de sérieux troubles de la vision et n'a plus de sens du goût. Par contre, son odorat de fin limier et son ouïe très fine le rapprochent des animaux instinctifs :
E vei-lo quí partit, nas au vent, trabuchant sus los calhaus e las còças de genebre, biselant coma 'na lebre que vòu eschapar au còp de fusilh60.
[Et le voilà partir, le nez au vent, trébuchant sur les cailloux et les vieilles souches de genièvre, zigzagant comme un lièvre qui veut échapper au coup de fusil.]
Critique plein d'humour des artefacts du monde moderne, Ganhaire crée un Gaëtan Caüsac qui ne peut vivre qu’en écoutant des morceaux de musique classique grâce à des appareils d’écoute continuellement sur ses oreilles. Sa perception moderne du monde se fait par le biais de prothèses sensorielles. Seule la proximité de l’océan peut éveiller son sens lyrique alors que toute sa vie, il n'a fait que rêver de voyages lointains :
Sei nascut dins un pòrt e dempuei tot pitit, ai vut bien dau monde passar emperaquí, atentiu a l’aura e totjorn en partença. Jamai mon còr n’a pres lo chamin de la mar, jamai per ió n’an luquetat los fares, ni lusit nauta e clara una ancora au cabestan. Ai vut sens grand plaser largar las amarras, e la proa daus vaisseus anar vers l’ocean. Sabe los noms daus masts, e los de las velas ; la nostalgia, e los crits daus mariniers ; lo plan lord charjament daus vaisseus que tòrnan e lo sòrt daus vaisseus que ne tornaràn pas. Los pòrts an per l’òme dangierosas sentors… [...] Gaëtan Caüsac, ancian comissari, comte daus Ombradors, per un còp, ven de s’endurmir61.
[Je suis né dans un port et depuis tout petit, j’ai vu bien des gens passer par là, attentifs à la brise et toujours prêts à partir. Jamais mon cœur n’a pris le chemin de la mer, jamais pour moi ne se sont allumés les phares, ni n’a brillé haute et claire une ancre au cabestan. J’ai vu sans grand plaisir larguer les amarres, et la proue des vaisseaux partir vers l’océan. Je connais le nom des mâts, et ceux des voile ; la nostalgie et les cris des marins, le très lourd chargement des vaisseaux qui reviennent et le sort des vaisseaux qui ne reviendront pas. Les ports ont pour l’homme des odeurs dangereuses […] et Gaêtan Caüsac, ancien commissaire, comte des Ombradors, pour une fois, vient de s’endormir.]
Nous savons, depuis Dau vent dins las plumas et Las Islas jos lo sang, que Ganhaire sait nommer les vaisseaux, les mâts et les voiles et que la lecture du Comte de Monte Cristo est restée vivante dans sa mémoire.
Les villes sans convivialité, l'abondance des végétaux et la présence de certains animaux dans une nature où on ressent la solitude, pourraient aboutir à une vision pessimiste du monde. Mais il y a le vécu quotidien et le retour des saisons et, paradoxalement, des visites régulières dans des cimetières qui sont souvent l'occasion de donner une vitalité critique aux romans de Ganhaire tout en soulignant l'importance essentielle de la mémoire.
Les cimetières comme lieux de mémoire
Dans l’œuvre, la liste des cimetières est particulièrement longue. Ils sont d'une certaine façon le pendant des bibliothèques privées remplies de livres finalement dérisoires et chronophages puisque dans une vie, un lecteur ne peut espérer s’approprier tout le savoir qu’ils contiennent. Ils font aussi partie du goût du macabre que Ganhaire nous dit avoir puisé en partie dans « Les Assis » de Rimbaud ou « Los Caprichos » de Goya62... Il arrive que les nhòrlas s'en nourrissent. Ainsi Ganhaire prise-t-il les cadavres nombreux, les expéditions très risquées, lugubres et parfois saugrenues, qui peuvent provoquer le sourire ou même le rire.
Les cimetières sont donc présentés de façon tantôt tragique tantôt burlesque. Ils servent parfois de comparants à des lieux qui se vident comme le village de « Quo es entau la vita » [C'est ça la vie], chronique de Vent-l'i-Bufa I. Ils ressemblent de plus en plus au cimetière envahi par les orties et le lierre où on vient d’enterrer Paulina Masieras. Deux végétaux dominent :
Las ortrujas, la ledre, comencèren de minjar las maijons ; los pitits jarrics, los chastanhs, comenceren d’avançar tot-suau dins las terras, e las vinhas laisseren a las tridas las dernieras grapas que degun pus massava63.
[Les orties, le lierre commencèrent de manger les maisons : les petits chênes, les châtaigniers, commencèrent d’avancer tout doucement dans les terres, et les vignes laissèrent aux grives les dernières grappes que personne ne ramassait.]
Des personnages confrontés à la mort
Dans la Cronica de Vent-l’i-bufa intitulée « Quo es entau la vita » (p. 53), Paulina a été portée en terre au cimetière de La Chapelle-Brujau près de ses parents et deux de ses enfants. Dans une rétrospective, Ganhaire fait alors allusion à la jeunesse fauchée pendant la première guerre mondiale car Paulina y a perdu celui qu’elle aimait, mort au champ d’honneur du côté de la Marne. Il n'avait que 20 ans. Son nom est parmi ceux des 32 jeunes du monument aux morts de Chantagreu. Ayant dû faire face aux décès successifs dans sa propre famille (croup, accident ou folie), à vingt-quatre ans, Paulina paraissait avoir le double de son âge et le malheur l’avait rendue muette. Ricon avait épousé Paulina mais comme ils avaient perdu un premier de leurs deux jumeaux à cinq ans et l’autre à vingt ans, fusillé contre un châtaigner parce qu’il était messager pour le maquis. Alors Paulina s’était définitivement tue. Elle avait laissé Ricon parler tout seul jusqu’à ce qu’il la trouve un matin gelée devant la fenêtre ouverte de sa chambre. L’esprit de la nhòrla humoristique est là pour dépasser le tragique : Paulina, incarnation d'un pays blessé et silencieux est paradoxalement morte la bouche ouverte.
Dans le même état d'esprit transgressif, le récit « Coma una volada de cagolhas »[« Comme un vol d'escargots »] évoque une nuit de chasse aux escargots où le petit Jan-Pau Gantelha dit qu’il y en a en grande quantité au cimetière. Sylvan Lauvernhat est moins enthousiaste que lui et le pousse à se demander s’ils ne mangent pas la chair des morts qui deviennent des squelettes. Jan-Pau accepte de renoncer à la chasse aux escargots quand il aperçoit la photo de son grand-père sur une des tombes64.
Des cimetières et des revenants
Le dénouement du roman Rendetz-vos au cementeri n'offre pas une vision inquiétante du petit cimetière villageois aux tombeaux recouverts de mousse de Mandelon où sont enterrés les Martinchart du Chasteu daus Escudièrs [Le Château des Écuyers]. À côté de leur tombe il y a, plus récente et bien entretenue par un vieil ami des immigrés polonais, celle des Klemeniúk sur laquelle figure une statue de la vierge noire de Czestochowa65. À minuit, autour de la veuve et du fils des Polonais de la ferme de la Chauprada, l’opération Faraon va y réunir des gendarmes locaux, Darnaudguilhem et ses assistants du commissariat de Maraval, la juge Rosalina Lavernha, le procureur Bregegera et le détective Gaëtan Caüsac accompagné de ses acolytes. Il s'agit de procéder à l’ouverture d’un cercueil où on pense trouver un trésor. Mais au lieu de se trouver dans la tombe de Klemeniúk, ce trésor a été transféré par le fossoyeur surnommé lo Tais [le Blaireau] dans le caveau des nobles Martinchart66. Le cimetière devient alors le lieu d’une scène chaotique où tous manifestent leur déception, sauf le commissaire qui a vu le jeune monte-en-l’air Julian Vernhanegre dit l’Esquiròu [l’Écureuil] élève de Marcelon-det-de-fada [Petit Marcel-doigt-de fée] profiter de la confusion pour s'emparer de quelques bijoux : Ò ! pas grand chausa, daus pendents d’aurelha, una bròcha e una baga emb un brave solitari67 [Oh ! pas grand-chose, des bouches d’oreille, une broche et une bague avec un gros solitaire]. Ganhaire a fait de ce Julian le narrateur des Enquèstas de pas creire de Gaëtan Caüsac daus Ombradors, en partie de Rendetz-vos au cementeri et du dernier Meschant temps Maraval ! où il a volé un tableau pour un commanditaire et subtilise une jolie statuette de la déesse gauloise Epòna au Museum de Maraval. Rendetz-vos au cementeri associe plusieurs narrateurs : le narrateur omniscient qui raconte les enquêtes de Darnaudguilhem en focalisation interne, le narrateur des recherches de Gaëtan Caüsac, et également Brandison, Masalrelh habitué de l’Estanquet et Marta, tous les trois habitants de Mandelon. Ganhaire rend ainsi indirectement aux villageois le soin de construire la légende de leur village plutôt que de laisser le récit au journaliste Tardiu toujours à l’affût d’informations pour le journal local L’Esvelh de Nauta-Dordonha68. Le dernier ouvrage de Ganhaire s'ouvre également sur un remerciement à ceux de l'atelier occitan de Bourdeilles.
Rien n'est oublié individuellement ou collectivement. Est-ce pour ne pas mourir tout à fait que des tombes montrent des inscriptions ou des sculptures parfois surprenantes (mausolées, avions, chevaux, drapeaux, canons…)69 ? Quoi qu'il en soit, elles témoignent de destins individuels même s'ils sont parfois ridiculement prétentieux. Elles attestent aussi de lourds secrets qu’on croyait définitivement enfouis. La dernière présence de Darnauguilhem dans la section G15 du cimetière de Brimbilí se situe dans la nouvelle « L’Anniversari de Darnaudguilhem » d’Enquestas a la lesta : des pseudo-touristes sont venus depuis la Mauritanie rappeler, en peignant en blanc la tombe de l’ingénieur Xavier Valadier, qu'il avait causé la mort par électrocution d’une vingtaine d’ouvriers locaux entre Akjojt et Afar. Et l’œuvre évoque aussi des oubliés qui n’ont pu être ensevelis dignement. C’est le cas du roman Las Tòrnas de Giraudon [Les Revenants de Giraudon] qui s’ouvre sur la vision du prat de l’Espinosa plein de ronces qui débordent peu à peu sur les terres cultivées. Là, sont enterrés des Allemands à qui on avait fait creuser leur tombe et Ganhaire y situe aussi deux victimes de son intrigue70. Le titre est explicite : les corps entassés anonymement à cause des guerres ou les corps enterrés à la hâte et abandonnés aux bêtes sauvages sont la marque d’une faute collective qui ne peut être effacée : tout mort a droit à un enterrement décent et les secrets ne doivent pas rester inavoués.
Des monuments et des rites funéraires
Dans l’ancienne colonie occitane imaginée à Osma Bendar au Mali, on retrouve des noms figurant sur des monuments aux morts divers. Ganhaire pousse son commissaire à parcourir ce cimetière indiqué comme Champ dau Repaus où figurent des noms de soldats d’Occitanie et à pousser la petite grille d’une annexe qui isole le carré des réprouvés71. Et une fois morts, les êtres fragiles et vieux isolés attirés dans la maison de convalescence du Chasteu de la Valosa par le Docteur Delcombel qui les affame et leur fait signer un testament, ne peuvent rester enfermés dans des cercueils sans nom entassés dans une cave du château72.
L'écrivain fait plus parler les cimetières-archives à ciel ouvert que n'importe quel bâtiment urbain ou rural. Le cimetière du « Viatge aquitan » est particulier. Il est entouré de murs recouverts de tuiles et se situe entre une treille chargée de grappes (elles conviennent bien à l'alcoolique Juli Lasfarjas) et une rivière qui coule paisiblement entre des saules et des peupliers. Les rites d'ensevelissement sont essentiels : à Bordeaux, l'ami Miguel de Juli, que l’on croyait castillan mais était basque, est venu lui faire ses adieux avec deux pleureuses. Puis son compagnon vagabond le rasera soigneusement avant de le mettre en terre73.
L'évocation des rites funéraires est occasion de montrer l’évolution de ces pratiques. Le service modernisé de la morgue et la salle de dissection sont l’antichambre décisive où le médecin légiste rend leur identité aux disparus, victimes ou bourreaux qui auraient voulu cacher leurs méfaits. Dans Sevdije, à l’enterrement civil de l’inspecteur Peironin qui s’est suicidé, l'écrivain évoque l'accueillant cimetière74. Les rites funéraires changent, ainsi un personnage est amené au crématoire de Montferrand75 tandis que l’inspectrice dont Darnaudguilhem était amoureux est incinérée et ses cendres éparpillées avec celles de son jeune fiancé paraplégique décédé76. La visite de tombes familiales, d’amis ou d’inconnus où une croix s’affaisse et dont on comprend qu’elle ne sera jamais relevée s’accompagne d’une réflexion sur la fugacité de l’existence y compris pour le commissaire Darnaudguilhem qui pense à des vers de Victor Hugo aimés par son fils : « Déjà, le souvenir de vos amours s’efface, / Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri... »77.
La mémoire des ancêtres et des jeunes disparus est fragile et les lieux variés de notre monde multilingue encore plus. Ganhaire aime la langue de son Périgord mais aussi toutes les langues que les humains parlent ici-bas.
La perception des paysages par la / les langues
Entre l’ici et l’ailleurs
L'imaginaire géographique de Ganhaire associe des traits caractéristiques de la nature de la Haute-Dordogne ou de la ville de Périgueux avec l'occitan, c’est-à-dire à la matière même qui construit son écriture. Ce monde aurait pu être dit en français mais les pays ne semblent bien se faire connaître qu'à travers les langues qui y sont parlées. L’Occitanie de Ganhaire est complètement occitane et la langue de Molière en est exclue. Les institutions et les services publics occitans sont calqués sur le modèle français existant mais, après tout, le domaine d'oïl et le domaine d'oc sont des pays occidentaux à un même stade de développement.
Les romans opposent un « ici » occitan par le biais de lieux chers aux narrateurs et d’autres espaces que l’intrigue dévoile grâce à des langues révélées par des sonorités étranges à l'oreille. Langues, dialectes et accents sont autant de voyages pour le sédentaire ou pour celui qui se lance dans des voyages au long cours, imaginaires ou pas. Ganhaire a évoqué dans certains de ses récits des métropoles (Bordèu, Marselha…) mais surtout des lieux familiers de la Dordogne rebaptisés par ses soins dans une stratégie de brouillage référentiel qui contribue à l’élaboration d’une géographie qui lui est propre. Le pays aux collines boisées et verdoyantes et aux routes sinueuses contraste avec la région plus inhospitalière du Causse et avec la région aux routes rectilignes bordées de pin de la côte océanique.
L’ici de Ganhaire, ce sont notamment les alentours de Maraval ou Malavernha. Il y a le village natal du commissaire à Puegmaurin ou des séjours dans un village de vacances à Mandelon… Parfois il se retrouve, pour une demi-journée tout au plus, dans un village, un quartier, une aire de gens du voyage, un orphelinat, une maison de repos... Les récits mentionnent de nombreux lieux familiers ou des noms de familles qui en sont issus. Ils apparaissent dans les récits de façon récurrente, comme lorsqu'est introduit le morphème Mal- : Malacomba, Maraval (Malaval, rhotacisme du « l »), Malvernha... Parfois l’auteur crée des toponymes ou anthroponymes à partir d'un mot occitan désignant l'aulne, sous la forme de Vern- : Malvernha, Lasvernhas, Vernhanegre, Lauvernhat... Ces lieux retrouvés dans les noms des personnages servent de repère premier : ils signalent la terre du vécu ou parfois des études des narrateurs et des personnages principaux des chroniques, nouvelles et récits. Il leur arrive de parler de lieux parcourus à quelques moments de leur vie et cela, quels que soient les genres narratifs :
- dans le roman fantastique du Darrièr daus Lobaterras, les murailles de Saint-Jean d'Acre se dressent devant les yeux de Joan de l’Arribiera, leur immensité est comparée à celles du château de Bourdeilles qu’il connaît,
- dans les romans de cape et d’épée Joan Francesc Barnabeu Segur de Malacomba évoque un voyage vers Londres et l’Irlande,
- dans le roman policier Vent de sable le commissaire Darnaudguilhem prend l'avion vers le Mali,
- dans des nouvelles d’Enquistas a la lesta, le lecteur est transporté en terre franchimande et en Belgique...
Les personnages d'Occitanie ou d'ailleurs vivent dans un monde de possibles depuis les temps préhistoriques, au Moyen Âge, aux XVIe siècle, aux XXe et XXIe siècles. Aussi, pas de paysage sans toponymes (une bonne cinquantaine pour la région de Bourdeilles et Périgueux), sans noms de familles ou sans évocation de la langue et des locuteurs. Un pays ne peut se connaître et se comprendre qu'au prix d'une recherche approfondie basée sur des échanges dans la langue de ses habitants. Les enquêtes policières fouillent dans le passé : ...çò que cherchava era pas a la surfàcia, mas desjà sebelit dins los trasfons daus temps ancians78 […ce qu’il cherchait n’était pas à la surface, mais déjà enseveli dans les abîmes des temps anciens]. Et ces enquêtes sont difficiles car les piadas [traces de pas] se perdent sur les trottoirs bétonnés du monde moderne.
Le plaisir de découvrir les langues
Les langues et leurs locuteurs apparaissent ainsi comme des continents à découvrir. Grâce à l’enseignement de l’abbaye de Merlanda à la fin du XIIe siècle, le jeune Joan va laisser sa hache pour la plume et adopter non pas le latin mais la langue occitane :
N'aviá pro aprés, per aquò, per poder deschifrar los perjamins en latin o dins nòstra lenga ; pro tanben per escriure quelas linhas, mas sabe pas si quo es un ben o un mau79.
[J'en avais assez appris, cependant, pour pouvoir déchiffrer les parchemins en latin ou dans notre langue ; assez aussi pour écrire ces lignes, mais je ne sais pas si c'est un bien ou un mal.]
Dans les nouvelles et romans de Ganhaire, le contact avec les langues des humains est jubilatoire. La langue anglaise pour Joan de Malacomba reste d'un intérêt mineur par rapport à la sensation provoquée par le gaëlique d’Irlande des Bloody Widows présenté comme une langue un peu raucha [rauque] que les Anglais ne comprennent pas plus que le narrateur80. Deux langues émergent aussi nettement dans l’œuvre, celles des gens du voyage de l’errance éternelle de Montmoreu dans La Mòrt que vai mai redge que lo vent : ils s’expriment en caló du sud tandis qu’ailleurs d’autres parlent le sinti81. Le Mali est au centre de l’intrigue de Vent de sable, au Bengara ancienne colonie imaginaire de l’Occitanie au carrefour du Mali, de l’Algérie et du Niger. Un tatouage yoruba sur l’épaule d’un vieux sans-abri (qui joue aussi le rôle d’indic et vient d’être assassiné) oriente l'enquête vers les langues et dialectes du Nigeria et du Mali82. Diagana Traoré, l’assistant de Darnaudguilhem, d'origine malienne, nous entraîne hors du domaine des langues à accents toniques pour aller vers les langues tonales où le sens est amplement lié à l’état d’esprit du locuteur. Dans « Permenada de santat » [Promenade de santé] d’Enquestas de pas creire de Gaëtan Caüsac, le jeune narrateur Julian se rend compte qu'une jeune fille a des origines malgaches parce qu’en occitan, elle ne prononce pas nettement les « r »83. Ces incursions chez des étrangers du dedans sans racines qui vivent mal une difficile intégration et chez des étrangers de l’extérieur qui ont subi la colonisation mettent en avant des langues et des conceptions « autres » du monde.
Les nombreuses appréhensions du monde
L'écrivain Ganhaire a choisi l'occitan comme langue de création, et en amateur de pointes d'humour, il s'amuse à rendre la mémoire du français à Julian, son jeune narrateur uniquement occitanophone (« Daus òmes que tomban »84 [Des hommes qui tombent]. Dans la nouvelle Los ‘sietats ([Les assis], titre d’un poème de Rimbaud qui est traduit en occitan par l'écrivain à la fin de l'ouvrage), il glisse dans le texte quelques paroles de Francisco, chauffeur de Gaëtan Caüsac qui, coincé dans la circulation à Gent, se met à jurer spontanément en espagnol, en arabe et en dialecte de Saïgon car il a participé à la guerre d’Indochine85.
Au-delà de l'humour, le désir profond de comprendre les racines du bien et du mal se heurte à la difficulté, voire parfois à l’impossibilité de communiquer en mots avec les blessés de la vie (handicapés physiques ou mentaux, traumatisés, malades...). Le recours aux expressions sensorielles diverses telles que les parfums vs les puanteurs, les hurlements vs la musique, la douceur vs la rudesse, les saveurs culinaires vs l'âpreté d'un ingrédient permet alors d’établir la communication. Particulièrement attentif à l'environnement et aux hommes qui le peuplent, Ganhaire semble ainsi suggérer que la primauté de la vision dans la perception de l'espace vécu pourrait bien être cause de notre appréhension et compréhension incomplètes du monde. Gaëtan Caüsac dans le roman Meschant temps Maraval ! est d'ailleurs devenu une paura carcassa paralisada [une pauvre carcasse paralysée] aveugle à qui il ne reste que son amour pour la musique classique, un amour qu'il a communiqué à son ancien protégé Julian Vernhanegre qui tient tout particulièrement à sa chaîne Hi-Fi. Julian veut aussi se débarrasser de la cane du meurtrier psychopathe normand obsédé par la propreté et la sécurité dont le pommeau représente Atlas soutenant la terre et toutes ses misères86.
Conclusion
L'écrivain Ganhaire nous fait voyager dans l'espace et dans le temps en s'essayant à divers genres littéraires. Il gomme les frontières entre nhòrlas, nouvelles et romans et incite le lecteur à approfondir son regard sur notre monde contemporain. Imprégné des paysages familiers de la Haute-Dordogne et de la langue de ses habitants écoutés au fil d’une vie, il prévient contre les perceptions superficielles des lieux que nous traversions et nous incite à utiliser tous nos sens pour saisir la délicieuse singularité de notre monde, extérieur et intérieur. Le pays vécu, les lectures choisies et les arts montrent que l'environnement quotidien peut être une inépuisable source de bonheur pour qui sait l'alimenter par la musique de Brahms, Mahler ou Mozart... et la poésie de l'« Invitation au voyage » de Baudelaire87. Pour le commissaire Darnaudguilhem, après un excellent repas servi dans son restaurant des Coupoles, rien ne vaut une promenade à pas lents dans la ville tiède où, respirant profondément, il se sent la tête légère et se prend à rire tout seul88. Et pour le jeune orphelin en quête d’affection de la Pès-nuts [le lièvre], rien ne vaut un conte dans la langue magique du parlar-lebre qui lui révèle indirectement qui il est vraiment. C'est au lecteur de goûter la langue issue de la mémoire d'un pays que l'écrivain a prospectée pour transformer les déchaînements de l'esprit de Vent-l'i-Bufa en péripéties littéraires.