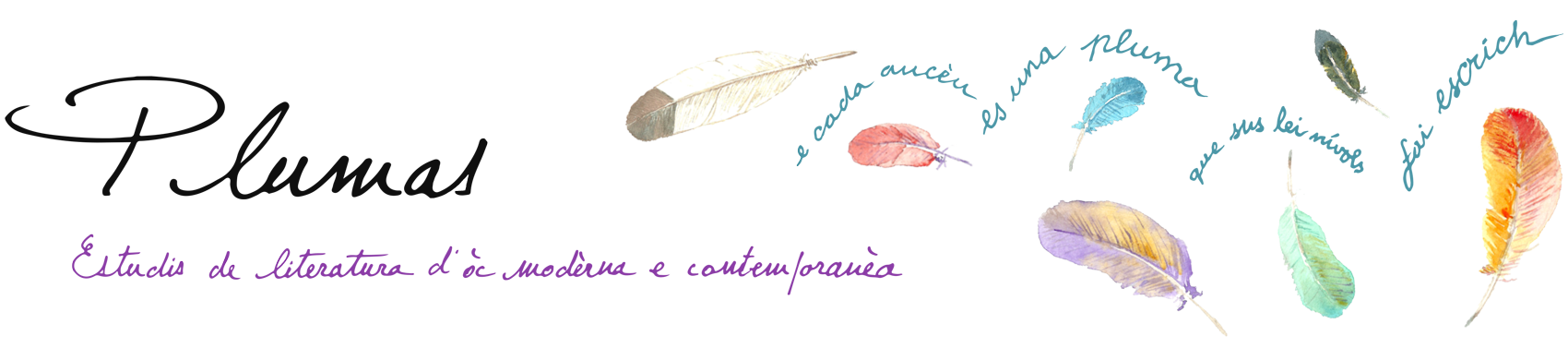« “D’int’ubagu”, dal fondo dell’opaco io scrivo » (Italo Calvino, « Dall’opaco »)
« Entre reirlutz et ubagu »
Lo libre dau reirlutz, 1979, est le premier recueil de nouvelles de Joan Ganhaire1. Le terme reirlutz désigne le versant d’une montagne ou le mur d'une maison non exposés au soleil2. Le premier à me l’expliquer a été Jean Ganhaire. C’est l’équivalent d’ubac (lat. opacus). L'« opaco » et l'« aprico » font partie des différentes formes désignant respectivement une terre à l'ombre (au nord) ou un endroit ensoleillé (au sud), ces deux mots remontant du Piémont jusqu’au ligure occidental3. Et voilà que nous rencontrons ici un témoignage exceptionnel, celui d'Italo Calvino :
On appelle « opaco » (en dialecte : « ubagu ») l'endroit où le soleil ne brille pas ; en bon langage, selon une expression plus recherchée : « a bacìo » ; tandis qu’est appelé « a solatìo » ou « aprico » (« abrigu » en dialecte) l'endroit ensoleillé (Calvino 1994, 98).
Lorsqu’il pense à sa ville de Sanremo et en répondant idéalement à la question : « Quelle forme a le monde ? », dans le conte « Dall'opaco », de 1971, l'ubagu et l'abrigu marquent pour lui une géographie « en pente », où ombre et lumière se partagent l'espace entre les versants et ravins de l'intérieur et la haute mer en face d’eux (Calvino 1994, 89-101). Dans cette perspective, semble émerger « l’extrême rareté de l’opaco et la plus grande extension de l’aprico ». La frontière mystérieuse entre les deux est marquée par « l'assombrissement du vert » et la « proximité du froid » qui signalent qu’on est entré « “int'ubagu”, dans l’envers opaque du monde »4.
Mais au terme d’un parcours complexe entre les formes de l’ailleurs, l’ubagu finit par représenter le côté ombreux du paysage de son écriture :
Il est inutile de chercher à me rappeler à quel moment je suis entré dans l'ombre, j'y étais déjà depuis le début, il est inutile de chercher au bout de l’ubac une issue à l’ubac, je sais maintenant que le seul monde qui existe est l’ubac et que l’adret n'en est que l’envers […]. J’écris “d'int'ubagu”, du fond de l’ubac. (Calvino 1994, 101)5.
Étonnamment, Italo Calvino et Joan Ganhaire, employant tous deux la langue le plus intime de leur territoire, recourent à des coordonnées analogues pour décrire la géographie de leur imaginaire.
Il est intéressant de noter une autre opposition dialectique et complémentaire6 exposée dans les derniers écrits de Calvino : la leçon américaine sur la « Légèreté » (Calvino 1995, 631-655). L'auteur exprime sa préférence (« et je soutiendrai les raisons de la légèreté ») pour une qualité qui, dressant un bilan de ses quarante ans de travail sur l'écriture, se reconnaît dans une opération constante de « soustraction de poids ». À cet égard, il rappelle comment, jeune écrivain, il a souffert du décalage entre le devoir de représenter « les faits de la vie qui auraient dû être ma matière première », 632, impératif de l'époque, et « l'agilité vive et tranchante dont je voulais animer mon écriture ». Dans l'argumentation, inventoriant la qualité opposée, la pesanteur, apparaissent souvent les mots opaco / opacità [opaque / opacité] :
Peut-être est-ce seulement alors que je découvrais la pesanteur, l'inertie, l'opacité du monde : propriétés qui s’attachent aussitôt à l'écriture, si l’on ne trouve pas le moyen de leur échapper. À certains moments il me semblait que le monde entier était devenu de pierre : une lente pétrification plus ou moins avancée selon les personnes et les lieux, mais qui n’épargnait aucun aspect de la vie. C'était comme si personne ne pouvait échapper au regard implacable de la Méduse. Le seul héros capable de couper la tête de Méduse est Persée, qui vole avec des sandales ailées. (Calvino 1995, 632).
Son aspiration à échapper à l'opacité du monde, à la lente pétrification qui le menaçait et risquait d'étouffer la composante volatile de son écriture, s’exprime à travers le visage d'un Persée aux sandales ailées, portées par le vent et les nuages. Idéal de légèreté7.
« Entre rire et désespoir »
À propos des pôles dialectiques et complémentaires de lumière et d'ombre, de légèreté et de pesanteur, Calvino disait de son propre tempérament : « Je suis un saturnien qui rêve d'être mercuriel, et tout ce que j'écris est affecté par ces deux impulsions. » (Calvino 1995, 674). Quant à Ganhaire vu par Fabienne Garnerin : « Entre rire et désespoir », ce sont ces deux pôles qu’on rencontre dans son œuvre tout entière. La méditation sur la mort « qui pèse de tout son poids sur les vivants » et « le jaillissement d’un rire »8, son opposé complémentaire. Passant en revue sa réception de l’œuvre, la lectrice entreprend de relever dans la critique (Morà, Gardy) les thèmes qu’il privilégie : « la solitude, le désespoir, l'exploration de situations limites et le fantastique » (Garnerin, 24). En tant que médecin, d’ailleurs, les thèmes de Ganhaire ne peuvent que se concentrer sur la vie, la mort, la douleur et les maladies du corps et de l'âme. « L’humaine condition », en somme, concernant des êtres vulnérables et des corps fragiles9. Tous ces thèmes sont déjà contenus en germe dans Lo libre dau reirlutz. Pourtant, bien que Ganhaire puisse dire lui aussi « j’écris du fond de l’ubac » et que le reirlutz soit la tonalité dominante de l'œuvre et de l'esprit de cet écrivain, on y découvre, fort et vivant, l’envers de l’ombre, son antidote : le rire10.
C'est que, chez Joan Ganhaire, les contraires ne s'excluent pas l’un l'autre : l'écrivain les pense ensemble, dans une relation dynamique qui invite à questionner la façon dont ils s'unissent. L'oscillation entre rire et désespoir, mais aussi l'alliance inattendue de l'un et de l'autre, éclairent de leurs contradictions la complexité de la condition humaine (Garnerin, 17).
Comment le Mercure alipède peut-il soulager aussi Ganhaire de son Saturne mélancolique ? Examinons en détail ses récits « du côté de l'ombre ».
Laissant de côté pour l'instant le premier récit du Libre dau reirlutz, sur lequel nous nous arrêterons plus tard, nous tombons sur « Raibe negre » (« Le cauchemar », 15-21). Parmi les mots clés fantastique, humour noir11, paradoxe, le fantastique prend ici la forme du très vieux marchand de rêves d’une foire ambulante12. Le protagoniste est un homme si serein qu’il ne peut que faire de beaux rêves. Aussi, quand il arrive que les convives discutent à table de leurs rêves effrayants (« chauchavielhas »), il se retrouve sans sujets d’entretien. Il décide donc de se procurer un cauchemar à tout prix, en obtenant un rêve mortel du marchand horrifié ; il l’enferme dans une petite boîte qu'il glisse dans la poche de son pardessus. Mais lors d'une partie de dames au Café de la Bourse, on lui vole son pardessus, et le malheureux voleur mourra de peur à sa place. C'est pourquoi, avec un esprit imperturbable et un goût du paradoxe, le survivant célèbre chaque année l'anniversaire de la mort à laquelle il a échappé. N'est-ce pas là un exemple d'humour noir ? Le récit semble pourtant se moquer subtilement du genre littéraire qu’il aborde obliquement, à savoir les récits d’épouvante, généralement peuplés de cauchemars qui tourmentent les hommes, en choisissant comme protagoniste un monsieur flegmatique qui, pour des raisons futiles, avait fait des pieds et des mains pour déclencher un mauvais rêve.
On éprouve la même impression de parodie de genre, celui des récits d’épouvante, dans « Lo chasteu » (« Le château », 23-28), le troisième du recueil, qui semble d'abord s’exempter du mystère qui entoure les châteaux effrayants « à la Edgar Poe » hantés par les fantômes : l’ennui mortel qui y règne a suffi, semble-t-il, à les chasser. Un domestique dévoué nous raconte la vie routinière d'un comte, routine marquée par l'alternance des saisons, dont il a gratifié son maître pendant des décennies, préparant les vêtements adaptés à ses sorties habituelles dans le parc. Serviteur et maître lient ainsi inextricablement leur vie dans un mécanisme d'horlogerie qui, au bout de trente ans, se bloque. Le serviteur prend conscience de son propre ennui et de celui, tacite, de son maître, tout en y mettant fin avec affection. Il prépare donc un complet d'été pour le Comte (laine fraîche et chapeau de paille !) en plein hiver glacial, complet qui, impassiblement revêtu avant la promenade habituelle, fait mourir son maître de froid. Une lettre de gratitude du Comte, retrouvée après sa mort, le remercie d'avance de l'avoir libéré d'une vie faite d'habitude et devenue insupportable. Alors, où est la faute puisque celui qui dispense la mort libératrice est aux yeux de sa victime son bienfaiteur ? On pourrait imputer le crime au même ennui « mortel » qui les enveloppe tous deux, mais la lettre du comte révèle également une sorte de malédiction du château qui ne laisse aucune issue de secours à ses occupants13. Donc un château sur lequel pèse un sortilège et un aristocrate arrivé au terme de sa lignée. Mais n’a-t-on pas dit au départ qu’il ne s’agissait pas d’un château dans le style coutumier de ceux de Poe ?
Dans « La chaminéia » (« La cheminée », 29-33), on retrouve la malédiction atavique du lieu déclinée dans un humour feutré (et fantastique), en l'occurrence une somptueuse demeure, définie, ce n’est pas un hasard, comme « prèsque un chasteu ». Cette malédiction prend ici la forme plus prosaïque du dysfonctionnement d'une cheminée, celle du grand salon, qui dégage une fumée sournoise et perfide, malgré toutes les mesures prises par le propriétaire de la maison. En effet, cette fumée rétive semble presque l’émanation d’un esprit implacable, d’un genius loci hostile et rebelle à tout exorcisme technologique. Le propriétaire, surmontant son scepticisme d'homme d'études, engage donc un garçon, Jan dau Mas, qui dans le village a la réputation d'être le magicien des cheminées qui ne tirent pas. Le jeune homme se familiarise avec la cheminée et avec la patronne qui l'assiste dans ses manœuvres un peu sorcières (caresses, murmures) qui s'avèrent pourtant efficaces : la cheminée se remet à tirer (et la femme à sourire) ! Oui, elle recommence à tirer, mais seulement en présence de son charmeur, qui rend ses visites de plus en plus fréquentes, jusqu'à ce qu’il demande officiellement à s'installer dans la maison de ses patrons. Un bon tirage et la satisfaction de l'épouse ramènent dans la luxueuse demeure l'ordre souhaité par le mari, absorbé dans ses très arides recherches d’archives14…
Comme le conte du Château hanté, « Lo bibliotecari » (35-39) met en scène un lieu clos et labyrinthique, une bibliothèque, jamais visitée par âme qui vive, mais où pullulent les parasites du livre, propres à « se nourrir de culture ». L'auteur fait une comparaison explicite avec un cimetière où les livres enfouis dans la poussière et les toiles d'araignées sont les vestiges en décomposition d'un savoir inexploité auquel le nom même de la bibliothèque semble faire allusion : la « Font Prigonda », une source profonde de connaissance. Et c’est bien mort à la connaissance que se trouve son bibliothécaire à bout de souffle, un simple ennemi des vers du livre, comme un conservateur de cadavres à la morgue. La demande de prêt qui arrive à l'improviste d'un « pitit òme de piaus rosseus, de figura redonda e risolenta » (38) [petit homme blond, au visage rond et rieur], lequel ouvre la porte de ce caveau pour la première fois depuis tant d’années, déchire l'ombre perpétuelle dans laquelle depuis cinquante ans, six mois et dix-huit jours (durée d'une condamnation sévère), le trente-septième bibliothécaire a vécu emprisonné. Situation kafkaïenne : le pauvre homme passe trop de temps à chercher le volume demandé, il répond trop tard à l'appel de cette requête. Une brève exposition aux rayons du soleil du monde extérieur et la lecture de l’œuvre font comprendre au bibliothécaire où se trouve la vraie vie et où se trouvent les ténèbres, tandis que son corps commence à mourir, couché sur ce livre de révélation : « Le Livre de la Nuit de Geoffrey de Bourdeilles »15.
Toujours dans le sixième récit, « Chambra trenta dos » 41-51), Ganhaire met en scène un lieu de confinement, esquissant une situation qui répond à un thème qui lui est cher et qu'il connaît, étant formé à la profession de médecin : la « réforme morale des études médicales ». Le but de l'expérience menée par un professeur d'université est de provoquer chez les futurs médecins une série de maladies qui les obligent à subir les souffrances du patient, en ressentant de la compassion. L'« exploration des situations limites » et le mécanisme sadique qu'il invente consiste à recruter un groupe d'étudiants en médecine dans l'amphithéâtre de Psychologie Appliquée, section Pathologie de l'anxiété, où on leur annonce qu'on leur inoculera une maladie potentiellement mortelle qui les place devant le tourment suprême :
Vautres, sètz quí per conéisser vòstra mòrt, o per lo mens la possibilitat de vòstra mòrt ! Masdomaisèlas, Mossurs, l’un d’entre vautres surtirá pas viu de quel establiment ! L’un d’entre vautres vai morir de maladiá, lentament ! (44)
[Vous êtes ici pour connaître votre mort, ou, du moins, l'éventualité de votre mort ! Mesdemoiselles messieurs, l’un de vous ne sortira pas d'ici vivant ! L’un de vous mourra de maladie, lentement !].
En fin de compte, deux amis restent en lice, mais l’éventualité imminente de la mort déclenchera en eux les pires sentiments, les vœux les plus impitoyables :
« L’un d’entre vautres. » L’un d’entre vautres : ane, creba, mon Casteths, creba viste que ió suerte d’aquí ! La vita m’espera, ió, e la clinica de papà […] Ane, Casteths, creba, creba viste, te’n prege ! (50)
[« L'un de vous ». L'un de vous : allez, crève, cher Casteth, dépêche-toi, que je sorte d'ici ! La vie m'attend, moi, et la clinique de papa [...] Allez, Casteths, crève, crève vite, s'il te plaît !]
Aucun d'eux ne sortira vivant de la salle 32, leur amitié étant la première à mourir16. C’est aussi d'une amitié, cette fois profonde, face au suicide, que traite le septième récit, « A la vita, a la mòrt » 53-56). Il se présente sous la forme d’un monologue, celui d'un homme au chevet de son ami le plus cher, une mort obstinément recherchée. C'est en fait la seconde fois que l'Antonin dont il est question fait une tentative de suicide. La première fois, son ami l'avait sauvé à temps et l'avait ramené à une vie dont il ne voulait plus. La seconde fois, en revanche, la plus haute expression de l’amitié consiste à laisser l’autre mourir comme il l’a désiré 17. Entre souvenirs de vie partagée et complicité, on est amené à se demander quel est le geste le plus humain : préserver à tout prix la valeur de la vie ou respecter le droit de l'homme à mourir18. Le désespoir, l’exploration de situations limites règnent ici en maître, dans une profonde méditation sur la vie et la mort.
« Lo pes daus sovenirs », 57-73) : encore la puissance maléfique des choses, comme c’était le cas pour la cheminée démoniaque de la magnifique demeure de « La chaminéia ». En parlant de lourdeur, Ganhaire joue ici avec le double sens du terme « poids » : un piano pèse terriblement pour la force d'un homme seul, mais son souvenir odieux pèse encore davantage. « Ti ta ti ta ti ta ta, ta ta ta ti, ta ti ta ta… », quelques notes de la Lettre à Élise, et les souvenirs embusqués depuis des années sont fatalement libérés, comme par un sortilège. Le huitième récit s'ouvre sur le retour au village de celui qui est devenu un vagabond, un homme qui a volontairement renoncé à une vie confortable, choisissant la liberté, afin de laisser derrière lui les mauvais souvenirs d'une enfance faite d'incompréhensions19. Retrouvant un ancien camarade de classe qui a fait fortune dans une entreprise de déménagement, il est embauché par amitié et par pitié. Jan, le clochard nouvellement embauché, tombe par la fenêtre dans une vaine tentative de déplacer un piano d'un étage à l'autre d'une maison. Avant que ses forces ne l'abandonnent, le souvenir des frustrations causées par une étude du piano imposée et sans entrain, par le manque de talent musical que lui reprochaient sa sœur (ah, ce bémol oublié ! « un de quilhs putens de bemòus ! », 65)20 et l'odieuse professeure de piano21, refont surface pour l'affaiblir. Alors Jan, de nouveau seul avec un énième fardeau de la vie (« Degun per m'ajudar [...] dins quela lucha »), s’écroule sous le poids des souvenirs et du piano maléfique, qui semble avoir réveillé toute sa force mauvaise d'attraction et de destruction22.
Pour finir, le neuvième et dernier récit est absolument mystérieux et dégage une atmosphère métaphysique : « La pòrta dau reirlutz », 75-80)23. Le bâtiment fantomatique qui surgit des toits de la vieille ville et qui a toujours fasciné le protagoniste ouvre mystérieusement sa porte. Celui-ci s'insinue dans un jardin plein de ronces et de fleurs pâles, et, passant par derrière (« De queu costat, lo solelh vènia jamai [...] Quela pòrta lai era druberta », 77), pénètre dans les méandres de la maison, qui semblent palpiter une dernière fois aux carillons d'une horloge, puis se refermer pour toujours. L'homme y reste piégé – Fabienne Garnerin assimile avec acuité la maison à une plante carnivore – comme « l'oiseau hypnotisé par le serpent », effrayé et tremblant à l'idée que cette maison est la seule dans laquelle il demeurera parce qu'elle l’a toujours attendu. Retrouvailles avec un mystérieux labyrinthe du temps dans lequel on s’engloutit24. On y reconnaît donc le motif fantastique de la maison / du château hanté, les rouages sans issue de la Bibliothèque, avec son gardien kafkaïen qui y meurt piégé, et la mort comme porte et comme accès à un mystère, le mystère ultime de l'existence25.
« L'ubagu et l'abrigu »
Pour résumer : le cauchemar et la peur, les lieux inexorables du sortilège et de la réclusion26, la bibliothèque borgésienne aux couloirs sans fin, comme celle de la maison mystérieuse du dernier récit (couloir sans fin, sans lumière, couloir de deuil) ; les trente-six bibliothécaires qui ont précédé le dernier, hôtes sacrificiels de la bibliothèque, et le énième élu assis sur un beau fauteuil en cuir (une machine à remonter le temps)27 dans « La Porte de l'Ombre » ; l'horreur de la maladie et de la mort, « le poids insupportable de la vie » (Calvino 1995, 651 citant Leopardi), le poids des souvenirs (la pesanteur !), le mystère au-delà de la vie. Existences faibles lentement érodées par des mécanismes plus grands qu’elles, qui les phagocytent (les habitants du château qui s'ennuient, la généalogie poussiéreuse des bibliothécaires, l’aspirant au suicide à l’écoute d’un autre monde, l'homme stupéfait qui franchit le seuil de la maison ultime et glaciale). Joan Ganhaire interroge (nous interroge) sur le sens de la vie et de la mort. Mais, comme on l'a vu avec Calvino, chez Ganhaire aussi se trouve l’urgence d'une aspiration providentielle à la légèreté qui dilue son côté obscur à la lumière de son incurable sourire (« le jaillissement d'un rire ») : l'opaque [opaco] et l’adret ensoleillé [aprico], l'ombre et le rayon de soleil, le mal et son contrepoison. L’adret est l'étincelle de l'humour (on le reconnaît aussi chez Kafka), le détachement ironique, l'indulgence humaine qui atténue et apaise son indignation et parfois pardonne et absout. C'est le goût du paradoxe qui donne un sens aux apparentes contradictions de la vie. En somme est-il vraiment coupable le serviteur dévoué qui planifie la vie, comme il planifie la mort par le froid de son Comte bien-aimé, dans « Le Château » ? Et comme ils sont ridicules, les rituels minutieux avec lesquels le serviteur cérémonieux prépare les vêtements de son “mannequin” ! Et l'ange de lumière qui ouvre la porte de la bibliothèque, déchirant les ténèbres dans lesquelles vit le bibliothécaire, ne demande-t-il pas un Livre de la Nuit, où l'on ne parle que de « la lumière, de la vie, du soleil qui ne brûle pas les yeux » ? C’est la même lutte entre soleil et vie et ombre et mort que dans « La porte de l’ombre »28. Et dans le deuxième récit, le cauchemar déchaîné par sorcellerie ne va-t-il pas tuer un malheureux voleur, jouet du destin, et non celui qui l'a procuré et qui, imperturbable, célèbre, sur la tombe de l'autre, chaque anniversaire de sa mort manquée ? Ainsi, même les objets s’animent d’une vie propre et, avec une force néfaste, opèrent leur lente vengeance (« Le poids des souvenirs ») ou mettent subtilement à mal les propriétaires de la maison, comme la fumée dans « La chaminéia ». Une trève dans l’opaque le plus profond, trève ironique et désopilante, telle paraît être « La chaminéia » : pourquoi la cheminée de deux riches dominants dégage-t-elle de la fumée, dans un ménage qui semble parfait, du moins au maître de maison distrait ? Et comme elle est spirituelle et malicieuse l'« étrange conclusion » du ramoneur : « vòstra chaminéia es amorosa de ió » (le genre féminin rend parfait l'échange avec le sujet réel). Et le remède (le prodigieux déboucheur de cheminée) est-il pire que le mal, ou est-il, paradoxalement, le prix acceptable pour une vie tranquille ?29 Finalement, même dans le premier livre de Ganhaire, Lo libre dau reirlutz, on note ce mélange de désespoir et de rire indulgent que Fabienne Garnerin relevait avec finesse dans son étude Entre rire et désespoir.
« Entre chouettes solitaires »
Assurément, même d'après ce qui ressort de ces simples résumés du Libre dau reirlutz, sa propension au fantastique s'oriente vers des auteurs que Ganhaire lui-même reconnaît parmi ses influences littéraires dominantes30. Si nous avons isolé le premier récit, « Soletat » (« Solitude », 9-13), c'est qu'entre-temps nous assistons à une variation sur un thème, celui de la communication entre l'homme et l'animal, qui aura beaucoup d’importance dans une grande partie de l'œuvre de Ganhaire, notamment celle à caractère comique et à décor rural. Et puis parce qu'il nous semble qu’il ouvre une petite fenêtre vers l'imaginaire de Calvino. L'ombre qui enveloppe ou effleure les personnages du recueil dau reirlutz, concerne précisément, dans le premier récit, l'état d’inadaptation du protagoniste par rapport à la société humaine, qui se manifeste dans son incapacité à communiquer avec les individus de son espèce. D'où son état de solitude douloureuse (Garnerin, 65). Mais l'homme est un animal social, et il lui est difficile de résister à la recherche de quelque forme d'amitié31... même si elle est quelque peu inhabituelle. En écoutant un soir la voix de trois chouettes qui semblent se répondre :
…i boirí la miá, que faguí tant choitonanta coma poguí. Per ma granda vergonha, un silenci blasmaire tombet. Au risque de far se poitinhar los auseus, torní començar, un còp, dos còps, en m’aplicar un pauc mai. La votz dau nòrd fuguet la prumiera a respondre, seguda per la de l’áutan, puei per la dau pluiau. A mon torn vengut, plací ma choitonada (10).
[…j'y ai mêlé la mienne, que j'ai rendue le plus hululante possible. À ma grande honte, s'installa un silence désapprobateur. Au risque de décourager les oiseaux, j'ai recommencé, une fois, deux fois, de plus en plus convaincu. La voix du nord fut la première à répondre, suivie par celle du levant, puis celle du couchant. Quand mon tour est venu, j'ai joué ma part de chouette]
La solitude est telle, telle est l'urgence de parler à quelqu'un, l’urgence de communion, d'appartenance, qu'elle incite le solitaire du récit à tenter un saut d'espèce pour chercher une entente avec trois chouettes. Il étudie leur chant distinct (une voix un peu rauque, une autre un peu tremblante), s'abandonnant à l'imagination d'une vieille chouette au plumage ébouriffé et aux yeux dorés. Bientôt les trois voix deviennent, pour le solitaire, « mas tres amijas » :
mas tres amijas, mas tres votz de la nuech, contunhatz de me parlar, uflatz enquera un còp vòstres gorjarèus ! Enquera un còp, laissatz-me vos respondre, ió que ai degun a qui parlar ! Si vautras sábiatz la jòia prigonda que sente, vos restariatz jamai, vautras que m’ávetz prèsque tornat lo gost de viure, a ió per qui los jorns son ren pus nonmàs l’espera de la nuech plena de nòstra conversacion ! (11).
[Mes trois amies, mes trois voix de la nuit, continuez à me parler, gonflez encore une fois votre gorge ! Encore une fois laissez-moi vous répondre, je n'ai personne à qui parler ! Si vous saviez la joie profonde que j'éprouve, vous ne vous tairiez jamais, vous qui m’avez presque redonné le goût de vivre, à moi pour qui les jours ne sont que l'attente de la nuit pleine de notre conversation !]
Il arrive un jour que le solitaire a besoin de descendre au village pour faire quelques courses, quelques achats, et au Café de la Poste pour s'offrir une bonne bière. Là, par hasard, il fait une découverte bouleversante :
Tot d’un còp, una votz familhara me faguet virar lo chais : qu’èra lo choitonament rauche de Giraudon. Vanceis que ió aguès gut lo temps de me damandar çò que fásia quí mon amija, la veguí, ma choita daus uelhs d’òr plens de chausas ancianas : qu’era un gròs goiardeu de piaus rosseus, sadol coma una sauma, que sos companhons, end daus rires bèstias, encoratjavan de la votz : « ane, Marceu, choitona un còp de mai ! Ane, enquera ! » Et lo goiat uchet son crit dolent tres, quatre, cinc còps, vanceis de picar dau nas, en sangutar, dins una mara de vin blanc (11-12).
[Tout d'un coup, une voix familière me fit me retourner : c'était le cri rauque de Giraudon. Avant d'avoir eu le temps de me demander ce que faisait là mon amie, je l'ai vue, ma chouette aux yeux d'or pleine de choses d'autrefois : c'était un gros garçon fauve, ivre mort, que ses amis, avec des ricanements stupides, encourageaient de la voix : « Allez, Marceu, fais encore la chouette ! Allez, encore ! » Et le garçon poussa son cri douloureux trois, quatre, cinq fois, avant de s'endormir en sanglotant dans une mare de vin blanc.]
« E lo goiat uchet son crit dolent » : ce n'est pas un hasard si les marginaux « des quatre vents »32 s'identifient à des animaux timides et nocturnes, dont le cri est associé à une réputation inquiétante, un planh lugubre33. Face au doute atroce que les deux autres « chouettes » ne soient aussi que des idiots, de pauvres types trompés qui « cresiàn boirar aus auseus », lui, la « choita de Puei Jobert », les guette et les surprend l'un après l'autre en train d’imiter les hiboux dans ce « rituau » habituel et absurde. La déception et l’indignation déclenchent d’abord dans l’homme un accès d’invective :
Lur vólia dire que nautres quatre éram daus paubres tipes, que áviam nòstra plaça ni demest los òmes, nimai demest los auseus, mai los mai sornes, los mai maudichs (13).
[J'avais envie de leur dire que nous étions tous les quatre des pauvres types, que nous n'avions notre place ni parmi les hommes ni parmi les oiseaux, même les plus tristes, les plus maudits.]
Mais l’indignation fait place à la pitié pour la condition humaine des trois autres, et pour la sienne propre, qui le réduit à l’indulgence, prolongeant cette illusion chorale34 :
Mas vanceis de tuar per totjorn quils tres choitonaments d’opereta, tendí l’aurelha un dernier còp : nòrd, áutan, plueiau… Giraudon, Puei Negre, Mironcelas… Laidonc, auví ; auví que lo gròs goiat rosseu esperava un pitit pauc vanceis de tornar uchar son crit, mai dolent enquera qu’au mai prigond de sa sadolariá : qu’era ió qu’eu esperava, qu’era ió que mancava.
Laidonc, en plaça de ma malediccion, en plaça de mon aguissança, tirí dins la nuech lo mai brave choitonament que se siá jamai envolat d’un gorjareu d’òme (13).
[Mais avant de faire taire à jamais ces trois cris d'opérette, j'ai tendu l’oreille une dernière fois : nord, est, ouest... Giraudoux, Puy Nègre ,Mironcelles... Alors, j'ai compris ; j'ai compris que le grand garçon fauve attendait un peu avant de pousser à nouveau son cri, plus douloureux encore que du fond de son ivresse : c'était moi qu'il attendait, c'était moi qui manquais.
Alors, au lieu de ma malédiction, au lieu de ma haine, j'ai poussé dans la nuit le plus beau cri de chouette qui soit jamais sorti de la gorge d'un homme.]
Homme ou chouette, c'était lui que les autres attendaient pour combler leurs solitudes35. Le protagoniste de « Soletat » est donc un homme à la merci de son besoin de communication, qu'il a l’illusion de satisfaire en dialoguant avec la famille ailée. Illusion et désillusion. La première erreur survient précisément lorsque le solitaire croit s'insinuer dans un autre domaine linguistique, en imitant le cri des chouettes (« me damandí [...] si ávian pas conegut l'òme dernier la votz » (10), un cri déjà contrefait dès le départ car imité (on le saura plus tard) par des êtres humains tout aussi solitaires. La confluence (et l’échange) la plus évidente des champs lexicaux est donc celle entre la voix humaine et le cri animal, étant donné que, tragiquement, ils se révéleront tous émis par les mêmes locuteurs. Le récit de Ganhaire est donc savamment construit sur l'ambiguïté et l'intersection entre les domaines humain et ornithologique, à partir d’enchevêtrements lexicaux qui expriment leur fusion et leur confusion. Par exemple, les ressources linguistiques de Ganhaire lui permettent de construire une constellation sémantique homogène à partir de choita, la chouette. En effet, à cette voix limousine sont liés les différents dérivés choitonar, choitonanta, choitonada, choitonament, qui désignent son cri dans un sens spécifique36, en alternance avec le terme votz, également commun aux humains37. Cela n'est pas accordé à la langue italienne38. Et la perception déformée (souhaitée) du protagoniste finit par changer l’enchevêtrement des choitonaments en une véritable conversation et en un dialogue humain : nòstre parladís, (10) ; contunhatz de me parlar, nòstra conversacion, (11), jusqu'à ce qu'il découvre que ces « causeries » ne sont que de vulgaires « choitonaments d'opereta » (13). Il existe d’autres infiltrations lexicales de cette contamination ridicule – ou pathétique – par exemple, ce ne peut être un hasard si le protagoniste, descendu au village pour s'occuper de quelques affaires, désigne son refuge situé « a la cima d’un terme », au sommet d'une colline (Puei Jobert), par le terme familier de quincaròla (11), c’est-à-dire cime, sommet d'un arbre (Lavalade 471). Le traducteur français, dans ce cas, utilise perchoir (italien trespolo, posatoio). Enjucat (12) va dans le même sens, faisant référence à l'une des quatre fausses chouettes que le protagoniste aperçoit juchée sur une branche de chêne, aspect visible de son identification à l'oiseau. Cette « chouette perchée » a fait s’envoler ma pensée vers Calvino.
Le solitaire qui tente d'établir un dialogue avec les animaux n'est pas unique dans l'univers littéraire de Ganhaire. La chaîne entre l'homme et l'animal, en effet, ne connaît aucune interruption, depuis le véritable ( et malheureux) hybride du leberon, l'homme-loup du roman Lo darrier daus Lobaterras, jusqu'à l'intimité empathique qui s’instaure dans le monde rural entre paysans et animaux domestiques, entre lesquels se cimente un système de signes partagés et un dialogue privilégié. Ou bien encore l'entente complice entre « l'adulte solitaire » et le lièvre « conteur » dans Çò-ditz la Pès-Nuts. Ce thème traverse notamment le monde paysan reflété en tonalité comique dans des œuvres comme Cronicas de Vent-l'i-Bufa (récit collectif et quotidien des habitants du village imaginaire de Chantagreu sus Claraiga (2016), ou Los braves jorns de Perdilhòta (2013). En effet, c'est un monde où tous les éléments communiquent avec les hommes, jusqu’au son des cloches (« lo lengatge de las clòchas ») porté par les vents (présents eux aussi dans la géographie de « Soletat »)39 à travers les collines et les vallées, et que le paysan transforme en avertissements verbaux pour réguler le rythme quotidien du travail des champs (2013, 18). Fabienne Garnerin relève très bien ce concert de signes, cette communion affective et cette relation entre l'homme et l'animal (le voile noir du deuil par exemple) :
Omniprésents dans le monde rural, les animaux domestiques font partie de la famille. Ils en partagent les joies et les peines, auxquelles ils sont officiellement associés par des pratiques traditionnelles. À la mort du père, la grand-mère, l'héroïne de la nouvelle « La mamet dispareguda » [La grand-mère disparue] « deguet 'nar parlar aus bestiaus e botar un pelhon negre aus bornats » [dut aller parler aux bêtes et mettre u chiffon noir sur les ruches]. Bêtes et abeilles comprendront les signes rituels… (Garnerin, 53).
Et il est significatif que cette inclination pour les animaux de compagnie concerne particulièrement les hommes célibataires, poursuit Fabienne Garnerin :
Les animaux familiers sont dignes d'affection, autant que les hommes et parfois plus. Les célibataires ou veufs qui n’ont personne à qui parler, ont de longues conversations avec leur chien ou leur animal de compagnie. Dans la nouvelle « Un meschent bestiau », Tranuja, vieux célibataire40, a pour compagnie son ânesse Friquette41.
Alors pourquoi l’entente homme-chouette s'avère-t-elle si malheureuse dans « Soletat » ? Parce qu’en plus d’un hybride non résolu, nous sommes en présence d’une fiction humaine douloureuse. Ou plutôt, une suggestion amusante pourrait même invoquer l'ancienne méthode de vénerie, la chasse à la chouette, utilisée comme leurre (en italien civettare), où l'on retrouve l'idée de tromperie, de piège, de camouflage. Appât auquel succombe accidentellement le solitaire de « Soletat ». Quoi qu'il en soit, le caractère fictif et ambivalent de ce jeu de rôle entretient tout au long du récit l’impression persistante d’une pointe comique, d'une plaisanterie faite aux dépens d’un homme naïf et vulnérable. C’est finalement quelque chose qui ressemble au début à une farce de village42 (rappelant un peu l'ambiance des nhòrlas tant aimées par Ganhaire)43, dont la charge humoristique, à mon avis, ne s’efface pas complètement, même si, dans le cours du récit, le comique cède peu à peu à son envers, plus pathétique et plus dramatique, celui de la pitié pour la condition humaine. Jusqu'à la note culminante du final. Bref, ici aussi cohabitent rire et désespoir.
« Le Baron perché et les merles de Palomar »
Au terme de son long voyage à travers les Contes italiens (1993), Calvino se demandait : « Est-ce que je pourrai remettre les pieds sur terre ? ». La question que s'est posée l'écrivain ne peut que nous conduire vers Le Baron perché (1991, 547-777), de 1957, né d'une gestation commune avec les Contes italiens. Cosimo, le protagoniste, ne remettra littéralement plus jamais les pieds sur terre. Comme on le sait, le 15 juin 1767, le petit Cosimo Piovasco di Rondò se rebelle contre la discipline familiale (et un plat d'escargots) en allant vivre sur les arbres de la villa, la Villa d'Ombrosa. Et là, il vivra jusqu'à un âge avancé, séparé des autres, mais participant pleinement à la philosophie et à l'histoire de son temps. La vie culturelle parisienne le célèbre comme « L'homme sauvage d'Ombreuse » (697) et Voltaire parle de lui comme « ce fameux philosophe qui vit sur les arbres comme un singe » (698). Cosimo, « sur les arbres », tente d'attirer l'attention de sa bien-aimée Viola avec des cris d'oiseaux : le cri de la bécasse, le sifflement de la perdrix grise, le cri triste du pluvier, le roucoulement de la huppe, le trille du pipit (707-708). Vêtu de plumes, il devient le paladin des oiseaux et écrit même des traités, comme, sans surprise, Le Cri du Merle et Les Dialogues des Hiboux (736). Les chouettes apparaissent, avec d'autres diableries et crânes d'animaux, dans les rituels de la « Franc-maçonnerie en plein air » (746). Comme toute l'œuvre de Calvino, celle-ci est elle aussi imprégnée d'un esprit comico-fantastique44, une veine qui constitue certainement un pont avec Ganhaire. Cosimo, champion de la légèreté (sur le point de mourir, il s'envolera en s’accrochant à une montgolfière) reste un homme perché comme la chouette la plus mimétique de « Soletat », il est devenu sauvage, mais jamais aliéné, ni même désespéré, comme les solitaires du récit de Ganhaire. Ce livre de Calvino est aussi le seul point de contact explicite avec Ganhaire : « D'Italo Calvino, je n'ai lu que “Le Baron perché”. Il y a très longtemps et je ne m’en souviens que très peu. Je vais le relire », me déclare-t-il dans un email à propos du « roman arboricole » de Calvino. « Ça n’a sûrement eu aucune influence sur mes écrits » : ce sont en fait de simples points de convergence qui, s'ils ne suffisent pas à fonder une parenté littéraire et ne se présentent donc pas comme une réelle influence, tracent néanmoins, comme dans le cas du reirlutz–ubagu, des affinités d’imagination sur lesquelles, à mon avis, il n'est pas inutile de réfléchir.
Nous arrivons ainsi au thème qui concerne le langage humain et animal, avec leurs possibles échanges communicatifs45, thème qui présente d'intéressantes analogies entre Ganhaire et Calvino. Il existe un livre célèbre d'Italo Calvino, Palomar, dans lequel il met le protagoniste taciturne, solitaire et maussade aux prises avec la complexité de l'univers qui l'entoure (Calvino 1992 : 871-979). Le monde animal y est très présent46, objet d'observations minutieuses (il porte le nom du célèbre observatoire astronomique, qui à son tour renvoie à un pigeonnier / colombier : palomar) et de réflexions anthropologico-culturelles sur leur comportement et leur langue. Dans « Le sifflet du merle », notamment, Palomar, en plus de se lancer dans une classification des cris des oiseaux (pépiements, trilles, sifflements, gloussements, roulades) « en catégories de complexité croissante », s'interroge sur le sens du chant chez un couple de merles, avançant des analogies et des interférences avec le mode de communication humaine. Analogies qui finissent par impliquer le couple Palomar et madame, comparé aux « merles mari et femme », et leurs conversations respectives (Calvino 1992, 891-896)47 :
Le sifflet du merle a ceci de spécial : il est identique au sifflet humain, de quelqu'un qui n’est pas particulièrement doué pour siffler [...]. Au bout d'un moment le sifflement est répété – par le même merle ou par son conjoint – [...] S'il s'agit d'un dialogue, chaque mesure arrive après une longue réflexion. Mais est-ce un dialogue, ou bien chaque merle siffle-t-il pour lui-même et pas pour l'autre ? […] Ou bien tout le dialogue consiste à dire à l'autre : « Je suis là », et la longueur des pauses ajoute à la phrase le sens d'un « encore », comme pour dire : « Je suis encore là, c'est toujours moi » Et si le sens du message était dans la pause et non dans le coup de sifflet ? Et si c'était en silence que les merles se parlaient § […] Ou alors personne ne peut comprendre personne : tout merle croit avoir mis dans le sifflement une signification fondamentale pour lui, mais que lui seul comprend ; l'autre lui réplique quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit ; c'est un dialogue de sourds, une conversation sans queue ni tête. Mais les dialogues humains sont-ils quelque chose de différent ? (Calvino 1992, 892-893).
Conservant la complexité de la « sagesse douteuse » d'un Calvino qui endosse le rôle de monsieur Palomar, les observations sur la signification du sifflement du merle présentent des similitudes avec celles sur le cri de la chouette du solitaire de Ganhaire, y compris la tentative de dialogue que Palomar entreprend avec les merles (Calvino 1992, 895-896) :
Après avoir écouté attentivement le sifflement du merle, il essaie de le répéter le plus fidèlement possible. S’ensuit un silence perplexe, comme si son message nécessitait un examen attentif ; puis un sifflement similaire résonne, dont monsieur Palomar ne sait si c'est une réponse à lui, ou la preuve que son sifflet est si différent que les merles n'en sont pas du tout dérangés et reprennent leur dialogue entre eux comme si de rien n'était. Ils continuent de siffler et de s'interroger avec perplexité, lui et les merles.
Il en diffère, bien entendu, comme dans le cas de « Dall'opaco », une prose qui chez Calvino s'organise selon une pensée problématique et systématique complexe, tandis que la plume de Ganhaire reste concentrée sur les aspects humains des événements, et sa veine se confirme comme étant savoureusement narrative.
« cette unité et parenté de tout ce qui existe dans le monde, les choses et les êtres vivants »
Faune, flore, règne minéral, firmament incorporent dans leur substance commune ce que l'on considère habituellement comme humain, comme un ensemble de qualités corporelles, psychologiques et morales" (905).
Cela correspond à la seule philosophie certaine des Métamorphoses : « cette unité et parenté de tout ce qui existe dans le monde, les choses et les êtres vivants » (914).
C'est ainsi que Calvino commente la contiguïté dieux-hommes-nature, dans un très bel essai sur les Métamorphoses d'Ovide, un maître qui l'accompagnera jusqu'à la leçon américaine sur la « Légèreté »48. La Villa Meridiana, à Sanremo, parc d'acclimatation de plantes tropicales, constituait pour Italo un petit Éden, avec la Villa Terralba de son grand-père Calvino, l'horizon de l'imaginaire de ses “Ancêtres”. Trilogie des ancêtres que Calvino lui-même a définie à travers l'image emblématique d'un arbre généalogique de l'homme contemporain. C'était le San Remo (c'est ainsi qu’il l’orthographiait) de son enfance, une station balnéaire où se conjuguaient la mer, la campagne et les espaces urbains, sa ville perdue plus tard à cause d'une spéculation immobilière effrénée. Quant à la culture familiale, on sait que le père de Calvino était agronome et sa mère botaniste et impliquée dans la protection des oiseaux. Même si Calvino cherchera dans la littérature, outre l'héritage scientifique familial, une de ses clés pour accéder à la nature, la recherche demeure en lui d'un idéal où le monde façonné par l'homme devrait vivre en harmonie et en communion avec l'environnement naturel49. Cet aspect est déjà trop connu et étudié pour qu’il faille s'y attarder ici. En particulier, Les animaux de Calvino, titre d'un fameux essai critique, interroge récemment l'attention précoce et permanente de Calvino envers l'autre non humain (on parle d'« humanisme non anthropocentrique »), à la lumière d'une vision globale qui unit l'homme et l'environnement dans un seul destin sur terre50.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que les chèvres pensaient à Bikini ? et les chats dans les maisons bombardées ? et les chiens dans une zone de guerre ? et le poisson quand les torpilles explosent ? Comment nous auraient-ils jugé, nous, les hommes, dans ces moments-là, dans leur logique qui existe aussi, d'autant plus élémentaire, d'autant plus – j'allais dire – humaine ? […] Oui, nous devons une explication aux animaux, nous devons leur présenter nos excuses si de temps en temps nous bouleversons ce monde qui est aussi le leur51.
L'écocritique d'aujourd'hui bénéficierait grandement, à notre avis, de la connaissance encore peu répandue d'une grande partie de la littérature occitane moderne et contemporaine, pour ne citer qu'un nom qui présente des affinités avec Ganhaire : Marcela Delpastre52.
Quant à Ganhaire, son amour pour la nature, les arbres, les plantes, les sources, les cours d'eau de son terroir est omniprésent ainsi que le montre Fabienne Garnerin dans une partie de son étude sur « l’Univers littéraire » de Ganhaire intitulée « Une Aquitaine recomposée » (27-38). On a parlé d'un animisme étendu au monde végétal et aux choses elles-mêmes qui parfois prennent vie sous une forme hostile (dans le Libre dau reirlutz, le piano, la cheminée, la « petite boîte » qui contient le cauchemar) ou ludique (le béret symbiotique de Maxime)53, animisme de la vieille culture paysanne, qui vient fondre dans une seule chaîne les systèmes de signes des différents règnes :
L'animisme de Maxime mêle humains, animaux et objets dans un collectif unique qu'on pourrait qualifier de familial, où se retrouvent la Zélia, Yvette et son mari, la mule Friquette, le chien Ranfort ainsi que les bêtes présentes dans la ferme, son béret bien aimé, l'autre béret qu'il déteste et lui-même. Sa mule Friquette et son chien Ranfort sont ses deux confidents. Ranfort fait le lien entre les éléments non-humains extérieurs à la maison et les humains qui y habitent […] Ranfort sait participer au langage du vent, des tilleuls et de la pluie ; mais il sait aussi communiquer avec les hommes. (Garnerin, 216-217)
Cet aspect également, déjà recensé et analysé avec sa perspicacité habituelle, se retrouve ici une fois pour toutes dans l'œuvre critique de Fabienne Garnerin.
Sous des formes parfois semblables, parfois différentes, mais non irréconciliables, les deux écrivains nous parlent de la nature, des arbres et des animaux. À la fin du Baron perché, Calvino, constatant mélancoliquement « Ombrosa n’existe plus », parle du filet d'encre qui se ramifie, bifurque, se tord, « se dénoue et enveloppe une dernière grappe insensée de mots idées rêves et c'est fini »54. Bref, l'écriture elle-même devient raisins, pépins, feuilles, nuages et régénère les anciennes plantes de la mémoire, perdues à cause de « la fureur de la hache ». Chez Ganhaire, la forêt de Feytaud a été défrichée pour les intérêts des hommes dans Lo darrier daus Lobaterras. Dans une sorte de sensibilité « écologique » de la littérature, Ganhaire, avec son filet d'encre, a enrichi le patrimoine culturel de son pays, son paysage littéraire, en les imprégnant de la sève de son imagination (« totjorn a un piau dau fantastique… »)55. Par ailleurs, pour Ganhaire, consacrer tout son engagement littéraire à la langue limousine, c'était fertiliser son potentiel expressif et la renforcer contre l'érosion à laquelle des siècles d'hégémonie de la langue française l'ont condamnée. Acte de loyauté envers son identité occitane retrouvée, et de réparation envers les blessures causée par l'histoire à une culture minorisée. Acte fier et aimant, propre au médecin qui traite ses patients avec des mots qui leur sont familiers et renforce, avec son écriture talentueuse, les racines de la langue de sa culture.