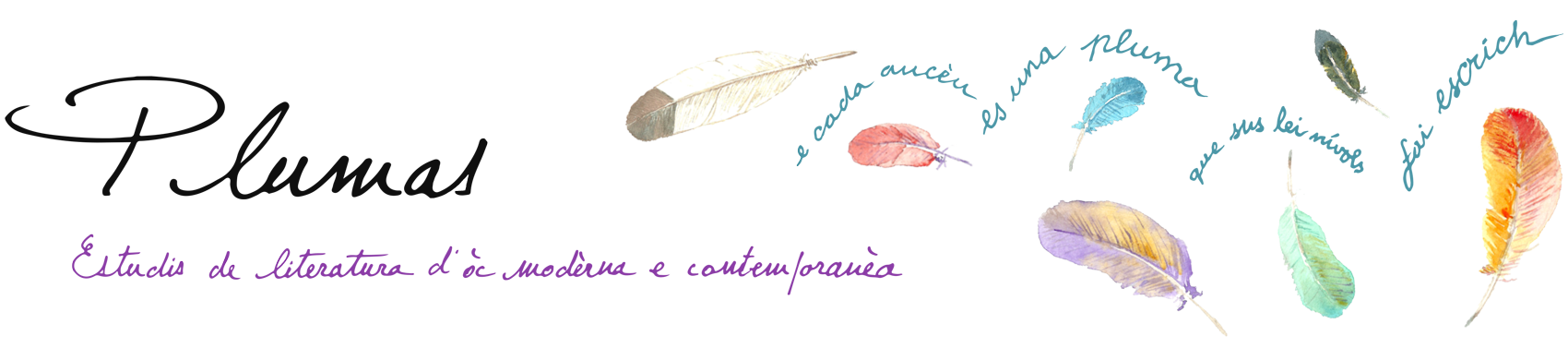Bernard Lesfargues, dans la langue des siens, l’occitan du Périgord, encore languedocien et déjà limousin, fut tout au long de son existence, poète, comme il fut aussi, très vite, traducteur. Traducteur des autres, en espagnol et en catalan, mais aussi traducteur de soi-même, autotraducteur, ou encore passeur de ses propres mots, la plupart du temps mais pas toujours.
Bernard Lesfargues dans son bureau à Église-Neuve-d’Issac, archives familiales
Traducteur, Lesfargues n’a guère traduit qu’en français prosateurs et, plus rarement, poètes. Je ne connais pas de lui de traductions en occitan qui aient été publiées (ou si peu ?). L’occitan, pour lui, a été, continûment, langue du poème. Mais pas seulement : pour en rester dans le domaine de l’écriture, le plus facilement cernable dans son cas comme dans plus d’un autre, il fut aussi dans cette langue un prosateur, essentiellement dans le domaine de la critique (littéraire surtout). Pendant toute une période, il fit partie des voix critiques présentes dans la principale revue littéraire d’expression volontairement panoccitane, Oc. Il y traita de littérature d’oc, comme il se doit, mais aussi, essentiellement, de littérature catalane, l’une de ses deux langues élues dans son activité jamais délaissée au fil des années de traducteur.
On trouva plus rarement son nom dans d’autres publications occitanes, y compris dans celles qu’il suivit attentivement, depuis leurs premiers commencements, et qu’il accompagna avec intérêt et ferveur. Je pense en particulier à la revue Jorn1, dont les débuts, autour de lui et de son compère Jean-Marie Auzias, furent à plus d’un titre lyonnais (Lyon était la ville où, comme Auzias, il habitait encore, depuis de longues années, avant qu’il la quitte pour le village familial périgourdin d’Église Neuve d’Issac, entre Mussidan et Bergerac).
Tout cela fait que si on laisse de côté ses nombreuses traductions en français d’auteurs ibériques, c’est en parcourant le développement de son œuvre poétique que l’on peut appréhender, entre la fin des années 1940 et 2018, l’année de sa disparition, le versant proprement littéraire des activités créatrices de Lesfargues, « entre deux langues ». Un développement en pointillé, comme Lesfargues lui-même, à plusieurs reprises, l’avait reconnu et même, jusqu’à un certain point revendiqué. Il suffit pour s’en convaincre de relire, par exemple, ce qu’il répondait à Jean Larzac et Yves Rouquette dans la revue Viure en 1966. Le premier, dans un précédent numéro de la même revue2 (Larzac 1965, 3), lui avait, amicalement il s’entend, reproché de s’être tu comme écrivain et poète pendant trop longtemps : « Ara nos cal ben constatar que Max Roqueta se calèt vint ans, Bayle trenta quatre, Allier sètze, Lesfargas tretze3 »… Treize années, donc, entre le premier recueil de Lesfargues, Cap de l’aiga, et le deuxième, Còr prendre. Còr prendre dont Yves Rouquette avait, dans le même numéro de Viure encore, publié une recension à la fois laudative et assez sévèrement critique : « Bernat Lesfargas escriu pas pro. A pròva aquel Còr prendre ont, per arribar a barrar un recuèlh pichonèl, es obligat de publicar de causas coma ‟Mos pinhièrs” o ‟Lo cant de la viena” qu’es normal de los trapar dins los tiradors d’un vertadièr poèta mas de segur pas enlòc mai… E tretze ans separan pr’aquò los 15 poèmas de Cap de l’aiga dels 18 poèmas de Còr prendre ! Dètz-e-uòch poèmas, bons o marrits, en tretze ans4… » (Ives Roqueta 1966, 39).
À ces remarques5 Lesfargues, donc, répliquait assez longuement dans le numéro 7 de Viure. Le ton général de son intervention était plutôt celui d’une certaine résignation quant à une situation qu’il estimait globalement négative, aussi bien en ce qui concernait la situation de la langue elle-même et de ses usages que celle des écrivains, sans véritables débouchés éditoriaux dans des délais raisonnables et par cela même peu encouragés à poursuivre leur œuvre6. Il qualifie dans ce texte la vie littéraire d’oc d’« estringada ». « De tant rarefiada coma es, se’n manca pas de gaire que siá nula. Vivem dins la luna. Defauta l’oxigen. Un vent fred amb de bofaradas ponhentas7 ».
Plus tard, beaucoup plus tard, en 2014, à l’occasion de la sortie d’un recueil de poèmes, Lesfargues est revenu, autrement et dans des circonstances bien différentes, sur son itinéraire de poète, et de poète d’oc. Il s’agit de la postface à un court ensemble de textes en français, Odes et autres poèmes, publié par la maison d’édition qu’il avait autrefois fondée et animée de longues années durant, Fédérop, alors reprise en charge depuis quelques années déjà en Périgord par Bernadette Paringaux, hispanisante comme lui, et l’angliciste Jean-Paul Blot. Le début de ce texte mérite d’être reproduit :
Si j’ai réclamé, parfois à grands cris, que l’occitan soit en dignité l’égal de français ; si j’ai reproché à beaucoup d’écrivains de cracher sur le parler qu’ils tenaient de leurs parents, mais qu’ils méprisaient et traitaient de patois, je n’ai jamais cessé de dire que le français est une très belle langue, une langue qui se prêtait moins que ses voisines à l’écriture poétique. C’est précisément à cause de ce handicap initial qu’elle a pu engendrer des Villon, des Racine, des Hugo, des Baudelaire, des Aragon…
Pourquoi ne pas rappeler que mon premier recueil était entièrement écrit en français (Premiers Poèmes, 1947). Mais le français se portait bien. Il n’avait pas besoin de moi ni de mes poèmes pour le défendre et l’illustrer. C'est ainsi que je décidai de ne plus écrire de poèmes qu’en occitan, et mon deuxième recueil, aussi mince que le premier, s’appelait Cap de l'aiga, en 1952.
On cite parfois ce passage très enlevé en s’arrêtant là. Mais immédiatement après Lesfargues se rattrape, car il n’ignore pas que ses lecteurs (plus nombreux qu’il l’imagine) sont informés du fait qu’il a continué d’écrire aussi des poèmes en français après Cap de l’aiga. Ce qu’il admet alors très volontiers, évoquant les multiples manuscrits qui sommeillent dans ses tiroirs, puis expliquant que quand un premier vers lui vient en français, c’est dans cette langue qu’il écrit son poème ; et qu’il en va de même pour l’occitan quand c’est cette langue qui fait naître le commencement de quelque chose. « Le français et l’occitan disent souvent la même chose, mais la disent différemment ». En outre, Lesfargues affirme accompagner toujours la version occitane d’un poème « donné » dans cette langue d’une version française. On en tirera, avec prudence, la conclusion qu’il écrit, sinon entre deux langues, en tout cas avec l’une et l’autre en miroir plus ou moins déformant.
Sauf exceptions, la plupart du temps provisoires (quand un poème est publié dans une revue qui n’accepte que l’occitan8), à peu près tous les poèmes dans cette langue de Lesfargues ont été traduits par lui-même en français. La seule exception notable concerne Còr prendre, publié par les soins du jury du prix Jaufré Rudel, récompense que ce recueil avait obtenue : c’est son ami Jean-Marie Auzias, lui-même poète, qui s’était chargé de faire passer les textes d’une langue à l’autre9.
On peut dire, à cet égard, que l’écriture poétique de Lesfargues s’apparente à diverses situations auxquelles elle ne se rattache pas totalement, mais qui la nourrissent et l’orientent. La pratique ininterrompue de la traduction, comme attitude devant la langue et par rapport à la littérature, est sans doute la composante centrale de cette position plutôt originale. Une originalité que vient renforcer, probablement, l’identification plutôt singulière du poète en son temps, et plus encore à ses débuts, naviguant pour l’essentiel, mais pas uniquement, entre occitan (« patois »), catalan, espagnol et français. Quand, entre ses Premiers poèmes (1947) et Cap de l’aiga (1952), Lesfargues changeait de langue « première » dans son écriture poétique, il délimitait dans ces deux minces recueils, « minces » pour reprendre la juste caractérisation du second par Yves Rouquette, un espace d’écriture (ou de voix) auquel, en gros, il resta fidèle, en substance, tout au long de son itinéraire, sous le signe (comme on parlerait d’un signe astral) de la traduction. Cap de l’aiga donne à lire l’occitan et le français en vis-à-vis, et cet apparentement n’est pas, dès alors, une simple règle héritée du siècle précédent (Frédéric Mistral, Théodore Aubanel) ou de ses maîtres des générations immédiatement antérieures (René Nelli10, Max Rouquette), mais une source profondément ancrée en lui, une origine véritable et jamais abandonnée. Rien n’indique dans ce recueil inaugural en occitan que la version française est de l’auteur, mais si tel n’était pas le cas, on peut penser que le nom du traducteur aurait été indiqué. Si bien que l’auteur mentionné sur la première page de couverture (Bernart Lesfargues) est très probablement celui des deux textes proposés aux lecteurs. Le fait que le livre soit placé sous le patronage de « St. Joan de la Crotz » et que le nom du grand mystique espagnol du XVIe siècle (Juan de la Cruz, Jean de la Croix en français) soit traduit en occitan et que la citation placée en exergue soit donnée d’abord en occitan, puis après seulement dans sa langue d’origine, tout cela n’est pas anodin : « Que sabi ben la font que sorgenta e que riva encara faga nuech » précède « Que bien sé yo la fuente que mana y corre aunque es de noche ». Ce mélange des langues illustre et incarne le chemin désormais emprunté par le poète. Un équilibre entre français et occitan, que la coprésence de l’espagnol et, en filigrane, du catalan, enrichissent et renforcent.
Le titre Cap de l’aiga n’est pas traduit. On le rendit par la suite en français par Mère des eaux, mais d’autres versions circulèrent aussi. Lesfargues, qui n’avait jamais refusé cette traduction, expliqua plus tard à plusieurs reprises l’origine d’un titre dont la beauté revêtait pour ses lecteurs quelque chose de mystérieux et probablement de très personnel. Très détaillée est celle qui figure dans une note (p. 53) de la plaquette anthologique conçue et publiée en juillet 1993 par Joël Cornuault11, alors libraire et éditeur bergeracois à l’enseigne de La Brèche. Il s’agit de
la forme languedocienne du limousin ‟Chap de l’aiga”. Francisé de longue date en Chadelaygue, c’est un lieu-dit de la commune de Saint-Jean-d’Eyraud ; comme le nom l’indique (‟tête de l’eau”), l’Eyraud y prend sa source. Ce merveilleux toponyme est aujourd’hui déshonoré par un panneau où se lit Chadeleige. À quand Chat de neige ? ou Chasseneige ?
Ce pourrait être une anecdote, mais non : cette source décidément maltraitée n’est pas seulement, ce qui serait déjà beaucoup, un lieu chargé d’une forte valeur symbolique et personnelle ; c’est aussi, là où, peu ou prou, se rejoignent deux parlers de la langue d’oc, le languedocien et le limousin, celui où les mots du poète ont puisé leur poids de sens et leur singularité. On rejoint ici les grands récits mythiques des origines de la poésie, par exemple celui de la source Hippocrène, sur les flancs du mont Hélicon et celui du cheval ailé Pégase, qui la fit jaillir d’un seul coup de sabot. Et c’est aussi le lieu où les deux langues du poète Lesfargues s’apparient, sous le regard de l’espagnol12, autre langue élue : outre le mystique et poète de la noche oscura, Juan de la Cruz, se profilent notamment dans le recueil de 1952 le Quichotte de Cervantès (« Çò que l’aiga jonjoneja », p. 20-29) ou la nuit et l’eau noires de Ségovie (« Recòrd de Segovia », p. 20-21).
Traduire a été la grande entreprise littéraire qui a accompagné sans relâche Lesfargues depuis les années 1950, avec un surcroît d’activité quand son départ à la retraite de l’enseignement lui a laissé davantage de temps disponible pour s’y consacrer13. Son écriture poétique s’est développée parallèlement à cette pratique de la traduction : pour lui traduire et écrire ne font qu’un14, en tout cas c’est ce qu’il a suggéré dans l’entretien de 2009. Cette assimilation n’est pas en soi très originale, mais le fait que chez lui traduire et écrire entre deux langues et de l’une à l’autre ait constitué une autre forme de la traduction représente une singularité qui semble avoir été essentielle aussi bien dans sa formation initiale que par la suite. Écrire le poème, ce fut pour Lesfargues passer régulièrement d’un idiome à l’autre, et se situer naturellement dans ce passage riche d’expériences et de découvertes.
Ce placement du poème dans le temps de l’échange entre les langues est sans doute à mettre en rapport avec le fait que l’écriture, chez Lesfargues, a très tôt été, et cela ne s’est jamais démenti, au contraire, une affaire de circonstance, dans le sens où pour lui toute circonstance, fût-elle à l’origine assez anodine, est un événement, une sorte de révélation qui est susceptible de mettre en mouvement la parole. Dans les dernières lignes de la postface de ses Odes, Lesfargues souligne combien le poème tel qu’il le conçoit est fait pour être dit à voix haute, et par là pour être entendu et reçu dans ce qui fait son harmonie. Pour que le poème tombe, littéralement, sur son lecteur et auditeur, il doit d’abord être tombé sur le poète, comme une manière de révélation. Une parole jaillie de l’instant, et le prolongeant, dans un élan qui va de la plainte au cri, de l’apostrophe au murmure, portée par l’élan premier de l’événement qui l’a suscité.
Yves Rouquette, dans la préface d’un bref mais décisif choix de poèmes de Lesfargues, affirmait en 1999 que
la foi qui monte de ce cœur dévasté est proprement colloquiale. Le ton est celui de la conversation à deux où chacun est l’égal de l’autre, humblement, fièrement, en quête de signes, en attente d’un au-delà improbable et pourtant déjà pressenti ou éprouvé dans quelques instants de pure joie ou de grande émotion, dès lors devenu nécessaire15.
Foi colloquiale, assurément. Et colloque du poème, oserai-je ajouter. Poème dont la parole surgit de l’événement inopinément survenu, et de cette émotion, dans tous les sens du terme, se prolonge, se raconte, parfois se démultiplie et se « traduit » dans la langue qui l’a fait naître et vivre. Bernard Manciet, qui fut au nombre des amitiés que Lesfargues cultiva pendant ses années d’étudiant à Paris, avait déjà cerné de belle manière, dans le bref mais percutant compte rendu de Cap de l’aiga qu’il donna dans la revue Oc en 1953, la force et la manière poétique de son contemporain :
Dens los capitets, au portau de nòstas glèisas romanas, lo poèta que canta au miei de las brancas e de las aigas enviroladas. Bernat Crestian canta lo que cerca, lo que l’atén i a pausa. Aqueth qu’es l’amic de l’amor camina dab eth lo ser, oelhèr de las estelas, camina capvath las vièlhas pèiras, los dragons, los senhors tapoats, camina com a Emaüs16.
Et Manciet ajoutait un peu plus loin : « La poesia, aqueth aquí, qu’es son estat de gràcia ».
L’acte poétique, comme celui de traduire littérairement, revient à transformer un texte en un autre texte, donc à faire apparaître ce qui n’était pas auparavant, au cours d’une opération qui offre davantage que des similitudes avec la Pentecôte chrétienne, quand les premiers disciples de Jésus, selon les Actes des Apôtres, reçurent l’Esprit saint, en l’espèce des langues de feu, et purent de la sorte s’exprimer dans d’autres idiomes que le leur propre. L’anthologie proposée par Yves Rouquette s’intitule justement Pentecôte, reprenant le titre d’un poème en français de Lesfargues qui ouvre le recueil, et que l’on retrouvera par la suite dans la dernière partie de La brasa e lo fuòc brandal17:
Contre une brève éternité, quelle démence
de souffler sur cette braise pour s’y brûler
Poème qui fait écho, en deçà du titre du grand livre de 2001, tout de braise et de feu, à celui qui venait refermer le premier livre de poèmes en occitan de Lesfargues, Cap de l’aiga : « Un angèl, òc-plan ». Yves Rouquette, tout naturellement, a placé ce poème prémonitoire immédiatement après « Pentecôte » :
Pasmens, un angèl me venguèt veire,
esbleugissent
e las pòtas me netegèt amb una brasa.
Dison que lo cal sonar Isàias,
d’autres dison la Poesia18
Et Lesfargues, de son côté, a voulu qu’une représentation de cette scène majeure illumine la première page de couverture de La brasa e lo fuòc brandal. Ce titre, d’ailleurs, est, non pas intraduisible, mais difficile à restituer en français depuis l’occitan. Mistral, un poète que Lesfargues a plus d’une fois cité en exergue de ses poèmes19, indique dans son dictionnaire provençal-français, le Trésor du Félibrige, à l’article « Brandant », que la forme brandal est toulousaine, et précise : « Fioc brandal ou tout court brandal, feu flambant, incendie, en Toulousain ». La citation qui suit cette glose est tirée des œuvres de l’écrivain audois Achille Mir (1882-1901), mais avec la forme brandant : « À l’entour d’un boun foc brandant jusqu’al cremal20 ». Pourtant, le poète ne me semble pas avoir hésité quand il s’est agi pour lui de formuler en français la version occitane originelle du titre de cet épais recueil21. La braise et les flammes, à ce que je peux en savoir dans mon souvenir22, n’a pas suscité de discussions. Probablement parce que l’expression les flammes, bien que n’ayant pas vraiment le même profil sonore que fuòc brandal, ni d’ailleurs la même structure syntaxique, renvoie, par l’image immédiatement suggérée, à la Pentecôte chrétienne et aux significations « en langues » de mots et de feu qui s’y attachent.