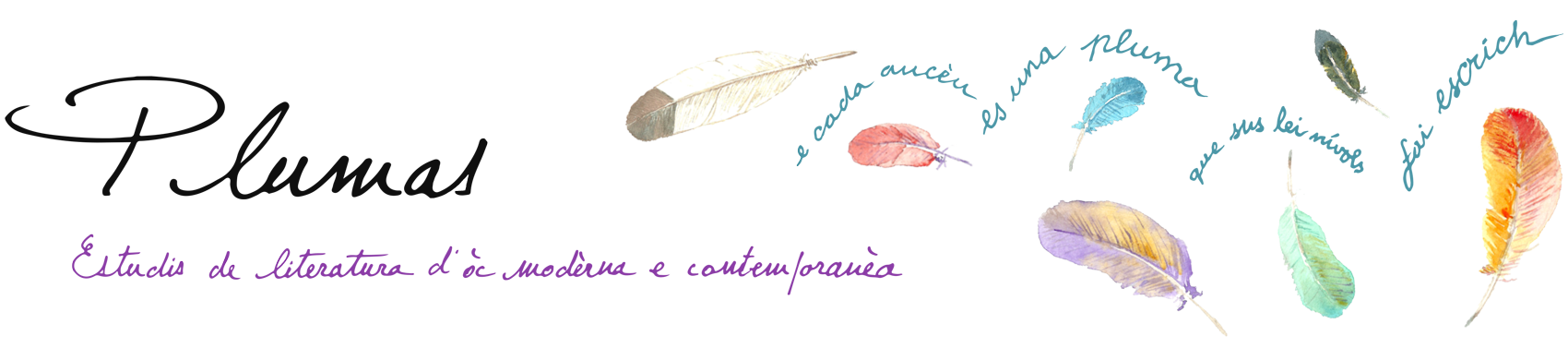L’écriture de Joan Ganhaire est en grande partie liée à son expérience professionnelle : à ses études de médecine tout d’abord, qui ont été pour lui l’occasion de découvertes douloureuses dont ses œuvres se font l’écho. À son métier de médecin de campagne ensuite, qui lui a permis d’accompagner des malades appartenant à tous les milieux sociaux. Il a ainsi été confronté à toutes sortes de situations, troubles psychiatriques, handicaps physiques et mentaux, viols, naissances non désirées, drogues, alcoolisme, malversations médicales... qui servent de base à ses textes.
Enfin, si Ganhaire a choisi d’apprendre l’occitan limousin et d’écrire dans cette langue, c’est pour partie parce qu’elle était celle que ses malades parlaient à la maison. L’intrication de son œuvre et de sa profession est donc importante. Que subsiste-t-il du médecin dans l’écrivain, et comment les textes traduisent-ils cette expérience professionnelle ?
Le dit et le non-dit
Les mots du médecin, les mots de l’écrivain
Joan Ganhaire écrivain n’est pas Jean Ganyaire médecin. À ses lecteurs, il dit autre chose que ce que le médecin dit à ses patients. Tout d’abord, en tant qu’écrivain, il est un passeur : il s’adresse à tous, il doit donc transmettre son savoir professionnel avec les mots du quotidien, ceux que tous peuvent comprendre. D’où aussi le choix de l’occitan, langue du quotidien, de la famille et de l’intimité dans le monde rural du Périgord dans les années 1970, à côté du français qui est la langue publique. L’écrivain a également des préoccupations esthétiques : dans quelle mesure, alors, peut-il concilier le langage littéraire et le langage scientifique ? Les textes de Ganhaire témoignent de trois manières de faire pour résoudre cette question. La première est de parler du point de vue de l’ignorant, et donc d’un point de vue que chacun peut adopter. Par exemple, dans le roman Lo darrier daus Lobaterras [Le dernier des Loubaterre], le héros, Arnaud de Loubaterre, est ainsi décrit par son ami et valet Joan :
E lo chuchetament s’era fach tonedre, lo bufe leugier s’era fach tempesta. Ton còrs s’era tendut coma la còrda d’una arcbalesta, ta tèsta aviá rodelat deçai delai, tos dets avián esgrafinhat lo sable, escicat las peus de ton liech, tos uelhs s’eran desvirats davant Dieu sap qualas visions e avián mostrat nonmàs lors glòbes blancs, fasent de ta chara escharnida la masca mortuària de quauque supliciat. Quela convulsion òrra aviá durat non sai quant de temps.1
[Et le chuchotement s’était fait tonnerre, le souffle léger s’était fait tempête. Ton corps s’était tendu comme la corde d’une arbalète, ta tête avait roulé de côté et d’autre, tes doigts avaient griffé le sable, déchiré les peaux de ton lit, tes yeux s’étaient détournés devant Dieu sait quelles visions et n’avaient laissé voir que leurs globes blancs, faisant de ton visage grimaçant le masque mortuaire de quelque supplicié. Cette horrible convulsion avait duré je ne sais combien de temps.]
L’action du roman se déroule au 12e siècle lors de la deuxième croisade. L’épilepsie est déjà connue depuis l’Antiquité, mais le narrateur, Joan, l’ignore, et ne peut pas mettre de nom sur la crise spectaculaire à laquelle il assiste2. Son effroi est d’autant plus grand qu’il est face à l’inconnu. L’auteur, qui fait adopter son point de vue au lecteur, joue sur cette ignorance qui renforce l’horreur de la métamorphose d’Arnaud en un être monstrueux. Il reprend le même procédé un peu plus loin, lorsqu’Arnaud tombe en catatonie :
Aviá tocat ton còrs totjorn immobile, totjorn dur coma peira. Las mans tremolantas, aviá essaiat de desplejar tos braç. Mas tos dos ponhs eran enfonsats dins tos uelhs emb una fòrça tala que aviá pogut nonmàs far eszilar ton còrs entier, tan maladrechament que ton chais era vengut tustar rudament lo sòl de la tenda.3
[J’avais touché ton corps toujours immobile, toujours dur comme pierre. Les mains tremblantes, j’avais essayé de déplier tes bras. Mais tes deux poings étaient enfoncés dans tes yeux avec une force telle que j’avais seulement pu faire glisser ton corps tout entier, si maladroitement que ton visage était venu frapper le sol de la tente.]
La sidération devant ces manifestations se renforce du fait qu’il n’est pas possible, pour le narrateur, de leur associer un nom. L’impossibilité de nommer, de ramener à une catégorie connue, favorise l’explication par le surnaturel qui est celle de Joan. Le lecteur moderne un peu averti devine qu’il existe certainement une explication médicale à ce que vit le héros. La description de ces deux crises par leurs symptômes bruts renforce ainsi la tonalité fantastique du roman.
Ganhaire n’hésite pas, en revanche, à utiliser un vocabulaire médical précis lorsqu’il peut en tirer un effet particulier. La nouvelle « Un afar de meschaent gost » [Une histoire de mauvais goût]4 par exemple, met en scène une baronne qui a voulu éblouir ses invités en mettant un rubis dans sa galette des rois. Mais aucun d’eux ne trouve la fève. Le médecin Chaminot leur conseille donc d’examiner chaque jour ce qu’il nomme, d’un terme médical vieilli, leurs « exonérations », pour retrouver le rubis perdu. La préciosité du mot contraste avec la trivialité du geste, et fait rire.
Il arrive aussi au médecin-écrivain de proposer le mot dans un objectif pédagogique, pour l’apprendre à son lecteur. Ainsi, lorsque dans le roman Vautres que m’avetz tuada [Vous qui m’avez tuée]5, le commissaire Darnaudguilhem interroge la femme du médecin Bastide sur son mari assassiné, elle lui explique que :
Son trabalh era d’espiar au microscòpe daus pitits bocins de vianda, de las gotas de sang, de las liquossianas surtidas d’un pauc pertot, per ‘mor d’i trobar lo perqué de vòstra racariá e daus uns còps lo quora de vòstra mòrt. Anatomopatologista, quò s’apelava. 6
[Son travail était de regarder au microscope des petits morceaux de viande, des gouttes de sang, des liqueurs sorties d’un peu partout, pour y trouver la cause de votre saloperie et parfois l’heure de votre mort. Anatomopathologiste, ça s’appelait.]
L’auteur ne s’interdit pas de transmettre un peu de son savoir au lecteur béotien lorsque la narration le nécessite ou le justifie. Par exemple, comment savoir si quelqu’un est mort en examinant sa pupille : dans Las islas jos lo sang [Les îles sous le sang], le médecin Boutinaud examine ainsi une Irlandaise, Mrs O’Grady :
Lo det guinhaire levat, Botinaud nos aprend que quand quauqu’un es mòrt son miralhon se druebe grand e que vesem quitament pus la color de l’uelh. Aquí, a l’encontrari, som en preséncia d’un subject enquera viu, nonmàs bravament estordit.7
[L’index levé, Boutinaud nous apprend que quand quelqu’un est mort sa pupille s’ouvre en grand et qu’on ne voit même plus la couleur de l’œil. Ici, au contraire, nous sommes en présence d’un sujet encore vivant, simplement bien assommé.]
Ou encore, dans Lo pestor e lo nenet [Le boulanger et le bébé]8, des explications données par un Boutinaud du XXe siècle :
Lo medecin disset que per los que zo saurián pas, sovent, las femnas sagnan justament perqué ‘las son pas gròssas. Aprep un moment de silenci, disset tanben que daus uns còps, i a de las femnas que son presas sens zo saber, que fan coma si ren s’era passat, que se deslampironan per que quò se veja pas, que son tant teunas a la fin coma au començament, e que s’acoijan coma que vai pissar, e ‘laidonc lo nenet es ren d’autre qu’un bocin de quauquaren que ne’n son bien desentraupadas.
[Le médecin dit que, pour ceux qui ne le sauraient pas, souvent, les femmes saignent justement parce qu’elles ne sont pas enceintes. Après un moment de silence, il dit aussi que quelquefois, il y a des femmes qui sont enceintes sans le savoir, qui font comme si rien ne s’était passé, qui se débrouillent pour que cela ne se voie pas, qui sont aussi fines à la fin qu’au début, et qui accouchent comme on irait pisser, et ainsi le bébé n’est rien qu’un morceau de quelque chose dont elles sont bien débarrassées.]
Ganhaire, ici encore, préfère éviter le pédantisme en ne nommant pas ce dont il parle, à savoir les règles et le déni de grossesse. La description des faits suffit à expliquer les deux phénomènes.
Que dire des expériences fondatrices ?
Pour acquérir le savoir médical, il y a un prix à payer : celui d’une double initiation, l’initiation à l’angoisse devant la mort, et l’initiation au cynisme. Le médecin est celui qui a survécu à ces épreuves. Que peut en dire l’écrivain ?
Pour devenir médecin, Ganhaire a fait des études universitaires à Bordeaux, dans les années 1960. Dans deux de ses nouvelles, « Chambra trenta-dos » [Chambre trente-deux]9 et « Lo viatge aquitan » [Le voyage aquitain]10, il transpose les expériences fondatrices et traumatisantes qui lui ont été imposées.
Chambra trenta dos (1977)
Le récit met en scène un professeur de la Faculté de Médecine qui tue indirectement deux des étudiants dont il a la charge en menant sur le groupe une expérimentation dans une matière intitulée « Pathologie de l’angoisse ». Il donne à lire le journal intime de l’un des étudiants, complété par un épilogue en trois paragraphes à la fin duquel le professeur, Bordasole, commence la lecture du journal intime que justement le lecteur vient de parcourir, l’invitant ainsi à une lecture en boucle.
Le fait est scandaleux en soi. En effet, il s’agit d’une expérimentation obligatoire pour l’obtention du diplôme. Tous les étudiants reçoivent une piqûre et on leur annonce que l’une d’elles est mortelle, ce qui est un mensonge : aucune des piqûres n’est mortelle et en principe, aucun étudiant ne doit mourir. Bordasole, le professeur de médecine, n’a aucun sens de l’éthique. Il est plongé dans ses recherches et ne se rend absolument pas compte de ce qu’il impose à ses étudiants sur le plan psychologique. Au lieu de les former, il les détruit - du moins les plus sensibles d’entre eux. Face à lui, les étudiants naïfs que sont le narrateur Jan Costilhas et son ami Casteths vivent au jour le jour dans l’angoisse de la mort qu’on leur a prédite. Impuissants, ils voient leurs amis sortir les uns après les autres, alors qu’eux-mêmes restent enfermés. Aucun des deux ne veut s’avouer son angoisse, ni la dire à l’autre, et ils finissent par s’entretuer.
Il s’agit bien ici d’une « transmission qui s’effectue sous la forme d’une domination malveillante, égoïste, calculatrice »11, qui méprise et détruit. Celui qui enseigne n’est ni bienveillant, ni de bonne foi. Il est dans une relation de pouvoir et pratique l’exact contraire de ce qu’il devrait enseigner. Cette nouvelle métaphorique met ainsi en lumière les événements fondateurs que sont, pour un étudiant en médecine, la découverte de l’angoisse existentielle, et celle de l’inhumanité de certains médecins qui prétendent travailler sur elle alors qu’ils la nient.
Lo viatge aquitan (1980)
Le narrateur de cette nouvelle est un clochard, Joan. Seul dans un cimetière, il parle à son ami Juli qu’il vient d’y enterrer en cachette. Il se remémore le terrible voyage qu’il vient de faire pour l’emmener du pays basque jusqu’à Bordeaux, en tirant son fauteuil roulant avec un vieux vélo. Juli meurt avant de pouvoir entrer à l’hôpital Saint-André. En l’absence de Joan, son corps est ramassé dans la rue par le personnel de la morgue : les employés l’apprêtent pour une future dissection par les étudiants. Avec des amis, Joan pénètre de nuit dans la morgue et le sort de la cuve où il est conservé avec les autres cadavres. Toujours à vélo, il le transporte clandestinement jusqu’au petit cimetière où reposent les autres membres de sa famille, et l’enterre en secret.
Ce texte fait également état d’événements fondateurs, qu’il présente sous forme de sensations : la première est une image choquante, sous forme de vision cauchemardesque, mais qui correspond à une réalité : celle des cuves de la morgue où nagent les corps qu’on conserve pour les dissections. À l’époque où Joan Ganhaire fait ses études, il n’y a en effet ni frigos, ni tiroirs, et les employés de la morgue ramassent effectivement les cadavres des vagabonds pour les faire servir aux travaux pratiques des étudiants. Il s’agit, pour l’auteur, d’un souvenir visuel inoubliable. La seconde sensation est olfactive : c’est l’odeur de la mort, avec laquelle les étudiants font obligatoirement connaissance, une odeur qui s’attache à toute la personne et dont on ne peut se défaire.
Pour Joan Ganhaire, le mépris de l’humain, le non-respect des personnes décédées, que l’on traite comme des objets, constituent un autre scandale. Là encore, les études de médecine exigent une forme de cynisme, le renoncement à la sensibilité. À cette attitude qui est pour lui inacceptable, le narrateur-clochard oppose la douleur d’avoir perdu son ami. L’enterrer parmi les siens, dans un lieu où règnent le silence et la paix, est pour lui un moyen d’affirmer, par delà la mort, que Juli reste un être humain auquel on doit le respect.
Botèrem un moment per comprener. La sala semblava nauta, e lo resson metallic de nòstres pas se perdiá dins de las vòutas que retrudissián ; ben pro sonanta a nòstra fantasiá. Lo rai de lampa seguiá los murs nuds sens trobar ren : pas d’estatgieras, de tiretas, d’armaris o qué sabe-io.
Tot d’un còp, lo Miguel disset : « Aquí. » La lampa nos mostret las passarelas de fèr, e dejós, daus rebats sornes d’aiga durmenta. Nos doblèrem, coma los que, los diumencs, escupissen dins l’aiga de las ribièras, o seguen de l’uelh lo boschalh de quauque peschaire. Mas nautres, nòstres uelhs eran pas pro beus, ni mai tròp duberts per l’orror que bonhava jos nòstres pès : un monde de nejats nos laissava entreveire sos uelhs meitat barrats, sas gòrjas escharnidas, sos membres palles, sos piaus que bolegavan lentament… La lampa dau Miguel anava e veniá, incredula : una autra passarela, una autra cuba, d’autres nejats… una autra passarela, una autra cuba, d’autres nejats… Lo liquide de mòrt semblava una gana onte paguna crespa d’aiga, paguna berla auriá ‘gut lo coratge de frotjar. La sola chaulhadura era, de plaça en plaça, una moscha mòrta qu’esperariá longtemps la gòrja redonda d’un peisson o lo còp d’ala clinat d’una irondela. Jamai aiga fuguet mai immobila, jamai miralh donet melhor rebat de nòstras charas.
Nos fauguet ben ‘rachar de quela contemplacion mausana. Tu, ont eras ? E io que pensava de te trobar bien tranquillament renjat emb una etiqueta au gròs artelh, coma ai ‘gut legit qu’aquò se fasiá. Seguèrem las passarelas, desfaciant los cadabres. Veire res mai : quo es tu o quo es pas tu.
Faguèrem lo torn sens te trobar. Maugrat que fuguessas daus darriers arribats, fasiàs pas partida de la surfàcia. Aviàs dejà cloncat dins lo fin fons d’una de quelas cisternas sufocantas.
Lo Miguel montret dau babinhon doas latas acotadas contra lo mur. N’i aviá una que se ‘chabava per un cròc. Prenguèrem chascun la nòstra e comencèrem.
Sabe pas bien si te rendes compte de çò qu’eras en tren de nos far far. Vei-nos-quí ‘trapats a pigonhar dins quelas fossas comunas en forma d’elevatge de truchas.
E los mòrts desrenjats se viraven de costat emb daus lents movements d’espatlas, mai doç enquera que los daus durmeire qu’òm secod e que se vòu pas esvelhar. Puei dispareissián per laissar la plaça a d’autres. D’autras charas, que demest elas cerchàvem la toá, coma a l’arribada d’un tren. E per nòstras interrogacions mudas, quauques regards voides, daus gestes que semblavan d’ignorància, los passants tornavan colar dins lo prigond de lur gorg.
Quo es dau fons de la tresena cuba que t’avem vut montar. Avián degut te voidar lo ventre, perque era vengut tot plat. Finalament, vòles que te dija ? Quo era pas tu lo mai òrre.12
Nous avons mis un moment pour comprendre. La salle semblait haute et l’écho métallique de nos pas se perdait dans des voûtes retentissantes ; bien trop bruyantes à notre goût. Le rayon de la lampe suivait les murs nus sans rien trouver : pas d’étagères, de tiroirs, d’armoires ou quoi que ce soit.
Tout à coup Miguel a dit : « Là. » La lampe nous a montré les passerelles de fer et, dessous, de sombres reflets d’eau dormante. Nous nous sommes penchés, comme ceux qui, les dimanches, crachent dans l’eau des rivières ou suivent de l’œil le bouchon de quelque pêcheur. Mais nous, nos yeux n’étaient pas assez grands ni trop ouverts pour l’horreur qui couvait sous nos pieds : un monde de noyés nous laissait entrevoir ses yeux mi-clos, ses faces grimaçantes, ses membres livides, ses cheveux qui remuaient lentement… La lampe de Miguel allait et venait, incrédule : une autre passerelle, une autre cuve, d’autres noyés… une autre passerelle, une autre cuve, d’autres noyés… Le liquide de mort semblait une mare où aucun nénuphar, aucun cresson n’aurait eu le courage de germer. La seule salissure était, de place en place, une mouche morte qui attendrait longtemps la gueule ronde d’un poisson ou le coup d’aile penché d’une hirondelle. Jamais eau ne fut plus immobile, jamais miroir ne donna meilleur reflet de nos visages.
C’est au fond de la troisième cuve que nous t’avons vu monter. On avait dû te vider le ventre, parce qu’il était devenu tout plat. Finalement, tu veux que je te dise ? Ce n’était pas toi le plus moche.13
Le savoir de l’initié : un savoir indicible
S’il peut dire une partie de ce qu’il sait sous forme métaphorique, le médecin ne peut pas cependant faire partager la totalité de son expérience. Certains secrets ne peuvent être révélés hors de leur contexte, sous peine de paraître obscènes et de susciter l’incompréhension. L’écrivain peut donc les suggérer, mais doit les taire. Dans le premier roman policier de Ganhaire, Sorne Trasluc [Sombre clair de lune]14, apparaît le personnage de Madelbosc, médecin légiste, qui matérialise ce principe. Son travail est indispensable et complète celui des policiers. Ganhaire le peint sous un jour à la fois terrible et grotesque. Dans son registre qui est celui de l’humour grinçant15, Madelbosc est un double du commissaire Alexandre Darnaudguilhem, sa face inavouable. Les deux hommes se connaissent depuis le lycée, ils sont allés ensemble à la faculté. Tous les deux ont été abandonnés par leurs femmes. Celle de Madelbosc lui reproche de lui préférer des cadavres plus ou moins frais, le traite d’incendiaire nécrophile et a emmené ses enfants au loin pour les sauver de leur père. Il est surnommé Sent-la-Mòrt, peut-être à cause de son reniflement perpétuel, peut-être aussi parce qu’il porte sur lui l’odeur indélébile de la mort qui imprègne toute sa personne, alors que Darnaudguilhem est surnommé le Bâtard, à la fois parce que c’est un enfant de l’Assistance et parce que son « flair » est exceptionnel. Les deux amis se retrouvent les soirs de cafard, mangent rapidement et surtout boivent jusqu’à tard dans la nuit, quelquefois devant un film, échangeant des propos misogynes et partageant leur vision désabusée de l’humanité.
Madelbosc trouve lui-même un double dans son acolyte, le thanatopracteur surnommé Frankenstein16. Celui-ci est obsédé sexuel et certainement le véritable nécrophile, quoique l’auteur se plaise à laisser planer le doute17… Son patron le légiste, qui fume des cigarettes maïs, est toujours environné d’étincelles qui trouent ses vêtements et manquent de mettre le feu à ses papiers ou à sa chemise… ce qui donne lieu à des scènes très comiques de débuts d’incendie18. Inflammable, Madelbosc devient une figure du Diable, de celui qui est passé de l’autre côté : il sait ce qu’on ne devrait pas savoir. Son laboratoire est dénommé « L’enfer »19 et on y entre par une double porte noire. Les pratiques qui y ont cours ne peuvent être révélées car elles sont choquantes pour le profane. Dans le roman Las tòrnas de Giraudon [Les fantômes de Giraudoux], Madelbosc prend un plaisir sadique à faire vomir le procureur Bregegère de Lavergnade en lui révélant les secrets d’une autopsie. Le commissaire Darnaudguilhem, curieux de savoir ce qui a été dit, vomit à son tour lorsqu’il l’apprend. Derrière d’indéniables effets comiques, Ganhaire suggère ainsi que certains savoirs doivent être tus. Celui qui les détient est un être de feu, de nature diabolique, qui manque à chaque instant de s’autodétruire. L’initiation se fait au risque de la vie, et elle n’est jamais totalement achevée : en effet, chez Ganhaire, on découvre toujours pire que ce qu’on croit savoir.
Quels médecins pour quelle médecine ?
Un savoir médical qui s’interroge sur lui-même
La médecine est un savoir en devenir, dont tout un chacun peut constater les avancées au fil de l’histoire. Dans ses récits, Ganhaire fait état de cette dimension historique, et propose au lecteur, sur le registre de l’humour, quelques éléments d’approche épistémologique.
Il réaffirme, tout d’abord, que la médecine ne sait pas tout : des personnages comme le jeune Guilhem, dans la nouvelle « Lo sendareu daus ginebres » [Le sentier aux genièvres], sont d’avance condamnés. Le médecin-narrateur et son collègue cardiologue en sont réduits à prononcer des mots de réconfort auxquels ils ne croient pas eux-mêmes. Pour ne pas céder au désespoir, mieux vaut essayer de distancier ces drames en proposant d’en sourire. Dans Vautres que m’avetz tuada, le jeune Cristòu est atteint du syndrome de « Lowenthal-Biolac-Perelman », lié à des anomalies chromosomiques, qui fait de lui un être monstrueux : syndrome tout droit sorti de l’imagination de l’auteur, qu’il nomme un peu plus loin syndrome de « Chause, Chause e Chause ». Lulu, héroïne de Un tant doç fogier, est quant à elle atteinte du syndrome de « Hamburger-Friedrich-Perelman » :
un semen de salopariá que te fasiá una pita testa de mainatge sus un còrs de nabacuol, un còr plen de cròs ente faliá pas, e de las òssas prestas a s’espetar a la mendra chucada. E per far complet, una surdimutetat que la dostava de la comunicacion sonòra.20
[une sorte de saloperie qui te faisait une petite tête d’enfant sur un corps de nabot, un cœur plein de trous là où il n’en aurait pas fallu, et des os prêts à se briser au moindre choc. Et pour couronner le tout, une surdimutité qui lui interdisait toute communication sonore.]
L’humour dans le choix du nom de ces maladies, l’humour dans leur description et l’inventivité verbale sont autant de moyens de faire accepter l’inacceptable. Le rire libère l’homme de la cruauté de sa destinée. Les nombreuses allusions à Molière vont aussi dans ce sens. L’une des nouvelles parues dans la revue Paraulas de Novelum21 s’intitule « Lo diable siá daus medecins » [Le diable soit des médecins], reprise de la fameuse réplique de l’Avare, « La peste soit de l’avarice et des avaricieux ». Le roman Dau vent dins las plumas met en scène le médecin Botinaud, dans la plus pure tradition moliéresque : c’est un adepte inconditionnel du lavement, et son latin de cuisine s’inspire directement de celui du ballet final des médecins du Malade Imaginaire22. Le titre du chapitre XVII, où il apparaît, est d’ailleurs explicite : « Onte Barnabeu, que a pogut, jusca aura, eschapar a tant de dangiers, cuja tombar entre las mans d’un cirurgian. » [Où Barnabé, qui a pu jusqu’à maintenant échapper à tant de dangers, manque de tomber entre les mains d’un chirurgien.] L’auteur ne recule pas devant des anachronismes féconds : dans Un tant doç fogier, la photo d’un buste d’Hippocrate va permettre de faire le portrait-robot d’un inconnu qui s’est glissé la nuit au foyer pour handicapés L’Espelida [L’éclosion]. Le médecin anglais Harvey (1578-1657) est l’un des personnages importants du roman Las Islas jos lo sang, en tant que découvreur de la circulation sanguine. Ganhaire le représente faisant deux transfusions avec du sang humain, petite entorse à la vérité historique, puisque la première transfusion a été effectuée, dix ans après la mort de Harvey, par le Français Jean-Baptiste Denis - qui a utilisé du sang de mouton. Dans la logique romanesque, ce détail a peu d’importance : ce qui compte est de faire vivre au lecteur le caractère inouï de cette première expérience, et les tâtonnements du savoir médical. Profitant des leçons de Harvey, Boutinaud, à la fin du récit, ouvre à Bordeaux une boutique dans laquelle il réutilise les connaissances ainsi acquises. Faite de transmission, la médecine doit profiter au plus grand nombre.
Face aux limites du savoir occidental, Ganhaire propose de prendre en compte d’autres types de pratiques. Diagana Traoré, l’inspecteur de police malien qui vient renforcer l’équipe du commissaire Darnaudguilhem, est également un Karamogo, un « maître Chasseur », un initié qui a des pouvoirs : à la fois sorcier, marabout, guérisseur et rebouteux, il sait entrer en communication avec les esprits23, et se montrera capable de guérir Sonyo, une jeune malienne anorexique chez qui tous les traitements ont échoué.
Une proposition d’analyse sociologique
Par ses fonctions, Ganhaire est entré dans tous les milieux médicaux. Son œuvre, qui s’inspire souvent de cas réels, décrit l’envers du décor et donne à voir la diversité de ce monde médical, dans une riche galerie de portraits rapidement brossés.
Les médecins de campagne
La figure du médecin de campagne est l’une des figures récurrentes de l’œuvre. Dans les nouvelles de la revue Paraulas de Novelum, qui content les aventures des habitants de Chantagreu, petit village imaginaire de Dordogne, il est surnommé Chaminot, d’un surnom qui provient de son activité. En effet, avant que n’existe la sécurité sociale, les gens faisaient rarement appel au médecin car ils n’en avaient pas les moyens. Le médecin allait donc voir le plus souvent possible les mêmes malades, ceux qui pouvaient le payer. Il créait ainsi, avec sa voiture, de nouveaux chemins (chamins, en occitan limousin). C’est de cette façon, en faisant durer ses soins à la baronne de Montalassus pour une maladie bénigne, que Chaminot a pu payer les études de son fils. Il bénéficie de leur indulgence car il donne de bons conseils, et participe comme eux à la vie de la commune, au carnaval par exemple, où il se déguise en Diable24. Dévoué à ses malades, le médecin de campagne reste un homme comme les autres, ni pire ni meilleur.
Les professeurs de médecine
D’autres médecins sont au contraire invisibles, à l’abri dans la Faculté de médecine, et n’ont pas de contact avec la population : c’est par exemple le professeur Bordasole, sadique et inhumain, dont Ganhaire fera un personnage de commis de la morgue dans une nouvelle ultérieure, où se mêlent humour noir et évocations crues25. Plusieurs professeurs, exigeants et sans scrupules, se succèdent auprès de lui, chacun demandant son cadavre pour faire ses recherches, sans tenir aucun compte des familles. Le Président du Conseil de l’Ordre qui apparaît à la fin de Vautres que m’avetz tuada leur ressemble : c’est un notable hautain, méprisant et misogyne.
Le monde médical urbain
Les romans policiers, notamment Vautres que m’avetz tuada, dont l’action se déroule dans le milieu médical, mettent en scène de nombreux chirurgiens et spécialistes : Enric Cabanel, homme à femmes, bel homme, mais surtout homme sans scrupules, prêt à tout pour de l’argent, assassiné dans sa clinique des Jarrics Verds [Les Chênes Verts]26 ; Édouard Bastide, l’anatomopathologiste ; Hélène Chapeyroux, généraliste qui a arrêté de pratiquer son métier pour se consacrer à ses enfants ; Peyradiou qui ne fait pas « dans le mou », mais qui est chirurgien orthopédiste, lui-même gravement blessé à la suite d’un accident, et si défiguré qu’on a dû lui greffer sur le visage la peau de ses fesses ; Santini, le chef du service de réanimation de l’hôpital, que l’on croise toujours au pas de course, et que les deux grandes ailes de sa blouse grande ouverte font ressembler à un papillon ; Lacot-Labarthe, à la clinique de Las Ersas d’Aur [des Vagues d’Or], qui fait venir les meilleurs praticiens pour sa clientèle de millionnaires internationaux ; Arsène de Saint-Exupéry, chirurgien bordelais blasé et inconscient des réalités, qui part en bateau avec trois amis : ils devront se manger entre eux pour survivre à des avaries ; le pédiatre San Juan, riche retraité, à Arcachon ; le psychiatre et psychanalyste Hofnagel qui a soigné le commissaire Gaétan Caüsac des Ombradours et qui s’occupe personnellement d’un jeune handicapé, Gaspard27 ; ou encore le psychiatre fou de la nouvelle « Garison »28. Ces personnages ne font pas l’objet d’une analyse psychologique approfondie.
Ces spécialistes fonctionnent en relation avec les médecins généralistes de la ville, comme Bardou, Fontgaufier, Chapeyroux, qui habitent tous dans le même quartier, dans une forme d’entre-soi un peu ridicule. Leurs intérieurs sont identiques, au point qu’ils donnent au commissaire Darnaudguilhem l’impression qu’ils se fournissent tous chez le même antiquaire.
Ces personnages ne font pas l’objet d’une analyse psychologique approfondie, mais sont plutôt présentés sous un angle satirique. L’auteur les utilise comme types possibles de ce que peuvent être des médecins, dans leurs façons d’être et dans leurs relations professionnelles.
Le monde paramédical
L’infirmière libérale est le pendant féminin du médecin de campagne ; souvent gaie et serviable, elle « connaît toutes les fesses du pays ». Elle court la campagne et porte les nouvelles ; elle apporte une aide précieuse et, éventuellement, contribue à l’enquête policière, comme l’infirmière Françoise dans le roman Chamin de Copagòrja29 où Darnaudguilhem est immobilisé à la suite d’une opération de son genou. Alors que le kinésithérapeute qui vient le soigner reste totalement extérieur à l’action, Françoise joue au contraire un rôle actif dans la transmission des informations. De même, les infirmières-chefs comme Madame Rebeyrol30 ou Madame Essartier31 détiennent des informations importantes qui permettent à l’enquête d’avancer. Le monde médical reste donc, chez Ganhaire, un monde essentiellement masculin, où les femmes jouent un rôle mais n’occupent pas les postes de décision. Quant aux autres personnels soignants, ils sont traités comme des figurants, et font en quelque sorte partie du décor. On constate que l’œuvre, de manière un peu étonnante, ne met en scène aucun personnage de pharmacien.
Les institutions
Les policiers que Ganhaire met en scène ont des relations privilégiées avec les établissements de santé, notamment parce que leur profession comporte des risques physiques. Darnaudguilhem se rend très fréquemment à l’hôpital de Maraval pour y rendre visite à des membres de son équipe qui ont été blessés, ou à des victimes qui sont entre la vie et la mort. C’est un lieu relativement ouvert, dans lequel, lorsque les policiers y viennent en groupe, ils reconstituent dans la salle d’attente une sorte de petit commissariat délocalisé.
Dans les récits de Ganhaire, l’hôpital public est relativement à l’abri des malversations. Il n’en va pas de même pour les cliniques comme Los Jarrics Verds ou Las Ersas d’Aur, dirigées par des chirurgiens malhonnêtes, ni pour les maisons de santé et maisons de repos où sont amenés à enquêter le commissaire Darnaudguilhem et le commissaire Gaétan Caüsac des Ombradours. L’Espelida porte bien mal son nom : les handicapés qu’elle accueille sont victimes du laisser-aller de l’institution et des abus pratiqués impunément par certains personnels, qui en sont la conséquence. Les pensionnaires du château de la Valouse, qui se croient dans une maison de repos sérieuse, sont en fait tombés aux mains d’un gourou, le docteur Delcombel, qui se dit naturopathe et nutritionniste. Son objectif est de faire mourir ses patients pour s’approprier leurs biens. Ce récit prend sa source dans un fait divers bien réel32.
Le jugement éthique
Dans les façons d’agir de cette foule de personnages, il y a ce qui est conforme à l’éthique médicale et ce qui est inacceptable. Ganhaire écrit, aussi, pour dénoncer des réalités dérangeantes, et pour réaffirmer quelques principes moraux : en aucun cas, la médecine ne peut être une expérience égoïste, au mépris de l’humain ; en aucun cas non plus, elle ne peut avoir pour objectif d’amasser l’argent pour l’argent. Elle a, au contraire, la mission de venir en aide, autant qu’elle le peut, et doit obligatoirement s’exercer dans le respect de toute personne. De ce point de vue, la médecine malienne est un modèle : pour conserver ses pouvoirs, le sorcier ne doit pas se faire payer, sa moralité doit être exemplaire, il doit respecter les Anciens et retourner régulièrement en brousse pour régénérer son savoir33, façon humoristique de rappeler le rôle essentiel de la formation continue pour les praticiens.
Une interrogation philosophique : qu’est-ce que l’humain ?
L’humain, un corps
Le corps est la donnée première pour le médecin, car il justifie son existence. Cette importance du corps se retrouve dans l’écriture même de Ganhaire, fondée sur les sensations physiques plus que sur l’analyse des sentiments34. Elle a naturellement sa place dans les romans policiers, qui commencent obligatoirement par la découverte du corps d’une victime. Elle souligne la parenté des démarches du détective et du médecin : tous deux partent des faits pour en donner une interprétation.
Une écriture des sensations
Les textes de Ganhaire mobilisent une gamme impressionnante de sensations auditives. Il est extrêmement attentif aux bruits qui peuplent son univers. Ses personnages s’annoncent en général par les sons qu’ils émettent, et on les entend avant de les voir. Certains, comme Gaétan Caüsac des Ombradours, vivent dans un monde de musique qui les aide à supporter le monde extérieur. Les sensations olfactives tiennent également une grande place : la nouvelle « Tornar tornar »35 repose sur l’idée qu’il est possible de recréer les parfums aimés de l’enfance. À l’opposé, la puanteur de la cale du bateau négrier de Las islas jos lo sang, ou l’odeur tenace de la mort, suscitent une forme d’horreur. Le menu détaillé des repas que fait Darnaudguilhem au restaurant, ou l’évocation du merveilleux civet de lièvre de la Joana, dans « Lo darrier cebier »36, mettent l’eau à la bouche. Le lecteur est invité à explorer toutes sortes de sensations tactiles, parfois inattendues, comme le contact désagréable de la chauve-souris que Gaétan Caüsac des Ombradours reçoit en pleine figure ; ou à partager des sensations somesthésiques, comme les douleurs de la Joana, celles qui lui sont quotidiennes comme celles, plus effrayantes, de son agonie. Quant aux sensations visuelles, elles peuvent autant provenir d’une observation minutieuse que du dérèglement de l’esprit emporté par l’imagination : ce que l’on croit voir n’est pas toujours la réalité.
Une mise en scène du corps meurtri
L’univers littéraire de Ganhaire est peuplé de toutes sortes d’infirmes : borgnes, aveugles, bossus, manchots, muets… Même les chiens peuvent y être boiteux, comme celui de Madame Desmoulins dans le roman Sevdije. Le commissaire Gaétan Caüsac des Ombradours a eu la chance de survivre à une grave maladie, mais est resté profondément handicapé. De nombreux personnages souffrent de handicaps mentaux plus ou moins graves, ou/et de malformations physiques. D’autres sont victimes d’accidents : le fiancé de la policière Guita Berengier est devenu tétraplégique à la suite d’une chute en montagne. Les vieillards squelettiques et pitoyables, comme le colonel Fredafont, sont de véritables morts-vivants. D’autres, comme Monsieur le Comte dans la nouvelle « Lo Chasteu »37, ou Pauline Maziéras dans « Quo es entau la vita »38, sont si fragiles qu’ils meurent de froid. Le médecin n’est pas épargné : devant la maladie, il est l’égal de ses malades : Chaminot attrape la fièvre lui aussi, à force de soigner des patients grippés… Pour le médecin comme pour l’écrivain, les hommes sont donc avant tout des corps fragiles, sans cesse menacés par la maladie et la mort. C’est cette fragilité qui fait la vie si précieuse.
Des corps qui sécrètent
Lorsqu’il parle du corps, l’écrivain le décrit dans tous ses aspects, et donc aussi dans ce qu’il produit : le sang des blessures, celui des règles, celui dont on est aspergé - comme Barnabé39 l’est par le sang du mousquetaire Athos -, et celui qu’on vomit ; les déjections comme celles du clochard Juli, qui fait sous lui ; l’urine joyeuse de la Zélia40 lorsqu’elle pisse le matin ; le lait de la mère de Joan, nourrice de son état41 ; les larmes, la morve, la salive, le sperme. Mais aussi tout ce que peuvent vomir les héros lorsqu’ils se trouvent face à des réalités insupportables. L’auteur en tire aussi bien des effets comiques, lorsque par exemple le clochard Rodilha42 explique qu’il s’est essuyé les fesses avec les pièces à conviction, que des effets tragiques, lorsqu’il suggère que les esclaves noirs, dans la cale du bateau négrier, vivent dans leurs déjections.
Des corps en morceaux
Le corps humain, chez Ganhaire, est fait de morceaux, et souvent présenté comme un corps éclaté. Lorsqu’il va passer la soirée avec le commissaire Darnaudguilhem, le légiste Madelbosc plaisante systématiquement sur les « morceaux de viande » qu’il va apporter. Son travail est de les observer et de les décrire dans ses rapports : « sus fons de vonvonament, espetava de temps en temps quauqua orror : meussa esbolhada…fetge espotit… mesenteri desinserat… paumons traucats… te passe jos silenci las òssas, que n’a pus paguna d’entiera. » [sur fond de bourdonnement, il lâchait de temps en temps quelque horreur : rate détruite… foie écrasé…mésentère désinséré…poumons troués… je te passe les os sous silence, il n’y en a plus un d’entier.]43
Les morceaux de viande, ce sont aussi les organes qui font l’objet d’un trafic dans le roman Sevdije :
Daus malaudes dau monde entier avián mestier de se far empeutar còr, fetge, ronhons, e fasián passar lor dorsier medicau, emb subretot lor grope HLA – a ! quò-quí, coneissem ! – e d’un autre costat, daus correspondents fasián saber los gropes de donaires, e chasque còp que i ‘viá una compatibilitat coma un recebeire, queu-quí era convocat, ente que siá, e l’organe compatible ‘ribava.[…]- E d’ente venián, quilhs empeuts ?- D’un pauc pertot, America dau Miegjorn, Índias, China daus uns còps… E dempuei quauques temps, una filiera d’Euròpa centrala s’era botada en plaça. Irribaren ne’n era fier de quela organizacion, e s’era pas tròp demandat coma tant de bocins se podián trobar. Masdelbòsc aviá pertant dich que quo era pas tant aisat que quò, que los faliá manlevar sus daus cadabres jòunes, santós, lo mai sovent mòrts de mòrt violenta, accidents, suicidis, mas ente demorava un bric de vita vegetativa per que s’entretenhe la vita daus organes ‘vances que la mòrt cerebrala siá oficialament declarada e que lo prelevament d’organes siá autorizat. A las Ersas d’Aur, semblavan pas aver queu genre de problemas, que un flus d’organes i ‘ribavan, sens que se pausessen la question, Irribaren per lo mens, de saber d’ente venián.44
[Des malades du monde entier avaient besoin de se faire greffer cœur, foie, rognons, et faisaient passer leur dossier médical, avec leur groupe HLA surtout – ah ! ça, on connaît ! – et d’un autre côté, des correspondants indiquaient les groupes de donneurs, et à chaque fois qu’il y avait une compatibilité avec un receveur, celui-ci était convoqué, où qu’il soit, et l’organe compatible arrivait. […] - Et d’où venaient-ils, ces greffons ? - D’un peu partout, Amérique du Sud, Inde, Chine parfois…Et depuis quelque temps, une filière d’Europe centrale s’était mise en place. Irribaren en était fier, de cette organisation, et ne s’était pas trop demandé comment on pouvait trouver autant de morceaux. Madelbosc avait pourtant dit que ce n’était pas si facile, qu’il fallait les prélever sur des cadavres jeunes, sains, le plus souvent morts de mort violente, accidents, suicides, mais où restait un peu de vie végétative pour que s’entretienne la vie des organes avant que la mort cérébrale soit officiellement déclarée et que le prélèvement d’organes soit autorisé. Aux Vagues d’Or, on ne semblait pas avoir ce genre de problèmes, car un flux d’organes y arrivait, sans qu’on se pose la question, du moins Irribaren, de savoir d’où ils venaient.]
Les marins du Saint-Christopher portent au cou, en guise de collier, les oreilles de leurs ennemis. Le pont de Londres expose les têtes coupées des opposants à Cromwell. Le chirurgien Saint-Exupéry coupe les bras de ses amis pour que tous aient à manger. Le médecin Boutinaud serre amoureusement sur sa poitrine le pot où il conserve un cœur qui est devenu son objet d’études. On comprend que dans un tel contexte, il soit particulièrement joyeux de pouvoir célébrer la naissance d’une jolie fille avec tous ses bras et toutes ses jambes, dont les parents sont l’inspecteur Le Goff et la gendarme Esmeralda Fiorino45.
Les maladies de l’esprit
Toutes sortes de troubles mentaux nécessitant ou non une hospitalisation, dont la description va du comique au tragique, alliant parfois les deux. Dans l’œuvre de Ganhaire, on trouve de nombreux personnages atteints de troubles psychiques et qui ne sont ni soignés ni hospitalisés.
Ainsi le baron de Montalassus est-il atteint de dégénérescence sénile, sa folie est comique. Il n’est pas rare de se trouver devant des dédoublements de personnalité, comme en témoigne Ange Le Goff, mi-breton, mi-corse, présenté sur un mode humoristique, mais qui a failli se suicider… On peut aussi évoquer les fabulations de Luc qui, dans le roman Un tan doç fogier, accuse son père adoptif d’inceste, qui s’invente une mère danseuse étoile et un père astronaute
On assiste à des hallucinations dues à l’alcool (Cronicas de Vent l’i Bufa) ou à la drogue (Sorne Trasluc) qui nécessitent des hospitalisations. Il y a des personnages qui voient des serpents et des chauves-souris. Sœur Bérengièra, que sa famille a obligée à se faire religieuse, manifeste des débordements sexuels. On assiste aussi à des délires meurtriers de personnages qui entraînent les autres : André Levasseur, Sir John, Fredafont… On peut bien sûr évoquer la folie de Joan de l’Arribièra qui a assisté – ou qui croit avoir assisté – à la fusion de son ami Arnaud avec un Loup. Les liens mystérieux du corps et de l’esprit sont présentés à travers Pauline Mazières, atteinte de mutisme à la suite des nombreux deuils qui lui ont enlevé ses proches (fiancé, père, mère, ses deux fils), ce qui fait dire à Philippe Gardy :
Ganhaire, coma mai d’un de sei narrators, es metge. Aquò ‘s benlèu pas per rèn. Sens anar necessàriament espiar dau costat de Céline (encara que…), sufís de mençonar lei noms dau Lionés Jean Reverzy ò, per la literatura occitana, de Max Roqueta (lei racòntes "Cendre mòrta" ò "Una figuièra per Caçòla", e mai, bèn segur, lo roman La Cèrca de Pendariès, que n’avèm tanbèn una version francesa de l’autor ais edicions dau "Trabucaire"), per devinhar çò que pòt afrairar d’escrituras qu’auriáu la teemptacion de lei qualificar de "medicalas", dins un sens literari. Dins lo sens d’una certa tendéncia coumna a un imaginari de l’uman revelat e mes en vista a flor e a mesura que se cava, assecutat qu’es per la malautiá, lo desir que se revira en foliá, e totei aquelei sentiments d’escrancament que lei personatges de Ganhaire ne son lei victimas mai o mens consentas46.
[Ganhaire, comme beaucoup de ses narrateurs, est médecin. Ce n’est peut-être pas pour rien. Sans aller nécessairement regarder du côté de Céline (encore que…), il suffit de mentionner les noms du lyonnais jean Reverzy ou, pour la littérature occitane, de Max Rouquette (les récits « Cendre morte » ou « Un figuier pour Caçole », et aussi, bien sûr, le roman La quête de Pendariès, dont nous avons aussi une version française de l’auteur aux éditions du Trabucaire, pour deviner ce qui peut apparenter des écritures que j’aurais la temptation de qualifier de médicales, dans un sens littéraire. Dans le sens d’une certaine tendance commune à un imaginaire de l’humain révélé et exposé au fur et à mesure que se creusent, persécuté qu’il est par la maladie, le désir qui vire à la folie, et tous ces sentiments d’accablement dont les personnages de Ganhaire sont les victimes plus ou moins consentantes].
Conclusion : vers une sagesse
La pratique de la médecine est une lutte perpétuelle contre la dégradation physique et psychique, et contre la mort. Elle amène à se questionner sur le sens de la vie, dans un monde où se déchaîne la folie des hommes. La prise de conscience de la souffrance humaine amène à une interrogation métaphysique. La croyance en Dieu est l’une des réponses possibles, celle que donne Mère Joana, ancienne psychiatre devenue religieuse, qui peut tout entendre, et s’interdit de juger. Mais il n’existe pas de réponse universelle : à chacun de choisir la sienne, pourvu qu’elle soit éthique. Homme parmi les hommes, le médecin fait ce qu’il peut. Sa qualité première est la compassion, qui se traduit par le partage de la souffrance de ses semblables. L’écrivain, lui, peut la dire et les aider à la distancier.