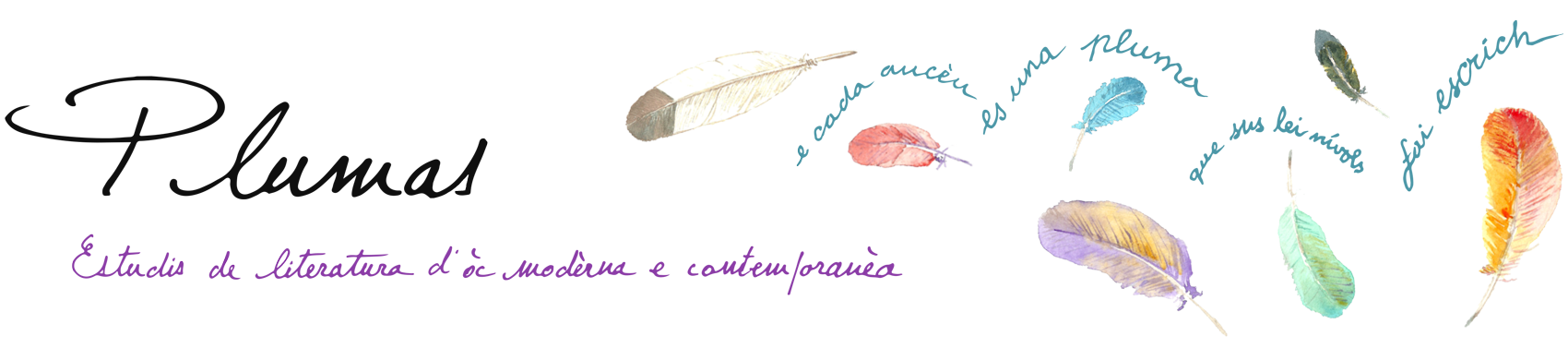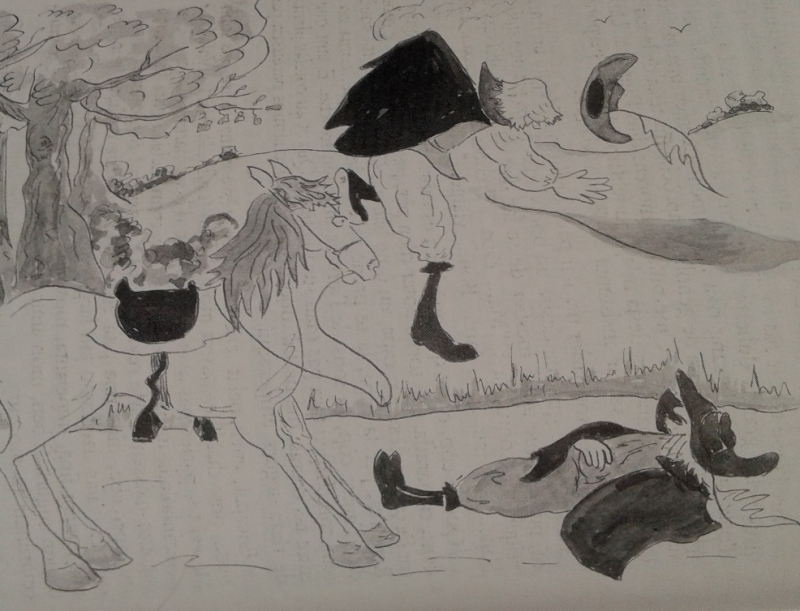Un double regard sur le monde
Le regard comique
Ganhaire commence par écrire de petites nouvelles humoristiques pour un bulletin intercommunal, Ventador1. Ses objectifs sont alors à la fois militants, et personnels. Il souhaite se mettre au service d’une langue qu’il sait menacée : il veut montrer qu’il ne s’agit pas seulement d’un « patois », mais d’une vraie langue, qu’on peut aussi la lire et l’écrire. Mais il a aussi plaisir à écrire, à faire rire. Il n’écrit pas pour un lecteur solitaire, mais pour une communauté de rieurs (comme Rabelais dans Gargantua).
Ces nouvelles s’inspirent de la tradition limousine populaire de la nhòrla, une histoire drôle qu’on raconte à la veillée ou à la fin d’un repas de mariage, par exemple, mais qu’on trouve depuis longtemps dans des almanachs ou de petites publications en occitan. Le conteur de nhòrlas reprend souvent des trames connues pour les actualiser à sa façon : ce qui compte est la façon de conter. Ganhaire s’inscrit de façon explicite dans la lignée des conteurs de nhòrlas célèbres2. Le rire de la nhòrla est d’abord un rire de fête, un rire sans tabous, comme celui de Rabelais : un rire que le critique russe Bakhtine nomme « carnavalesque ». Ce rire donne une grande place au scatologique et à l’obscène, à ce que Bakhtine appelle le « bas corporel » et qui se situe du côté de l’élan vital. Comme dans le Carnaval, il renverse les positions sociales, en soulignant que tout pouvoir n’est que provisoire.
Ganhaire reprend les procédés farcesques de la nhòrla :
-le ratage (le curé qui organise une procession pour demander de la pluie : en effet, un orage s’abat sur le village, mais il détruit toutes les récoltes3),
-la méprise (les deux amis qui croient manger des nouilles et mangent des vers de pêche4),
-le « bon tour » (le maire récemment élu qui possède une cave de grands vins : son rival malheureux se débrouille pour les faire boire par les électeurs5),
-la bagarre et en général la violence « pour rire » (les deux candidats aux élections qui en viennent aux mains)6.
Une procession contre-productive : le village de Chantagreu, qui souffrait de la sécheresse, est dévasté par l’orage.
Illustration de Francesa Calhet
Dans la nhòrla, la chute, le mot de la fin, a une grande importance : Ganhaire imagine d’abord cette chute, et il bâtit ensuite la narration à partir d’elle. Mais Ganhaire se distingue du genre de la nhòrla par sa façon de les écrire. Au niveau formel, il écrit ses textes en graphie « normalisée », pour redonner sa dignité à la langue. Par ailleurs, la situation narrative est complexe, et elle brouille les pistes : le narrateur des histoires s’appelle Panolha [Épi de Maïs] ; il écrit dans un bulletin intercommunal fictif qui se nomme aussi Ventador. L’auteur est à la fois l’auteur des nouvelles et il est, en même temps, son personnage Panolha, habitant d’un village « qui n’existe pas encore »… et censé écrire les dites nouvelles : c’est une métalepse humoristique.
Ces écrits imitent l’oral : Panolha fait comme s’il avait un auditoire réel, dont il suggère les réactions et les questions. Ganhaire conte avec une grande finesse, en suggérant le non-dit, des relations entre les personnages. Il multiplie les procédés littéraires pour créer l’humour. Il choisit souvent la tonalité héroïcomique ; il emploie des comparaisons amusantes (los malurs se seguen coma de las graulas dins un ceu de novembre, coma de las chanilhas dins un pinhier, o de las fermics dins un cabinet de confituras7 [les malheurs se suivent comme des corbeaux dans un ciel de novembre, comme des chenilles dans un pin, ou des fourmis dans une armoire à confitures]) ; il utilise les zeugmas (plen de repentança e de bava lusenta8 ; [plein de repentir et de bave luisante]).
Ses textes fourmillent d’exagérations, antiphrases, jeux de mots…
Ce qui importe est de rire ensemble, de partager la joie du rire : Ganhaire croise ses lecteurs très fréquemment, à Bourdeilles ou dans les villages alentour. Les Cronicas de Vent-l’i-Bufa (recueil de ces nouvelles) et Los braves jorns de Perdilhòta (roman où Ganhaire a fusionné trois de ces nouvelles) sont des textes globalement joyeux.
Le regard tragique : solitude, violence et mort sont le lot de l’humanité
En parallèle à ces textes humoristiques, Ganhaire écrit d’autres nouvelles, souvent pour le même bulletin intercommunal Ventador. Elles seront regroupées en 1979 dans le recueil Lo libre dau Reirlutz [Le livre du côté à l’ombre] (le mot reirlutz n’a pas d’équivalent en français). Elles mettent en scène des personnages solitaires, mal à l’aise dans la société, en proie à une angoisse existentielle. Beaucoup proposent une réflexion sur la mort et le suicide.
En 1987, Ganhaire publie un roman fantastique intitulé Lo darrier daus Lobaterras. Ce roman consacre l’avènement du Mal, qui marque la fin d’un monde. Les héros sont deux amis. Le premier se laisse aller à ses pulsions et se transforme en monstre, le second, le narrateur, devient fou. Le village où ils avaient grandi est détruit.
En 2000, Ganhaire publie un second recueil de nouvelles, Lo viatge aquitan, dont le thème principal est la mort.
Enfin, le recueil Çò-ditz la Pès-Nuts [Ainsi dit Celle qui va pieds nus], publié en 2013, met en scène un narrateur solitaire, qui n’a qu’« une » lièvre pour amie (la lebre en occitan, comme Die Hase en allemand). Le narrateur est différent des autres, et en quelque sorte maudit. Il partage avec la Pès-Nuts le sentiment que la vie est éphémère et toujours menacée. Dans les histoires que conte le/la lièvre, la mort est omniprésente.
Ces regards coexistent, dans des œuvres paradoxales
Ganhaire a écrit aussi deux romans de cape et d’épée dans une veine picaresque. Il y décrit « les aventures de héros populaires aux prises avec toutes sortes de difficultés et de péripéties, dans un monde pittoresque, hétéroclite »9, Dau vent dins las plumas (1992) et Las islas jos lo sang (2006). Ce sont aussi des romans d’éducation : le narrateur a des points communs avec le Candide de Voltaire. C’est un jeune Périgourdin du XVIIe siècle, Barnabé, qui découvre le monde après avoir dû s’enfuir de chez lui. À la différence de Candide, il raconte ses aventures à la première personne : le regard porté sur le monde est humoristique, et non ironique. Barnabé est d’emblée confronté à l’extrême violence et à la mort.
Dans le second roman, il vit des aventures encore plus violentes et traumatisantes : la découverte des conditions immondes dans lesquelles les bateaux négriers transportent les esclaves ; le massacre des Irlandais par le dictateur Cromwell à Drogheda.
Les romans policiers, que Ganhaire publie à partir de 2004, traitent eux aussi de violence et de mort. Le commissaire Darnaudguilhem et ses inspecteurs enquêtent sur des affaires sordides : les exactions du gourou d’une secte, les débordements sexuels dans un orphelinat sous l’occupation, les abus de pouvoir médicaux, les trafics d’organes, la prostitution de personnes handicapées, les réseaux maffieux de vente de drogue. Malgré tout, l’humour est l’un des ingrédients principaux de ces romans.
Un rire qui permet de survivre
L’humanité, déraisonnable et dérisoire
L’homme est faible : son corps et son esprit le trahissent. Cette faiblesse peut apparaître comme tragique. Mais tout est question de point de vue : on peut aussi en sourire, ou en rire.
La première constatation est que l’homme ne maîtrise rien du tout dans ce qui lui arrive. Or l’absence de maîtrise est l’un des ressorts du comique, comme en témoigne le personnage de Charlot dans le film Les temps modernes. Donc l’homme est fondamentalement comique. Il en est ainsi de Barnabé se décrivant lui-même, en pleine tempête, roulant d’un bord à l’autre du Sent-Christopher, poursuivi par un seau..
Ganhaire met en scène de nombreux personnages clownesques : Tranuja, vieux célibataire, poursuivi par un motoculteur japonais, le Kekei Keia [Qu’est-ce qu’il y a ?]10, Maxime qui n’arrête pas de tomber (à vélo, en portant son bois…)11, le médecin Botinaud qui veut administrer des lavements à tous ses malades :12
La seconde constatation est l’égalité des hommes devant ce qui affecte leur corps, et devant la mort. Les riches et les puissants ne sont pas préservés : Cromwell le dictateur, sur le bateau qui l’emmène vers l’Irlande où il va massacrer 3000 personnes, a le mal de mer et se met à vomir13. Les émirs de la clinique des Ersas d’Aur [Vagues d’or], malades, doivent attendre l’arrivée d’ un foie ou un rein… On peut penser à la phrase de Montaigne : « Et au plus élevé trône du monde, si ne sommes assis que sur notre cul. »14
La troisième constatation est que la faiblesse de l’homme est aussi mentale. Ainsi Ganhaire met-il en scène de nombreux personnages guettés par la dépression, des personnages atteints de folie douce (le médecin Botinaud devenu fou de science, « tombat amorós d’un bocin de viandassa dins un topin »15 [tombé amoureux d’un bout de vilaine viande dans un pot], des personnages atteints de folie meurtrière (dans le roman policier Un tant doç fogier [Un si doux foyer], un éducateur se fait tuer par un dément qui se croit victime d’un complot international), des mégalomanes et des fanatiques qui ont perdu le sens des réalités.
Les désordres mentaux peuvent toucher chacun d’entre nous.
Le rire, lucide et libérateur
Se prendre au sérieux, c’est paradoxalement n’être pas crédible
C’est vivre dans l’illusion, car c’est méconnaître en soi la part dérisoire qui est le trait essentiel de la condition humaine. Les discours de domination ne sont pas lucides : les personnages qui les tiennent prétendent détenir une vérité, ils cherchent à l’imposer. Mais ils oublient qu’ils sont des hommes comme les autres, faillibles.
Ganhaire déconstruit ces discours par le comique et l’humour (par exemple, discours professionnels des gendarmes, de certains médecins, et discours politiques des intégristes, des fanatiques, des membres de sectes)
Le rire délivre de l’illusion
Au contraire, il est important de se donner soi-même à voir comme objet de dérision, d’assumer ses propres insuffisances, ce qui signifie qu’on a accédé à une vérité. Pour les narrateurs, cela signifie savoir utiliser le registre héroïcomique à la première personne, pour se moquer d’eux-mêmes (Barnabé est dans l’humour, non dans l’ironie voltairienne). Par exemple, la vision qu’il donne de lui-même et de ses amis, après un combat dans les rues de Londres :
Quante una pita tropa de gach anglesa, alertada per quauques ciutadans mautranquilles, bomba dins la vanela, se pòt pas dire que son venguts per ren : un pilòt de cadabres lur barra lo chamin e deven escambalar una montanha roja e sagnosa ‘vances de puescher veire la seguida de l’espectacle. Una femna, ben fricauda per son atge, mauditz lo ceu en ninar un vielh òme a la chara eissicada e que sembla pus ne’n aver per longtemps ; un grand negre se ten l’espatla en petonar dins una lenga que es lo sol a comprener, un pitit gròs boitica en s’acotar a son barrancon, lo braç drech estachat a sa peitrena per un bocin de chamisa, dos jòunes milòrds son trapats a secodre un palhassa bilhat de roge, que a de que migrar per sos piaus, dau biais que l’estinhassan, un medecin de marina que cor d’un blaçat a l’autre mai se fai rebutir de pertot, e un jòune òme, tot plen brave de sa persona, mas que sangluta e pura coma un vedeu entre los braç d’un beu sargent anglés que sembla pas tròp abituat a entau una situacion16.
[Quand une petite troupe de guet anglaise, alertée par quelques citadins inquiets, déboule dans la ruelle, on ne peut pas dire qu’ils soient venus pour rien : un tas de cadavres leur barre le chemin et ils doivent escalader une montagne rouge et sanglante avant de pouvoir contempler la suite du spectacle. Une femme, bien gaillarde pour son âge, maudit le ciel en berçant un vieil homme au visage lacéré et qui semble ne plus en avoir pour longtemps ; un grand noir se tient l’épaule en maugréant dans une langue qu’il est le seul à comprendre, un petit gros boitille en s’appuyant sur son gourdin, le bras droit attaché à sa poitrine par un morceau de chemise, deux jeunes milords sont en train de secouer un pantin habillé de rouge, qui a de quoi se faire du souci pour ses cheveux, à la façon dont ils les lui tirent, un médecin de marine qui court d’un blessé à l’autre mais qui se fait repousser de partout, et un jeune homme, bien beau de sa personne, mais qui sanglote et pleure comme un veau entre les bras d’un grand sergent anglais qui ne semble pas trop habitué à ce genre de situation.]
Il s’agit donc d’user d’une perpétuelle distanciation, d’un regard décalé, pour voir, dans son propre comportement, ce qui peut faire rire, et ce dont on va rire. Le procédé est voisin de celui de Voltaire, dans Micromégas, où le Saturnien compare les humains à de petites mites. On retrouve la même autodérision chez le commissaire Darnaudguilhem, immobilisé par une opération du genou, qui mène une enquête atypique :
E Darnaudguilhem se resignet a passar l’estiu entre escoetatge, paupinhatge, fissadas dins lo ventre, bon minjar, plasentarias mai o mens grassas de Robert, en plaça d’una enquesta eslausianta que l’auriá cubert d’onors e de glòria.17
[Et Darnaudguilhem se résigna à passer l’été entre équeutage, massage, piqûres dans le ventre, bonne nourriture, plaisanteries plus ou moins grasses de Robert, au lieu d’une enquête éblouissante qui l’aurait couvert d’honneurs et de gloire.]
L’enquête n’est pas « éblouissante », mais elle aboutit tout de même : Darnaudguilhem en est d’autant plus admirable.
Le rire ramène les événements à leur juste mesure, et le moi à sa juste place.
Oser rire de tout
Oser rire de tout, c’est apprendre à retrouver la maîtrise de soi (de ses peurs, de ses émotions). On peut donc jouer avec l’horrible et le terrible, pour les apprivoiser, aussi bien au niveau de l’écrivain Ganhaire lorsqu’il invente ses textes, qu’au niveau des personnages qu’il met en scène.
Pour les personnages cela constitue un apprentissage : Le rire est un défi qu’on se donne à soi-même : être capable de surmonter l’horrible par un mot d’humour. Quelques exemples :
- Par plaisanterie, le narrateur de Çò-ditz la Pès-Nuts demande à « la » lièvre si elle ne peut pas enlever sa peau, parce qu’il fait très chaud. Elle lui répond : « Quante quitarai ma peu, quò serà per un autre genre de chalor » (p. 38) [Quand j’enlèverai ma peau, ce sera pour un autre genre de chaleur] : elle se voit déjà coupée en morceaux et mangée en civet.
- Un autre exemple est celui de Ricou, le mari de Paulina Masieras dans la nouvelle « Quo es entau, la vita » [Ainsi va la vie]18. Pauline a perdu toute sa famille à la suite de divers malheurs (guerres et maladies) et elle est devenue muette de douleur. Lorsqu’il la trouve morte, Ricou essaie de refermer sa bouche ouverte. Voilà la chute de la nouvelle :
E ben quo-quí, Paulina, quo es pas ordinari : dau temps qu’eras viventa, podiá pas te far drubir la gòrja, e veiquí qu’aurá que ses mòrta, pòde pas te la barrar !
[Eh bien ça, Pauline, ce n’est pas ordinaire : du temps où tu étais vivante, je ne pouvais pas te faire ouvrir la bouche, et maintenant que tu es morte, voilà que je ne peux pas te la fermer ! ]
L’épisode de la panière (Dau vent dins las plumas) est aussi caractéristique du procédé. Barnabé est emprisonné au fort du Hâ, à Bordeaux. Ses amis lui demandent de se cacher dans un grand panier pour l’aider à s’évader. Or dans le panier il y a déjà un cadavre : c’est celui de son voisin de cellule qui vient d’être décapité. Il doit s’y pelotonner en ne laissant voir que la tête coupée qu’il doit tenir entre ses mains. Au début, il est horrifié ; mais peu à peu il réussit à surmonter sa peur et à voir les choses avec humour :
Sei pas a l’aise dau tot e, secodut mai que a mon voler, ai dau mau a manténer en plaça mas doàs tèstas. Quo es pertant pas lo moment que ieu me faja remarcar per una tèsta de tròp.19
[Je ne suis pas à l’aise du tout et, secoué plus que je ne voudrais, j’ai du mal à maintenir mes deux têtes en place. Ce n’est pourtant pas le moment de me faire remarquer pour une tête de trop.]
Barnabeu Joan Francés Segur de Malacomba, s’enfuyant de la maison familiale, chute sur son premier cadavre.
Dau vent dins las plumas, 1992, illustration de Francesa Calhet.
Le rire permet aux personnages de se libérer de l’angoisse qui les envahit. Pour l’écrivain, il s’agit d’un jeu. D’abord un jeu conventionnel des personnages qu’on croit morts et qui ressuscitent aussitôt (provoquant un effet de surprise) « Figuratz-vos que lo cadabre era pas mòrt…20» [Figurez-vous que le cadavre n’était pas mort]. Mais il s’agit aussi d’un jeu avec les conventions. La très sérieuse et classique méditation sur la mort est tournée en dérision ; le médecin Botinaud est en perpétuelle contemplation d’un cœur prélevé sur un cadavre :
E per nos far sovenir de la freuletat de la condicion umana, lo cur traucat tròna dins un bocau voidat de sos pitits inhons e de son vinagre, amorosament embraçat per un Botinaud tornat jòune de vint ans de mens.21
[Et pour nous rappeler la fragilité de la condition humaine, le cœur percé trône dans un bocal vidé de ses petits oignons et de son vinaigre, amoureusement embrassé par un Botinaud redevenu de vingt ans plus jeune.]
Et on observe la transgression des tabous. Ganhaire applique le schéma comique de l’arroseur arrosé à un terroriste qui veut faire exploser la voiture d’un dictateur : finalement, il va, sans le savoir, jeter la bombe sur un groupe d’enfants innocents, parmi lesquels il y a son fils.
La nouvelle « Releva »22, totalement échevelée, se passe dans une morgue. Les employés demandent des pots de vin aux familles qui veulent éviter que leur mort soit autopsié ; en parallèle, ils demandent aussi de l’argent aux professeurs de médecine pour les laisser autopsier les cadavres en reniant leurs promesses. Tout cela implique qu’ils maîtrisent parfaitement un emploi du temps compliqué et fragile : ils avancent l’heure des autopsies et l’heure de la visite des familles. Mais il y a plusieurs familles et plusieurs professeurs. Or un jour la machine s’emballe, les professeurs s’énervent, les employés se trompent, l’employé en chef est attaqué par la veuve d’un défunt, et il meurt d’une crise cardiaque, devant les visiteurs. Il est aussitôt remplacé par son collègue qui n’attendait qu’une chose : prendre sa place.
Le rire reconnaît la violence, l’horreur, l’inconséquence des hommes, la mort à venir. En même temps, il met tout cela à distance en dégonflant les baudruches. Il met en relief l’absence de sens, l’absurdité des comportements humains.
Mais c’est aussi un défi qu’il n’est pas toujours possible de relever, ainsi du roman policier La mòrt vai mai regde que lo vent [La mort va plus vite que le vent] qui s’ouvre sur la vision d’un homme qui a été brûlé vif : l’humour devient déplacé, les policiers et le légiste finissent la soirée en buvant ensemble des alcools forts.
Conclusion
Rire des autres et rire de soi sont indissociables : rire, c’est d’abord se définir comme membre d’une communauté humaine fondamentalement dérisoire, dont on reconnaît les limites. Il suffit, pour voir cette vérité, de se décentrer (comme le fait Voltaire dans son Micromégas). Rire est une marque de lucidité. Le rire permet d’échapper à l’angoisse tout en restant digne (l’alcool est une fausse solution…). Le rire est affirmation d’une ultime liberté, celle de décider du regard qu’on veut porter sur les événements.
Le rire rend compte à la fois du tragique de l’existence, dont il traduit l’absurdité, et de l’héroïsme, de la dignité de l’homme, qui se montre plus grand que ce qui l’écrase en s’en moquant. Ce rire se situe au-delà du désespoir. Il donne, finalement, le dernier mot à la vie.
Dans la tragédie, le héros, généralement seul, se montre supérieur à sa destinée en se révélant sublime. Il peut, lui aussi, éprouver le sentiment de l’absurdité du monde, de la fragilité de l’homme et de la vanité de ses prétentions, comme Macbeth à la fin de la pièce de Shakespeare :
Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow ; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more : it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.23
[Eteins-toi, éteins-toi, brève chandelle !
La vie n’est qu’une ombre errante ; un pauvre acteur
Qui se pavane et s’agite une heure sur la scène
Et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire
Racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur,
Et qui ne signifie rien.]
Mais cette révélation ne mène Macbeth qu’au désespoir, sans autre issue.
L’anti-héros mis en scène par l’écrivain humoriste a une attitude très différente : il devient héroïque, paradoxalement, en se montrant capable de se moquer de lui-même et de ce qui lui arrive, en se reconnaissant comme l’un des membres d’une communauté humaine tout aussi dérisoire que lui, en donnant pour finir le dernier mot à la vie.
Au travers de ses textes humoristiques, Ganhaire, tout comme Rabelais, apporte à ses lecteurs le moyen de dépasser l’angoisse et le désespoir, le remède au « dueil qui [les] mine et consomme 24», remède qu’il s’applique également.