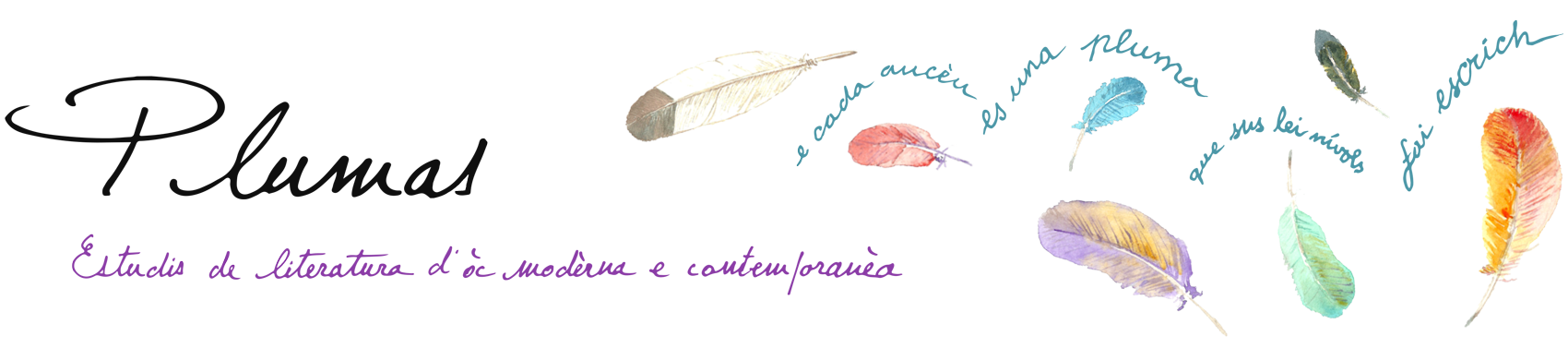En 1955, la collection Messatges fait paraître le recueil Accidents de Bernard Manciet, une œuvre qui marqua son époque et imposa le poète gascon comme l'une des voix majeures de la seconde moitié du 20e siècle. Dans quel contexte éditorial cet événement littéraire a-t-il vu le jour ? Nous avons voulu ici retracer les quatre années qui ont précédé ce moment, en voyageant de recueil en recueil à travers les univers de Max Allier, Félix Castan, Pierre Lagarde, Bernard Lesfargues, Pierre Bec, Xavier Ravier. Nous remontons, en quelque sorte, la source. Nous essayons de tracer les contours d'une période particulière, depuis la présence encore angoissante de la guerre jusqu'aux promesses d'un jour nouveau. C'est une véritable « génération » qui se dessine (la plupart sont des enfants des années 1920) pleine d'espoir, mais marquée par l'expérience du conflit, et lucide face aux enjeux de son temps. Accidents est un recueil charnière qui prolonge tout autant qu'il brise (dans un double mouvement) la trajectoire poétique de ce début des années 1950. Visiter les textes qui précèdent son édition permet de mettre en relief cette ambivalence et de proposer une étude comparative riche en enseignements. Au-delà de Manciet, c'est toute la poésie occitane à venir qui est en germe à travers ces auteurs. Nous sommes en présence de sept voix qui se ressemblent parfois, mais creusent, chacune à leur manière, un chemin unique pour sortir de la nuit et accueillir l'aube, avec sa charge de mystère. Sept voix pour sept bergers au beau milieu du siècle : suivons-les, ou perdons-nous sur leur pas tant ils sont passés maîtres dans l'art de métamorphoser le monde.
Encore la nuit, encore la guerre
Voici donc sept recueils, tous de la même ampleur, autour d'une cinquantaine de pages : ce qui est relativement court puisqu'ils sont accompagnés de leur version française. Le recueil le plus long est celui de Max Allier, le plus bref celui de Pierre Lagarde. Seul Manciet y déploie une prose poétique, les autres déroulent des pièces, en vers libres la plupart du temps. Une unité formelle se dégage donc, à première vue, dont Accidents semble se démarquer nettement. La forme « courte » est en grande partie liée au contexte économique. La collection Messatges fonctionne avec peu de moyens et ce sont bien souvent les auteurs eux-mêmes qui engagent de l'argent pour pouvoir réaliser l'édition. La volonté de produire une grande quantité de textes, de donner leur place à tous les auteurs (ils sont nombreux) du moment, va également dans le sens de la brièveté. Nous sommes alors dans une période de conquête : il faut déployer cette poésie, dans sa richesse, dans sa variété, afin d'asseoir les lettres d'oc, définitivement, au cœur de leur temps. Nous comprenons donc bien que les responsables de la collection aient opté pour des recueils brefs, mais denses. Le choix du bilinguisme (la version française est toujours proposée, en regard) est affiché : cette poésie doit être accessible aux non-occitanophones. Cependant, pour les auteurs que nous avons étudiés, aucune précision n'est donnée : s'agit-il d'une traduction de l'auteur ? Si non, qui s'en est chargé ? Nous ne le savons pas.
Au-delà de ces considérations formelles, et d'ensemble, un premier élément permet une lecture transversale de la plupart de ces œuvres : l'ombre du grand conflit. La seconde guerre mondiale est là, encore omniprésente. Ces auteurs l'ont vécue, y ont participé activement pour certains. Ils cherchent à s'en détacher tout en entretenant la mémoire, collective, militante. Les recueils de 1951, plus proches dans le temps, sont bien sûr les plus marqués. Chez Max Allier ou chez Félix Castan, la poésie garde en elle l'écho des combats, la trace des années sombres. Tous deux sont des témoins directs. Félix Castan nous livre ainsi des poèmes écrits au plus près de la bataille, tout comme le poème IX intitulé « Pausa » (p. 17) évoquant le combat de la pointe de Grave (où les alliés ont affronté une poche de résistance nazie) :
PRIMIER d'abrilh, jorn trebol !
Pascas de 1945 !
Identitat del mond e de la vida !
Las andadas ont se guerreja
menan al païs de l'ombra...
Berchtesgaden !
L'abrilh que vivi jos las nívols
poja a l'altissima solelhada,
mal-despièch lo fum dels mosquilhs musicaires.
Los vinatièrs soldats còmpran a la forèst
un talhon de repaus bressat dels canons.
La plana canta e rebombís.
Es amb l'èime bartassièr
que recèbi ora per ora
dels quatre vents lo resson de l'eveniment...
Punta de Grava, I d'Abrilh de 1945. Jorn de Pascas
Premier avril, jour plein de trouble !
Pâques 1945 !
Identité du monde et de la vie !
Les avenues où l'on fait la guerre
mènent au pays de l'ombre...
Berchtesgaden !
L'avril que je vis sous les nuées
au plus haut du soleil s'élance,
en dépit de l'essaim des insectes chanteurs
Avinés, les soldats empruntent à la forêt
un morceau de repos bercé par les canons.
La plaine retentit et chante.
C'est avec un esprit buissonnier
que je reçois heure par heure
des quatre vents l'écho de l'événement...
La Pointe de Grave, jour de Pâques, 1er avril 1945.
L'expérience du conflit et les textes issus de cette période sont aussi très présents chez Max Allier ou chez Pierre Lagarde. Lagarde évoque d'ailleurs l'ombre de la guerre à travers une autre épreuve, celle du STO (Service Travail Obligatoire) en Silésie sans le poème « Darrièr estiu » (p. 25) :
Darrièr estiu,
matin de Silesia,
matin bronzinaire de fabricas,
lusejant d'esquinas nusas,
matin d'estiu encadenat.
Dernier été,
matin de Silésie,
matin bourdonnant d'usines,
Luisant de dos nus,
matin d'été enchaîné.
Et nous y sentons déjà une amertume, un sentiment de culpabilité peut-être : celle de faire partie des vivants, d'être de ce nouveau monde en devenir, contrairement aux amis qui sont, eux, partis :
mon cambarada
mòrt al matin de l'esperança
desencusa-me d'aver encara
dos uèlhs vesent lo cèl.
Mon camarade
mort au matin de l'espérance
pardonne-moi d'avoir encore
deux yeux voyant le ciel.
C'est exactement la même idée que l'on retrouve chez Max Allier. Avec le poème Cada causa a tornat a son agre (Tout a repris ici sa place), le poète évoque la vie qui a repris son cours, sans les disparus, sans les morts. Ces morts seraient-ils morts pour rien ? La vie qui recommence porte la marque de la guerre mais cette marque s'efface peu à peu soulignant, avec cruauté, l'absurdité du conflit comme en témoigne le poème V du recueil :
Los mòrts degun se tracha pas pus d'eles
nimai de saupre un còp per de que son casuts
Barrejats a l'espés de la tèrra
fantaumas que lo vent dins la polsa carreja
los paures mòrts diriàtz qu'an pas jamai viscut
Les morts qui donc encore s'en inquiète
et pourquoi se sont-ils battus
mêlés à l'épais de la terre
fantômes que le vent lève dans la poussière / on dirait que jamais les morts n'ont vécu.
Mélangés à la terre, oubliés tels des fantômes emportés par le vent, les disparus s'effacent et l'ombre de la guerre s'estompe aussi. Le conflit n'est plus là chez Pierre Bec, chez Xavier Ravier ou Bernard Lesfargues. Il faudra attendre Accidents pour qu'il ressurgisse, soudainement, et de façon puissante, depuis l'autre côté, du point de vue des perdants : dans une Allemagne réduite en poussière. Continuation et rupture, le Gascon est à la fois celui qui file la métaphore et change de regard. Chez les autres poètes, des années 1952 à 1954, la guerre mondiale s'est effacée. On est passé à autre chose, définitivement, même si une ombre, une angoisse reste palpable. La guerre n'est plus mais le temps qui passe laisse planer un sentiment de honte : la honte de ne pouvoir retenir ce qui nous file entre les doigts, inexorablement. Nous pensons ici au poème « Brageirac » qui ouvre le recueil de Bernard Lesfargues, une évocation lucide d'un Bergerac passé, d'un temps perdu, et un lent mouvement d'eau qui fuit, sans cesse :
Brageirac sus la Dordonha
Brageirac del mes de mai,
te perdèri per jamai
amb l'amor e la vergonha.
Bergerac, sur la Dordogne,
Bergerac du mois de mai,
je te perdis à jamais
avec l'amour, avec la honte.
La poésie se fait alors chant de la disparition, volonté de dire la fin de quelque-chose en même temps que le début d'une autre époque... Nous plongeons dans un temps perdu, celui des anciens mondes peuplés de fées, chez Pierre Bec. L'une de ses pièces, « Jòcs de hada » (p. 11), d'ailleurs dédiée à Félix Castan, illustre parfaitement cette dualité en évoquant le printemps, les fleurs et la mort dans un seul et même mouvement poétique :
Morta que m'èra a jo-medeisha
De tan doça qu'èra la prima,
De tan pregon qu'èra lo viver ;
Alanguida a l'alen de l'aura,
La nèu blanca dau cesirèr
M'aviá, morenta, sebelida...
Morte me semblais-je à moi-même
De tant doux qu'était le printemps
De tant profond qu'était le vivre ;
Alanguie aux souffles des brises,
La neige blanche du cerisier
M'avait, mourante, ensevelie...
Le texte est ambivalent, il essaie de dire la finitude et le commencement. Tout est poésie du passage, de la transition, du seuil. Pour prendre une image aquatique, nous dirions que se développe alors une poésie du gué. Le poète est au cœur de l'écoulement du temps, il passe, il change de rive mais il risque, en même temps, de chuter et de ne faire plus qu'un avec l'élément, avec le mouvement du liquide. C'est d'ailleurs bien ce que fait Lesfargues avec sa Mère des eaux : un véritable chant des rivières et des fleuves, de l'écoulement des sources au fil d'une langue d'oc, rare et fragile. Une eau qui, comme ce Limousin sonore, ruisselle mais nous échappe. La langue est l'image d'un monde qui disparaît : elle est une quête sans fin des reflets. Aux antipodes de l'affirmation forte et déterminée que lançait Max Allier dans le poème « Ma cara » un an plus tôt : « Aici ma cara / A la raja dau temps l'ai quilhada » [Voici mon visage / Levé dans le temps qui fait rage], Lesfargues, lui, poursuit un visage noyé dans les quatre derniers vers de sa « Cançon de la cara negada » :
Peis o pèrla o ben tot pèira
s'es negada aquesta cara
e lo recòrd s'es negat
dins lo fons del fons de l'aiga.
Poisson, perle ou si l'on veut pierre,
ce visage s'est noyé
et s'est noyé le souvenir
au fond de l'eau tout au fond.
Fuite de l'eau, encore et toujours chez Pierre Bec dans « Brius d’aiga » (p. 15) :
E húge', e véder húger l'aiga amorosida,
N'audir lo briu dinc'a ne pèrder la sentida,
Este lo crum que hug e la flor de l'abriu.
Et fuir, et voir fuir l'eau amoureuse,
En entendre le flot jusqu'à en perdre le sens,
Être la nue qui passe et la fleur de l'avril.
Cette fleur d'avril laisse s'éloigner l'avril combattant de la Pointe de Grave de Félix Castan. La nuit s'éloigne chez Pierre Bec qui se laisse aller au « briu de l'estona » [Au rythme de l’instant], elle est encore là mais pleine du jour à venir chez Pierre Lagarde dans « l'espèra del jorn » [L’attente du jour], alors que Xavier Ravier s'inscrit définitivement dans le printemps avec son « troç de prima » [Morceau de printemps] : les titres des recueils sont éloquents. Un monde nouveau appelle l'urgence de vivre, le désir de s'inscrire dans le présent. Tous ces poètes chantent l'aube, la naissance, le renouveau, et pourtant nous sentons poindre une angoisse. L'angoisse de ce qu'il va advenir, l'angoisse de vivre, d'attraper chaque instant, de ne rien manquer... L'angoisse de la langue aussi, bien sûr, de l'enjeu de la transmission et de l'œuvre littéraire en langue d'oc. Un jour nouveau s'ouvre mais l'innocence est perdue et il faut être à la hauteur des enjeux à venir. Citons Xavier Ravier (p. 11) :
Quan lo nòste pas auja marcat aquera plana
quan nòst'ombra auja vestit las erbas
quan nòste cric auja heit lhevar la saunejada deus auseths
que seram partits
d'aqueths endrets de l'inocéncia.
Quand notre pas aura marqué cette plaine
Quand notre ombre aura vêtu les herbes
quand notre cri aura fait lever le songe des oiseaux
nous serons déjà partis
de ces parages d'innocence.
Ce poème du départ, du détachement, est à l'image de l'ensemble du corpus que nous avons défini : nous pouvons cependant dégager deux tendances qui sont à la fois thématiques et formelles. Une poétique de l'instant, du microcosme, qui est aussi celle du temps ralenti, traverse les œuvres, par opposition à la poétique de l'accélération et du vertige qui atteint son apogée chez Bernard Manciet.
Entre ralentissement et accélération poétique
Chez tous ces auteurs, malgré les grandes variations de ton et d'approche esthétique, l'écriture est une expérience de l'instant, un ancrage dans le monde. Le jour se lève et la lumière éclaire les détails, dévoile la silhouette des choses : le poème prend alors le temps, il s'attarde et peint, avec attention, la nature retrouvée. Nous pensons bien-sûr à Max Rouquette qui développa cette poétique à travers l'œuvre de toute une vie. Le recueil de Pierre Bec en est un autre exemple (mais cette tendance se retrouve chez Castan et Allier déjà). Cette idée est au cœur du poème « Au cercaire de Benaurança » qui ouvre Au briu de l'estona :
Ièr, uèi, deman, volastrejada
De punts dens l'encant de la vita,
Dens la doçor deu desbrembèr
Nega ton anma adolentida.
Hier, aujourd'hui, demain, voltigement
De points dans l'enchantement de la vie ;
Dans la douceur de l'oubli / Noie ton âme endeuillée.
Plus loin :
Non penses mès ! Huja l'idèa !
Que l'encens de la flor majenca
T'enclauda'th món en un moment
D'eucaristica prigondor...
Ne pense plus ! S'enfuie l'idée !
Que l'encens de la fleur de mai
Enclose pour toi le monde dans un moment
D'eucharistique profondeur...
C'est, évidemment, le même regard que porte Pierre Lagarde sur « sept grillons » qui « grelottent », avec une petite musique très rouquettienne (p. 7) :
Set grilhs tridòlan
entre lo potz
e lo pesquièr vèrd de luna,
sèt grilhs paurucs
dins la nuèit d'èrba.
Sept grillons grelottent
entre le puits
et l'étang vert de lune
sept grillons peureux
dans la nuit d'herbe.
C'est aussi l'attention portée par Bernard Lesfargues à « Ce que fredonne l'eau », « çò que l'aiga jonjoneja » (titre du poème de la page 33) ; et c'est, enfin, loin des angoisses et des regrets ou des détachements, le plaisir pur du moment célébré, comme un retour à la source, à la sensualité, qui est déjà présent dans « La Fònt » de Max Allier (p. 43) :
E de çò que la fònt dins la prada gorgolha
E qu'un bresilh d'aucèl nos ven tèner solaç
Fau salir de son esa una espatla redonda
Leva un parpelh d'enfant e çò ditz Esta suau
Fai tròp caud E li beque sas bocas que fonhan
Et tandis que dans l'herbe la source bougonne
et qu'un oiseau sonde le calme de l'été
je fais saillir sa gorge ronde du corsage
Ouvrant un œil d'enfant elle me dit Sois sage
il fait trop chaud Et je baise ses lèvres boudeuses.
Le chant de l'instant, soucieux de dire le moment rare et fugitif, peut également basculer dans une fuite effrénée. Ce n'est plus le petit détail, le calme d'une parenthèse arrachée au passage du temps, mais plutôt l'accélération, l'emballement, la brusque envie d'être au monde et de n'en rien manquer. Le poète veut être au cœur des événements et des batailles (Nous retrouvions cela chez Castan dans le premier poème cité plus haut: « que recèbi ora per ora / dels quatre vents lo resson de l'eveniment... » [Où je reçois heure par heure / des quatre vents l’écho de l’événement]). L'écriture est alors au plus près des cataclysmes et des orages : il faut éprouver, sentir, vivre au-delà des limites. Il faut s'engager dans ce monde naissant, être dans la lueur de l'aube. En 1951, Félix Castan résumait bien cette dimension avec son Hic et Nunc (p. 27) :
Aimi mai de beure l'aire de la vida
a ricas alenadas
abans de tombar dins lo cròs
per tant d'èsser dolent
quand ne virarà
de m'anar jaire dins la mòrt...
Soi nascut demèst la raça umana
per me regaudir longtemps
de sas femnas
e de sos trabalhs
e de sa carn perdurabla e viva.
Car tot es jove e s'encamina.
J'aime mieux boire l'air de la vie
par fortes lampées
avant de culbuter dans la tombe,
afin de regretter
quand ce sera l'heure
d'aller m'allonger dans la mort...
Je suis né parmi la race humaine
pour longtemps me réjouir
de ses travaux
et de ses femmes
et de sa chair perpétuelle et vivante !
Car tout est jeune et tout se met en chemin.
Cet extrait nous fait immédiatement penser à Jòrgi Rebol (Georges Reboul) qui lui aussi, un peu plus tard, a développé une poésie de l'engagement charnel et total, d'esprit et de corps, pour le monde qui naît. Cet engagement est aussi politique et social (et culturel, avec l'occitanisme), en connexion avec les préoccupations de ce temps. L'idée est très présente chez Max Allier qui souhaite être « dans la mêlée », « Dins la contèsta » (Allier, p. 59), et s'affirme comme poète politique dans son fameux Aici sèm (dédicacé à Castan, d'ailleurs) :
Vos cau pas espantar s'el a quitat la mina
s'a trach la manaira e la tibla
e s'es vengut aicí tastar
sus lo caladat
l'endevenença que s'aisina
Ne vous étonnez pas qu'il ait quitté la mine
et laissant la truelle et la bigue
qu'il soit ici venu tâter
sur le pavé
l'événement qu'on lui destine.
Nous nous rapprochons là des textes de circonstance, d'une poésie qui se fait l'écho des problèmes du siècle et cadre avec tout un contexte social. Nous pensons au poème Militant (p.31) de Félix Castan ou à son Mac Gee écrit le 10 mai 1951, donc deux jours après l'exécution de cet afro-américain condamné à mort pour viol, sans preuve réelle (cette affaire défraya la chronique à l'époque, en pleine lutte pour les droits civiques aux États Unis). Mais, après les textes d'Allier et de Castan, cette dimension-là sera abandonnée. Nous ne retrouvons plus de verve politique et sociale, plus de références aux luttes du moment même si, chez Manciet par exemple, le contexte historique tisse une toile de fond apocalyptique (Accidents dépeint une ville de Berlin réduite en cendres par les bombardements alliés). L'engagement se déplace, il devient purement poétique. C'est l'homme au cœur d'une histoire effondrée que l'on découvre, et le texte devient chaos initial, bigbang poétique et linguistique... L'instant chez Bernard Manciet se transforme en un enchaînement brutal et précipité, une plongée dans le chant de la rapidité, des chocs. Nous sommes toujours au beau milieu de ce siècle, inscrit dans la grande et longue Histoire, et, comme chez Allier, Lagarde, Castan, encore dans la guerre : il y a donc tout autant rupture que continuité. Manciet s'éloigne pourtant des autres poètes de sa génération, parce qu'il accélère le rythme et ne s'embarrasse plus du vers. Sa prose poétique est unique dans le corpus que nous avons défini, elle déroule une écriture lancée à pleine course, totalement libre. Mais nous sommes, comme chez Castan, Allier ou même Lagarde, dans un appel à la vie, à l'action. L'aube est un réveil brutal (p. 5) :
Soi jo. Deishida-te. Lèva-te. Ven ! Qu'èi besonh deus esquiç deus tos vint ans. Qu'èi besonh de ta man dens la mia. Sias-me complice. Lèva-te.
Qu'èi besonh de marchar dab tu dens la nueit.
C'est moi. Réveille-toi. Debout. Viens ! J'ai besoin des craquements de tes vingt ans. J'ai besoin de ta main dans la mienne. Sois-moi complice. Lève-toi.
J'ai besoin de marcher avec toi dans la nuit.
Ensuite, tout s'accélère (p. 7), comme s'il fallait s'extraire de quelque-chose ou aller vers un ailleurs, un horizon inconnu (et que l'on ne peut connaître, l'essentiel étant l'accélération elle-même) :
Deishida-te. Mes viste. Enquèra. Mès que dròms, Diu vivant !
Autostradas ? Que n'i a tot jamès. Tots-temps. N'an pas nada fin. Sufeish de har virar, de passar sus las vilas, los fluvis, los camps. De har virar tan viste que hessin grans gestes, arbres, vilas, de pas nos arrapar. E après ets que i a lor sovenir per virar dessús. Après... ah ! Qu'es aquò, çò que cau véder : après...
Réveille-toi, accélère. Davantage. Mais tu dors, tu dors, parbleu.
Des autostrades ? Elles se succèdent sans fin inépuisables. L'essentiel est de rouler, de passer sur les villes, les fleuves, les champs. De rouler si vite que nous voyions, arbres, villes, faire de grands gestes de désespoir, désespoir de ne pouvoir nous rejoindre. Et même après eux, nous pourrons toujours rouler sur leur souvenir. Et quand il n'y aura plus leur souvenir ?... Ah ! Mais voilà le passionnant, voilà justement...
Après ? Justement, nous ne saurons pas. Tout le recueil n'est ensuite plus qu'une envolée, un moteur qui tourne à plein régime. Cette écriture du mouvement nous évoque Jack Kerouac (qui publie d'ailleurs Sur la route en 1957), l'écrivain « beat1 » qui marqua la génération suivante. Manciet déroule son texte comme l'asphalte et tout est emballement d'images et de sons, bruits de machines, de motos, de camions, tourbillon de cerfs-volants et de poteaux télégraphiques.
Mitrailler l'aube, ou la piquer au bout d'un bâton ?
Après, demain ? La question de l'avenir nous paraît essentielle. Tous ces textes tissent un rapport complexe au temps ; tous ces auteurs ont pleinement conscience de leur situation : ils sont à la charnière, ils ferment un cycle et en ouvrent un autre. Ils sortent de la nuit mais ne sont pas encore en plein jour. L'image de l'aube revient, sans cesse. Elle est partout présente. Ces sept recueils déploient une poésie de l'aube et de l'éveil, une écriture qui oscille (mais ne choisit pas véritablement) entre obscurité et lumière. Cependant, ce ne sont que des aubes naissantes, nous ne pourrons pas savoir ce que sera le jour à venir. Les poètes œuvrent à son apparition, ils s'extraient de la nuit et du sommeil, mais ce qu'il leur reste à vivre demeure nimbé de mystère.
Voilà donc des poètes du réveil, debout, des poètes prêts à partir : ils s'ouvrent au jour mais qui ont du mal, visiblement, à s'extraire de la nuit, citons Pierre Bec dans « Partença » (p. 53) :
Partit a l'auba, dab un punhau de lutz negra,
cap d'estela qu'estèsse amara au cèu d'abòr,
[...]
Partit, e cap de vent que'm posquèsse jumpar
devath la huelha hòla e fremerenta.
L'auba, de ròsa negra, e ridenta de dòu,
capvirava la nueit en dia, e caminavi
cap a la fin deu dia,
e sempre nueitejava...
Parti à l'aube, avec un poignard de lumière noire,
pas une étoile qui fût amère au ciel d'automne,
[...]
Parti, et pas de vent qui me pût bercer
sous la feuille folle et frémissante.
L'aube, de rose noire et riante de deuil,
chavirait la nuit en jour, et je cheminais
devers la fin du jour,
et la nuit tombait toujours...
La nuit qui n'en finit pas, c'est une nuit sans étoile, une aube en deuil... Aucune étoile non plus chez Bernard Manciet puisqu'il l'affirme clairement : « i a pas nada estela » [Il n’y a aucune étoile] (p. 5). L'aube est donc double, elle est renouveau mais aussi fin, elle est espoir mais garde une forte charge d'ombre et de trouble. L'aube permettra de voir le monde en face, tel qu'il est, c'est elle qui éclairera l'horreur de la guerre et l'immense chantier qui se dresse sur les ruines du monde. Bernard Manciet veut d'ailleurs en finir avec l'aube, il est déjà ailleurs et c'est avec violence qu'il décide de passer à autre chose, définitivement (p. 17) :
Cala la mitralhadora. Ua banda que serà pro, ben. Son que ua tirada. Es prest ? En plen dins lo matin. Cau har càder tots las cortías deu cèu. Cau fóter l'auba per terra. D'aubas, en cau pas mes jamès. Ni de nueits. Ni de jorns.
Cale la mitrailleuse. Une bande suffira, sans aucun doute. Une seule rafale. Prêt ? En plein dans le matin. Il faut abattre tous les rideaux du ciel. Il faut jeter l'aube à terre. D'aubes, il n'en faut plus jamais. Ni de nuits. Ni de jours.
Radicalité poétique : d'un coup de mitrailleuse bien placé, Bernard Manciet assassine l'aube. Voilà un coup de feu, un coup de maître qui inaugure une belle carrière littéraire. Il fallait cela, semble-t-il, pour sortir des ruines de Berlin, pour quitter la guerre et assumer le renouveau. Accélération, vertige : c'est d'ailleurs bien à la mitrailleuse que Manciet écrit ses Accidents : des rafales poétiques capables de redonner du rythme et du souffle à l'occitan, à la poésie, capables d'aller plus loin, de déclencher un mouvement puissant et de projeter l'écrivain gascon au-devant du siècle, au-delà des barrières, des clichés et des habitudes qui taraudent l'ancien monde. Une rafale poétique qui ne doit cependant pas faire oublier les eaux calmes et mystérieuses de Lesfargues ou, plus encore, les errances de Xavier Ravier qui retourne, lui, au sommeil, à la douceur et à l'onirisme. Face à l'aube mitraillée, il dessine un « soleil piqué » au bout d'un bâton de berger, comme un retour au calme, comme un apaisement qui n'en est pas moins riche de sensations et de force poétique (p. 25) :
Aqueth vielhòt qu'amía de cap au men temps de mainatge
tot un tropeth de còstas,
aus sons còts quauqu'esquira
dab martheth de printemps.
Lo solelh ei gahat au cap de son baston,
dens las suas mans granas que sarra
aqueth païsatge de lana on me soi adromit.
Ce vieil homme mène vers mon enfance
tout un troupeau de collines,
sur leur cou je ne sais quelle cloche
à marteau de printemps.
Le soleil est piqué au bout de son bâton,
dans ses grosses mains il presse
ce paysage de laine où je me suis endormi
Le poète dévoile ici la silhouette d'un berger qui rassemble le monde et bouleverse les périodes d'une vie, au-delà de la linéarité (on retrouve, dans une certaine mesure le bouleversement que constitue Accidents), ce qui nous ramène aussi à Pierre Bec (p. 18) :
Pastre, descauç, shumant la prima,
[…]
Levant au cèu d'un gèste hòu
Sa tocadèra embriagada
Pâtre, nu-pieds, humant le printemps
[…]
Levant au ciel d'un geste fou
Sa houlette ensorcelée
Ce bâton de berger qui pique le soleil, cette « houlette ensorcelée », indiquent d'autres chemins, dévoilent des « drailles2 » insoupçonnées. Le jour peut venir, enfin. Ces sept poètes sont les bergers sur la ligne d'horizon, au loin : sur la ligne de partage des eaux, au beau milieu d'un siècle. Plonger dans leurs œuvres, c'est découvrir une période pleine d'espoir, c’est aussi revivre cette aube ambivalente de l'après-guerre, et suivre des trajectoires poétiques en devenir ; certaines seront longues et prolifiques, d'autres plus discrètes. Des lectures transversales sont possibles, nous venons de le voir, elles permettent d'aborder l'unité mais aussi la grande variété des approches esthétiques de ce temps. C'est là toute l'importance, toute la pertinence de la collection Messatges : une collection qui a su créer, entre 1951 et 1955, un espace ouvert aux expérimentations d'une génération féconde. Les Accidents de Bernard Manciet s'inscrivent, malgré leur originalité formelle, dans cette période poétique occitane pleine de promesses. Ils ferment peut-être ce cycle de l'aube, cette série de recueils d'éveil qui, jaillis des obscurités de la guerre, indiquent la route à suivre pour les années à venir. Mais l'aube n'en finit pas : c'est toute une langue qui s'éveille, qui s'ébroue au petit jour et chaque poète en reflète la lueur, avec singularité.