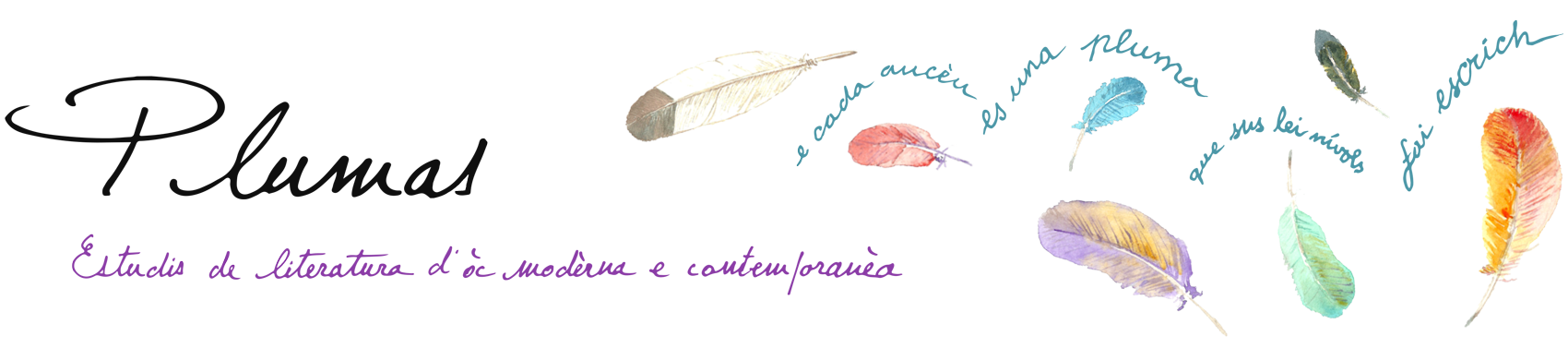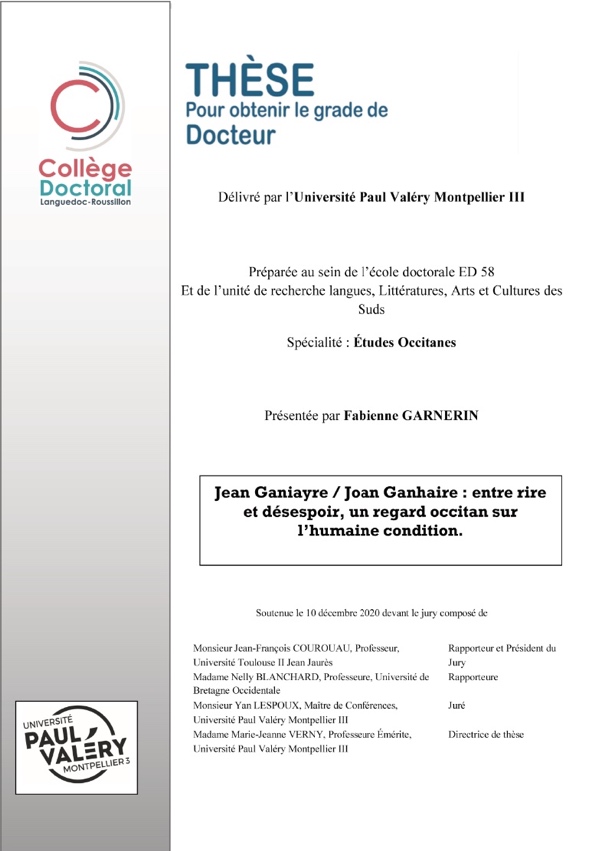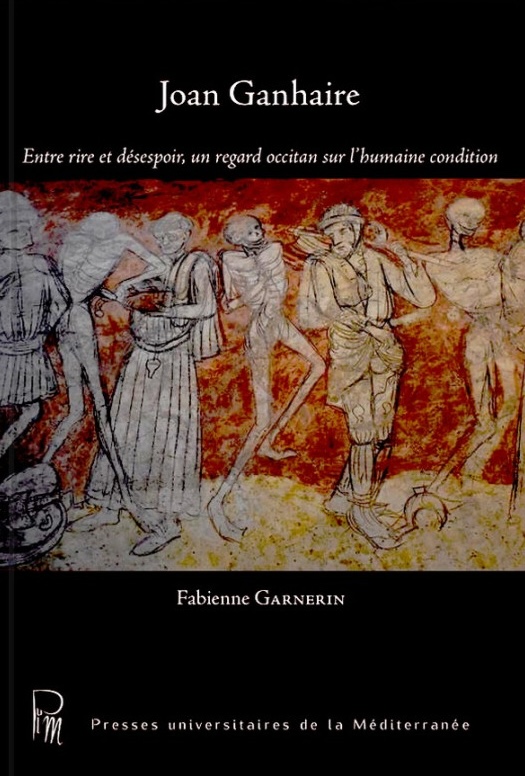Per Fabienne Garnerin
Tous les rédacteurs des articles de ce dossier en témoignent : la connaissance de l’œuvre de Joan Ganhaire doit beaucoup au travail pionnier de Fabienne Garnerin. Après la rédaction d’une thèse1 de 728 pages, elle avait publié une version abrégée de celle-ci aux Presses universitaires de la Méditerranée2.
|
|
|
Première de couverture de la thèse de Fabienne Garnerin – première de couverture de l’édition abrégée.
Sa disparition soudaine, au début 2023, nous a tous profondément touchés, alors même que son étude venait tout juste de sortir des presses et qu’elle s’apprêtait à présenter son travail dans plusieurs lieux de l’espace occitan. Elle avait, avec modestie et détermination, accepté de diriger ce numéro de Plumas car elle souhaitait ardemment échanger ses propres analyses avec celles d’autres chercheurs. Le titre qu’elle avait choisi « Joan Ganhaire, diversité des genres et unité de l'œuvre / Joan Ganhaire, diversitat dels genres e unitat de l'òbra », visait à montrer en quoi l’œuvre de Joan Ganhaire est une grande œuvre parce que, derrière l’impression d’éclectisme qu’elle peut donner (genres littéraires, volume des textes, époques et espaces visités, tonalités…), elle est marquée par une profonde cohérence. Fabienne Garnerin suggérait notamment plusieurs axes d’étude qui ont inspiré les contributeurs ici rassemblés : l’environnement et le paysage, la position de l’écrivain, les genres littéraires…
Elle n’aura pas eu le temps de mener à terme la direction d’un dossier sur lequel elle s’était beaucoup investie à travers la rédaction de l’appel à communication et les premiers contacts avec plusieurs contributeurs. Nous avons repris ce travail, sans avoir, nous le confessons, les connaissances qui étaient les siennes, fruit de trois années de fréquentation assidue de l’œuvre, complétée par des échanges suivis avec l’écrivain. Nous avons également retrouvé dans les archives scientifiques que nous ont confiées ses enfants trois communications qu’elle avait prononcées en périphérie de son travail de thèse. Fabienne Garnerin complétait en effet ses recherches nécessairement solitaires avec un investissement systématique dans les colloques ou journées d’études où elle pouvait glisser une réflexion sur l’œuvre de Ganhaire : un colloque sur la question des territoires et des langues, un autre sur les fonctions du rire et enfin une journée sur les pratiques et représentations du savoir et du savant. À partir de la belle métaphore de l’obscur objet de désir, elle analyse ainsi la construction progressive de l’espace occitan comme État-Nation dans les romans policiers de Ganhaire, une construction où le « désir » n’est pas aveuglé par les risques de dérive que n’évite aucun État-Nation, les Roms étant donnés comme contre-modèles, eux dont le seul pays est dans les mots de leur langue. L’article sur le rire montre que ce dernier exorcise l’angoisse et, peut-être, nous permet de trouver encore quelques raisons de vivre par-delà le désespoir. Enfin, la traduction littéraire des connaissances du médecin qu’était l’auteur est finement analysée en ce qu’elle permet de communiquer la souffrance côtoyée et plus généralement d’innombrables facettes de l’humanité et de sa place en société.
Il est certain que la lecture du dernier roman Lo Pacient espanhòu, aurait corroboré et enrichi les analyses développées il y a trois ans. Et nous remercions la revue OC de nous autoriser à publier dans ce dossier un article critique de Philippe Gardy.
Sur cette question du rapport entre le médecin et l’écrivain l’article d’Evelyne Faïsse, par ailleurs autrice d’une thèse sur la nouvelle en occitan3, apporte des précisions bienvenues, intégrant les dernières parutions de Joan Ganhaire, que Fabienne Garnerin n’avait pas pu connaître.
La bibliographie primaire et secondaire qui figure dans ce numéro est aussi le fruit du travail de Fabienne Garnerin, mis à jour par les informations communiquées par Joan Ganhaire.
Grâce à l’aimable autorisation de la rédaction de la revue Paraulas de novelum, et de son rédacteur en chef Jean-Claude Dugros, nous publions également un article synthétique de notre amie sur l’œuvre de Joan Ganhaire, publié après la soutenance de sa thèse dont elle résume avec brio le propos et dont nous extrayons ces mots qui disent tant d’elle et que nous ne pouvons lire sans émotion
E de vrai, davant aquela fin que nos espera tots, l’i a mas dos biais de reagir : se carcinar los sangs, se desesperar, quitament se dire que la vita vau pas la pena d’èsser viscuda ; o tot uniment acomplir que sem pas de talha a luchar, e que lo sole poder qu’avem es lo d’en rire, un poder vertadier que nos fai mai bels que çò que nos espera.
Il est vrai que, devant cette fin que nous guette tous, il n’y a que deux façons de réagir : se ronger les sangs, se désespérer, et même se dire que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ; ou tout simplement accepter que nous ne sommes pas de taille à lutter, et que notre seul pouvoir est d’en rire, un pouvoir véritable qui nous fait plus grands que ce qui nous attend.
Nous remercions également Jean-Claude Dugros de nous avoir communiqué un texte de fiction de Fabienne Garnerin4, publié par Paraulas de Novelum où l’on retrouvera la marque de la nhòrla limousine, genre littéraire spécifique dont il sera maintes fois question dans ce dossier, puisqu’il est un des genres renouvelés par Ganhaire.
Études comparées
Trois contributions confrontent l’œuvre de Ganhaire à celle d’autres écrivains : Monica Longobardi, par ailleurs autrice d’une traduction italienne du roman Vautres que m’avetz tuada, précédée par une étude du roman, compare Ganhaire à Italo Calvino. Elle le fait d’abord à travers les concepts de « Reirlutz » (Ganhaire) et « ubagu » (Calvino), « un concept similaire pour décrire la géographie de leur imagination », puis en ce qui concerne la communication entre l'homme et l'animal. Florian Vernet, en lecteur ami et confrère en écriture, se livre à un regard croisé sur deux itinéraires littéraires, en ce qu’ils livrent d’échos sur une vision humaniste du monde « entre rire et désespoir », la formule, une fois encore, est totalement pertinente. Marie-Jeanne Verny propose une lecture rapide de quelques coïncidences entre La Bèstio dóu Vacarés de D’Arbaud et Lo Darrier das Lobaterra de Ganhaire.
Il reste que si cette approche comparatiste constitue le cœur des trois articles évoqués, presque toutes les contributions évoquent de façon plus ou moins précise les sources littéraires, parfois clairement avouées, parfois sous-jacentes, qui ont nourri l’inspiration de Ganhaire. C’est le cas de Jaume Figueras, ou de Christian Bonnet, qui repèrent grand nombre de modèles littéraires ou cinématographiques qui irriguent l’écriture de Ganhaire, modèles que ce dernier réinterprète librement avec sa plume originale. Nous savons en effet que Joan Ganhaire est un grand lecteur (on pourrait d’ailleurs se demander s’il est possible d’être un grand auteur sans être nourri des œuvres des autres…) ; il ne fait pas mystère des influences qui sont les siennes. Ajoutons que la bibliographie qui figure à la fin du dernier roman Lo Pacient espanhòu est la preuve, s’il en était besoin, du soin que prend Ganhaire à fonder ses œuvres d’imagination sur un travail d’investigation préalable.
Regards particuliers sur les œuvres
Des contributeurs ont choisi de porter leur regard sur telle ou telle œuvre en particulier. Ainsi de Yan Lespoux dont les compétences d’historien – mais aussi, de critique littéraire – lui ont permis de nous livrer quelques notes précieuses sur les deux romans historiques que sont Dau vent dins las plumas e Las Islas jos la sang. Il conclut avec l’équilibre trouvé par Ganhaire entre « socit didactic de parlar d’un periòd complèxe e de causas gaire joiosas, derision e aventuras » [souci didactique de parler d’une période complexe et de choses guère joyeuses, dérision et aventures]. Yan Lespoux corrobore notre observation précédente : quand Ganhaire évoque l’Ormada [L’Ormée] ce mouvement de révolte qui se développa à Bordeaux de 1651 à 1653, il le fait muni d’une solide documentation. Marie-France Fourcadier, quant à elle, choisit de présenter les principaux motifs du premier recueil de nouvelles, Lo Rire dau reire-lutz, qui révéla Ganhaire au lectorat occitan. Marie-Jeanne Verny analyse, à partir des grilles d’analyse de Tzvetan Todorov, le fonctionnement de l’écriture fantastique dans le roman Lo darrier daus Lobaterra dont elle commente la construction particulière par le biais de deux récits enchâssés. Philippe Gardy, grâce à l’amabilité du comité de rédaction de la revue OC à laquelle elle est d’abord destinée, nous propose une note sur l’avant-dernier roman de Ganhaire : Lo Pacient espanhòu.
L’architecture de l’œuvre
Deux articles nos permettent de jeter un regard synthétique sur l’ensemble de l’œuvre afin d’en comprendre l’articulation entre unité et diversité, telle que suggérée par Fabienne Garnerin. Il s’agit de l’article de Joan-Claudi Forêt, qui excelle dans ce genre de panorama, précis, rigoureux et organisé, à travers un titre volontairement trompeur « la mòrt, l’amor, l’umor » dont son étude montre que le deuxième terme est quasi absent de l’œuvre. Christian Bonnet, pour sa part, nous entraîne dans un inventaire jubilatoire de l’œuvre de Ganhaire, qu’il compare, chemin faisant, aux meilleures réussites du baroque occitan. La métaphore filée de l’arbre avec ses multiples ramifications soigneusement organisées en trois « marns » (branches principales) : les premiers romans, le genre policier, les recueils de textes courts, ordonne sa réflexion qui explore l’originalité stylistique et philosophique de l’auteur.
Visions du monde et place des sens
C’était une suggestion de l’appel à communication à laquelle a répondu notamment Joëlle Ginestet, qui se penche sur la perception du monde sensible dans l’œuvre où le motif du vent, jusque dans les titres, joue un grand rôle. La plupart des articles ici rassemblés mettent en évidence cet art qui est celui de Ganhaire, dans les notations strictement descriptives ou dans les passages narratifs, de traduire des sensations, lesquelles, à leur tour suggèrent l’intériorité des protagonistes. L’article de Joëlle Ginestet s’appuie sur une citation de Fabienne Garnerin :
C’est par le corps et les sens que l’auteur fait entrer le lecteur dans son espace imaginaire, dans un monde de l’action lié à l’immédiateté des sensations. Plutôt que de procéder à des explorations psychologiques complexes, l’auteur choisit de donner à lire des signes perceptibles, matériels, dont l’ensemble fait sens (Garnerin 2022, 62).
Et en supplément…
Lorsque nous avons créé Plumas, c’était d’abord pour proposer un lieu spécifiquement dédié à la publication de critiques littéraires inédites issues de colloques ou d’appels à contributions. Mais nous ne nous interdisions pas, forts de notre propre expérience de chercheurs, de republier des contributions anciennes précieuses devenues inaccessibles.
C’est ainsi que le dossier sur Ganhaire nous a soufflé l’idée de reprendre un article fondamental de Claire Torreilles, qu’elle a, pour l’occasion, réactualisé : « Manuscrits cachés et fondations romanesques ». C’est bien en effet ce motif du « manuscrit caché » dont Claire Torreilles montre l’abondance dans la littérature occitane, qui fonde le roman Lo darrier daus Lobaterras.
***
L’ambition principale de ce numéro de Plumas, tel que le souhaitait celle qui en fut l’initiatrice, est bien d’élargir le cercle des connaisseurs de Joan Ganhaire, à commencer par celui de ses lecteurs et, bien sûr de susciter d’autres approches, mais aussi de donner l’envie de découvrir l’étude pionnière de Fabienne Garnerin qui reste la porte la plus complète et la plus pertinente pour entrer dans cette œuvre.
***
En pensant a Françoise Ganhaire
Aux moments où nous écrivions ces lignes, nous apprenions la disparition de celle qui fut pour Joan Ganhaire la compagne de toute une vie. Médecin elle aussi, femme engagée dans la défense des Droits humains, elle suivait le travail de son compagnon avec attention, bienveillance et humour.
De même que Fabienne Garnerin n’aura pas pu accompagner la publication de son étude, Françoise n’aura pas vu naître ce numéro de Plumas dont nous osons penser qu’elle aurait été heureuse de le voir publié.