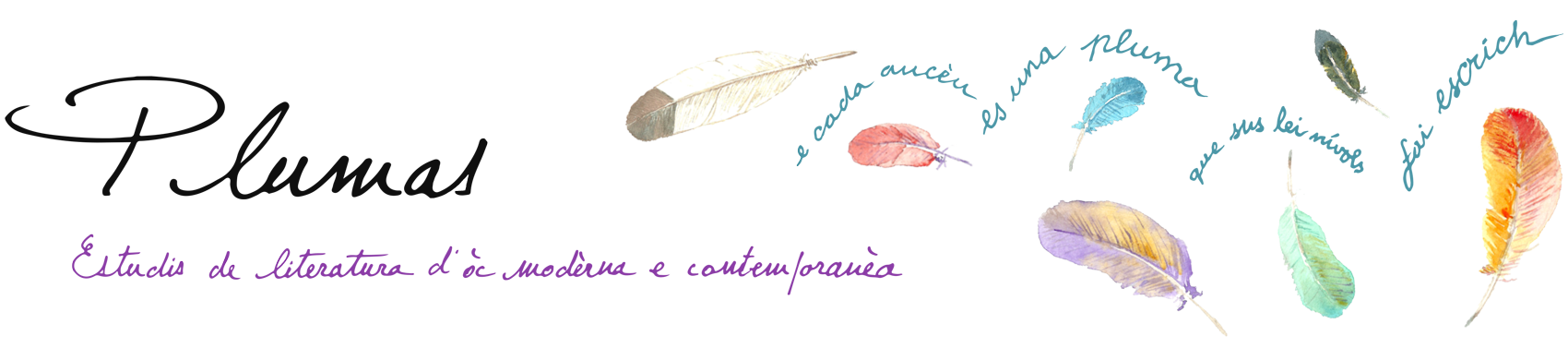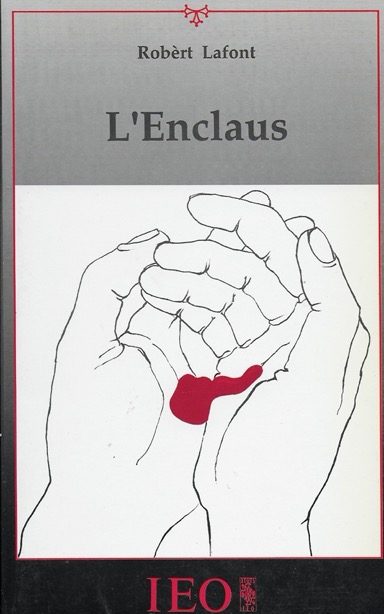L’enclaus
IEO edicions, 1992
Après les vastes espaces et les chevauchées narratives de La Festa, L’Enclaus est le livre, comme son nom l’indique, de la clôture, de l’enfermement. Un court récit dense et déchirant.
Au début, il y a, contre le mas, un enclos de vigne abandonnée dont les murs bâtis de galets du Gardon se défont peu à peu et, à la fin, le narrateur, ayant traversé le fouillis de hautes herbes et d’orties humides, franchit la brèche par où, enfant, il gagnait la campagne. Le mas vidé, la famille dispersée, il vient de donner les derniers tours de clé à la porte pendant que la pendule continue à sonner les heures.
Cette porte fermée rappelle inévitablement celle de la fin du premier roman de Robert Lafont : Vida de Joan Larsinhac : « darrièr tu la pòrta se barra e se tornarà pas dobrir » [derrière toi la porte se ferme et ne se rouvrira pas] dont Philippe Gardy fait le point d’ancrage symbolique et complexe du temps de l’écriture narrative (Gardy 2022, 102). Le narrateur de L’Enclaus emporte avec lui le cahier sur lequel, au bord du gouffre, il a quotidiennement repoussé les vertiges de la folie qui l’entoure depuis l’enfance, luttant de toute la force de son imagination puis de sa raison pour « tenir lei retnas de l’estre [s]ieu » [tenir les rênes de [s]on être]. De ses souvenirs il fait, des années après, un récit raconte à la première personne dont il attend la libération définitive de cette prison familiale intériorisée qu’il avoue n’avoir jamais vraiment quittée.
Il y a, nous semble-t-il, une manière théâtrale dans l’exposition de ces souvenirs mêlés où se succèdent « gràcias abondosas » [grâces abondantes], crises et « scènes » de plus en plus violentes, au fil d’une analyse intime menée en contrepoint, non par un chœur extérieur, mais par un témoin tragiquement impliqué. Trois âges, exactement marqués et qui servent de repères diégétiques, trois actes. Le temps scolaire s’achève en 1960, le temps du collège en 1965 puis vient celui du lycée et des études.
Les lieux ne sont pas moins exactement identifiés, de tout leur poids de vécu. C’est d’abord le village de la Gardonnenque où se trouve le mas acheté par le grand-père après sa retraite, espace ouvert sur les collines proches, et sur les Cévennes :
Un relarg de vista entre lei sausetas e leis aubaredas de Droda e un escalator de garriga en cades, avauç, euses. Un crestenc dessenhat en gris per un clapàs long. En delà, doas renguieras de Cevenas, pallas lo matin, blavas escuras lo vespre. (7)
[Une large perspective entre les saulaies et peupleraies de la Droude et un échelonnement de garrigue en genévriers, chênes kermès et yeuses. Le dessin gris d’une longue crête de pierres. Au-delà, deux rangées de Cévennes, pâles le matin, bleu sombre le soir.]
Le départ à Montpellier ouvre le second acte, le Montpellier du tout début des années soixante, avec ses universités, ses chantiers, ses constructions nouvelles et surtout le changement sociologique provoqué par l’arrivée des Pieds-Noirs. Après quelques échappées vers les Aresquiers ou la Grèce, le drame se noue dans les couloirs du parking de la Comédie et de la clinique Rech.
Le troisième acte scelle les destinées de ceux qui font - ou ne font plus - le va-et-vient entre la ville et le village et de ceux dont le mas est devenu, à plus ou moins brève échéance, le tombeau.
Au commencement, le récit a l’allure trompeuse d’une « robinsonnade », comme dit Philippe Gardy qui compare l’enfant dans l’enclos régnant sur son royaume imaginaire de Bucovine à celui des Camins de la saba dans le jardin étroit de la maison nîmoise (Gardy 2022, 98). Mais les jeux de l’évasion ne sont qu’un prélude, d’abord aux jeux de la transgression qui, à défaut de punition, éveillent, avec l’initiation au plaisir sexuel, l’angoisse indicible de la culpabilité, ensuite au grand jeu de « la famille » auquel l’enfant se fait prendre, où il s’englue. Élevé entre ses grands-parents maternels, sa mère et sa tante, il se trouve dans la situation où « la lignée maternelle croise le lieu du père » lequel devrait représenter, selon Robert Lafont théoricien de la praxématique dans La parole et le corps, « la part faite à l’autre dans le soi », autrement dit le surmoi. (Lafont 1993, 111). Or les relations familiales, au début du récit, sont enkystées de telle manière que l’on ne peut que constater les fissures et les ratages dans cette construction de la petite enfance, « una fendascla a l’origina de l’estre » (105) [une fêlure à l’origine de l’être] L’enfant dans l’enclos, livré à lui-même, remarque la fenêtre toujours fermée de Mathilde, sa jeune tante, il entend « la votz dau grand que menava rambalh dins l’ostau » (21) [la voix du grand-père qui faisait du chambard dans la maison] et il est le spectateur de plus en plus conscient de sa propre violence impulsive et de celle qui l’entoure. Ce sont des « scènes » que le grand-père inflige à tous au cours des repas, scènes rituelles qui prennent parfois l’allure quasi sacrée d’une « cène » (31), sur fond de nuit tombante d’une immense douceur :
Me recòrde la taulada, la grand, la maire, Matilde, lo grand. La fenestre era a brand. Ne veniá lo caud dau defòra amb un flaire de most e, pus fòra encara, l’odor secarosa de la garriga. Totei mutavan. Es antau que se perdeguèt pas lo moment exacte que se tais d’un còp lo chafaret dei cigalas e s’espèra quàuquei segondas que monte lo còrus dei grilhets, ont se pagela l’espaci. (37)
[Je me souviens la tablée, la grand-mère, la mère, Mathilde, le grand-père. La fenêtre était grande ouverte. Il en venait la chaleur du dehors avec un parfum de moût, et, plus loin encore, l’odeur sèche de la garrigue. Tous se taisaient. C’est ainsi que l’on ne perdit pas le moment exact où s’arrête soudain le vacarme des cigales et, si l’on attend quelques secondes, que monte le chœur des grillons où l’on mesure l’espace.]
Tous attendent avec horreur la représentation de l’obscénité habituelle : « humeur de massacre », vociférations haineuses de qui a raison contre tous, paroles chargées de sang et de mort, hurlements sauvages, vaisselle et meubles fracassés. Muets, ils sont condamnés au spectacle de ces « tempèris d’espavent que nos laissavan puei relents d’angoissa e ieu banhat de plorum, sens que se n’avisèsse eu. » (19) [tempêtes d’épouvante qui nous laissaient des relents d’angoisse et moi tout baigné de larmes sans qu’il s’en rende seulement compte.] L’enfant apeuré cherche la fuite, Mathilde court, soir après soir, s’enfermer dans sa chambre.
La vie à Montpellier est d’abord un éloignement salutaire du « monstre », une libération des corps et des esprits. Les humanités de l’un, les études de médecine de l’autre et, pour tous les deux, la mer, le soleil, la gloire et le désir des corps dénudés, les arrachent aux vieilles terreurs. On s’évade de toutes les prisons. Une nuit, dans le fouillis végétal de l’enclos retrouvé pour l’été, une méditation partagée du Credo de Cassian de Victor Gelu paraît le point culminant de la renaissance et de l’élévation spirituelle.
Mais il semble y avoir une fatalité de l’ordre de la génétique ou de la contagion sociale de la folie, un déterminisme ravivant la plaie des paroles du jeune Gaston dans l’enclos : « Siátz tótei calucs dins la familha !» [vous êtes tous fous dans la famille !] Le monstre se réveille en Mathilde. « Aquí la tempesta intra mai a ronfle. Lo mostre torna bombir » (40) [Là, la tempête s’engouffre à nouveau. Une fois de plus le monstre bondit.] Et ce sont les paroles racistes et la violence physique d’un abruti proche (l’ami de la mère) qui déclenchent la crise et l’internement psychiatrique. Dans l’obscurité du parking, la scène joue une version moderne de l’enfer : portes métalliques qui claquent, ombres indifférentes qui passent, et puis les cris, les coups, la chute dans l’eau sale, le corps qui perd l’équilibre et s’étale impudiquement, rappelant la fille « mascarée » tombée entre les vignes dans l’hilarité générale (35). Ici encore, mère et fils restent spectateurs impuissants, comme ils le seront des crises de plus en plus douloureuses qui vont suivre et conduire Mathilde à la déchéance. « Me faràs embarrar » (61) [Tu me feras enfermer], avait-elle dit à sa sœur. De la folie qu’on enferme, du « trauma » qu’on ne comprend pas, qu’on soigne mal, qui empire et qui coupe du monde, point d’explication mais des gestes et des images terribles : fermer la porte sur Mathilde internée plusieurs fois puis définitivement prisonnière de sa chambre : « Devers lo mes d’abriu la clau foguèt quichada dins la sarralha d’una existéncia umana » (109) [Vers le mois d’avril, la clé fut enfoncée dans la serrure d’une existence humaine].
Le narrateur ferme les portes. Vivre est à ce prix, celui de la culpabilité où le monstre prend ses aises. Il aurait la figure du diable, de Satan, si tout de la culture huguenote familiale ne s’y opposait. Dès la première page, l’histoire protestante se lit dans le paysage avec la « lause de Rolland » repère invisible mais bien connu : « Aquí nos era mort un cap camisard. Dise « nos » per dire de familha » (7) [Là nous avions perdu un chef camisard. Je dis « nous » pour dire la famille].
Il n’empêche, le diable impose sa présence, même dans les expressions toutes faites de la grand-mère : « I a pas lo diable » dit-elle. Et l’enfant : « Pensave que tot bèu just que lo diable i era. » (67) [Je pensais justement que le diable y était].
Le Diable obsède la pensée : « I aviá una part satanica dins lo grand. Veniá de se far evidenta tornarmai. » (68) [Il y avait dans le grand-père un côté satanique qui venait d’apparaître à nouveau à l’évidence] et, en protestant athée nourri de paganisme antique, écœuré par le rite catholique autant que par l’odeur de l’encens, il conclut, non sans mauvaise foi dans la dialectique :
M’avián, lei mieus que renegave, refusat Dieu per me permetre d’aborrir Satan dins élei e dins leis autres. D’aquela manièra Satan ni la foliá me laissavan pas en patz. (68)
[Les miens, que je reniais, m’avaient refusé Dieu pour me permettre d’exécrer Satan en eux et dans les autres. De cette manière, Satan ni la folie ne me laissaient en paix.]
Le dernier coup, et non le moindre, porté par Satan est la vue du crucifix immense et sanglant, porte de l’enfer sous laquelle Mathilde agonise.
Danielle Julien apporte à la lecture de L’Enclaus un nouvel éclairage en précisant la datation du manuscrit « decembre 89-genier 90 », qui précède de peu celle de La Reborsiera : « Florença, març 90 », bien que ce livre ait paru un an avant L’Enclaus (Julien 2022, 137). Elle montre que l’auteur avait l’intention de publier en trilogie L’Enclaus, La Reborsiera, L’Agach, trois récits « de la férocité ». Le projet s’est éloigné avec L’Agach, devenu la deuxième partie de Finisegle, mais on voit bien comment La Reborsiera prolonge et élargit le thème satanique dans la figure de Patron Aubin, catholique fanatique, soldat de Dieu et égorgeur de protestants dans l’ancien et le nouveau monde. Est-ce Dieu ou le Diable qui « pòrta peira », ici ou là, partout où la folie prend la main sur les destinées humaines ? Quel Dieu ? Quel Diable ? Depuis le début, la divinité se cache dans le non-dit, dans l’inscription latine demi-effacée qui subjugue l’enfant. Gilles Dazas cite la belle formule de Robert Lafont répondant à sa communication sur L’Enclaus (Dazas 2005, 83) : « Ce qui reste c’est le sens incomplet, la trace : IS.DEABUSQUE. » Non la réponse mais la question, non la traduction mais le mystère.